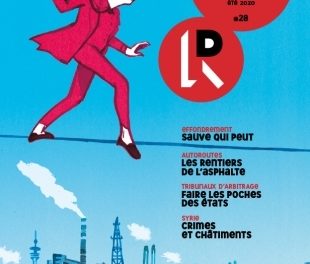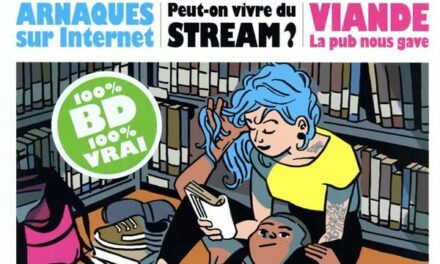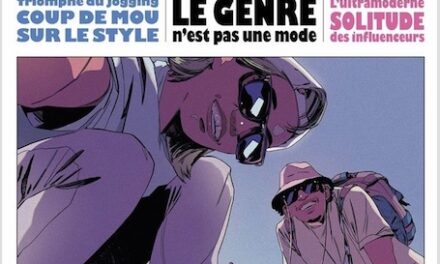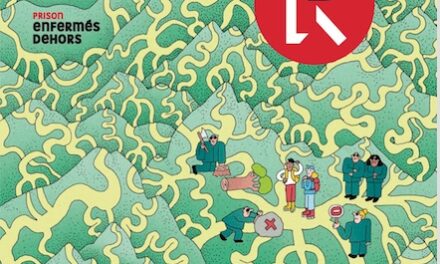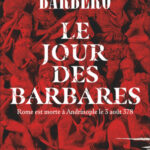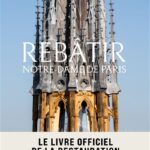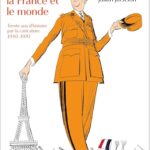La revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique[1] – n° 42 a pour thème : Parlement en transition – Perspectives allemandes au XXe-XXIe siècles. Ce quarantième-deuxième dossier a été coordonné sous la direction de Nicolas Batteux (dir.), Agathe Bernier-Monod (dir.), Valérie Dubslaff (dir.), Annette Lensing (dir.). Comme d’habitude, le dossier se compose de deux éléments distincts : une première partie consacrée à la [Recherche] (avec 5 contributions de 5 chercheurs ou chercheuses, jeunes ou confirmées : Lise Galand, Tobias Kaiser, Agathe Bernier-Monod, Nicolas Batteux et Bettina Tüffers. La seconde par des [Sources] (au nombre de 4) commentées par quatre enseignants-chercheurs : Claire Aslangul-Rallo, Valérie Dubslaff, Annette Lensing et Hélène Miard-Delacroix. De plus, dans ce numéro, nous trouvons deux [Varia] (avec les contributions de Jérémy Floutier ainsi que Florian Galleri, Benoît Grémare et Yannick Pincé). Enfin, la rubrique [Lectures] (au nombre de 10) critiquées par huit historiens (Nicolas Patin, Camille Désenclos, Anthony Hamon, Frédéric Attal, Emmanuel Jousse, Michele Marchi, Paul Smith et, enfin, Philippe Nivet). Le tout résumé depuis le deuxième numéro de 2011 (le n° 16) par Jean-François Bérel, auteur des recensions de la revue Parlement[s]. Revue d’histoire politique pour le compte de « La Cliothèque », rubrique du site de l’association « Les Clionautes ».
Avec une introduction, Nicolas Batteux, Agathe Bernier-Monod, Valérie Dubslaff et Annette Lensing présentent le dossier intitulé Parlement en transition – Perspectives allemandes au XXe-XXIe siècles. L’histoire de la démocratie allemande est d’abord celle de la construction de son Parlement fédéral et de sa culture parlementaire. Ce processus fut progressif, non-linéaire et jonché d’obstacles, et c’est pourquoi ce dossier interroge la façon dont le parlementarisme allemand réagit aux transitions qui ponctuèrent le long XXe siècle. Le Reichstag, puis son successeur à partir de 1949, le Bundestag, furent en effet non seulement le théâtre mais aussi l’acteur de bouleversements de nature diverse : tournant impérialiste de 1900, choc démocratique de 1918-1919, crise économique et institutionnelle de 1929, puis destruction de la démocratie en 1933, reconstruction de cette dernière sous l’ère Adenauer, mobilisation étudiante de 1968, réunification de 1989-1990, prise de conscience de l’urgence climatique, entrée du parti d’extrême droite AfD (Alternative für Deutschland) au Bundestag… Les articles et les commentaires de sources analysent les réponses apportées par le Parlement à ces événements. En ressort une image nuancée de l’institution parlementaire, nécessairement prise en étau entre logiques institutionnelles d’une part et volonté de combler les attentes citoyennes d’autre part. Les perspectives fécondes de ce numéro 42 offrent ainsi des clés pour comprendre la culture politique allemande actuelle. Les contributions de ce dossier, qui vont de l’Empire aux années 2020, donnent ainsi un aperçu des métamorphoses du Parlement national allemand et des reconfigurations spatiales et temporelles qui se sont opérées.
Dans la partie [RECHERCHES], le Reichstag impérial (1871-1918) constituait un organe essentiellement symbolique de la monarchie parlementaire. Un contraste s’observe entre son pouvoir effectif limité et sa capacité véritable à incarner la nation. Lise Galand (agrégée d’allemand et ATER en LEA allemand à Sorbonne Université) mesure la part que prit le Reichstag impérial lors des changements de cap en matière de politique étrangère et d’armement – passage à la Weltpolitik des années 1890 ou réorientation vers l’armée de terre peu avant 1914. Elle reconstitue la position complexe du Reichstag wilhelmien, lieu très visible d’expression de l’opinion publique dans un régime autoritaire.
Dans le sillage de la Révolution de Novembre 1918, la Constitution de Weimar du 11 août 1919 fit du Reichstag le pilier de la République. Élu au suffrage universel direct, il produisait les lois et pouvait renverser le gouvernement au moyen d’un vote de défiance. La Constitution l’avait néanmoins pourvu d’un contrepoids puissant dans la personne du président du Reich. Celui-ci était chef des armées, nommait le chancelier, pouvait dissoudre l’assemblée, déclarer l’état d’urgence, abolir les libertés fondamentales et gouverner au moyen de décrets-lois. La concurrence entre pouvoirs législatif et exécutif à l’ère weimarienne est au centre de l’article de Tobias Kaiser (article inédit traduit de l’allemand par Nicolas Batteux) qui interroge la « Bannmeile », sas et périmètre de sécurité censé protéger le Parlement des pulsions de la foule, périmètre défini de facto par le pouvoir exécutif. La Bannmeile marque, en outre, elle-même une transition spatiale en tant que frontière entre l’espace parlementaire et son dehors, l’espace extraparlementaire.
À partir de 1930, la crise mondiale et l’instabilité politique menèrent à l’avènement du régime présidentiel, qui réduisit le Reichstag à une chambre d’enregistrement des décisions du président du Reich et du chancelier. Dans la partie [Sources], Claire Aslangul-Rallo (Maîtresse de conférences, Sorbonne Université / UMR 8138 SIRICE) analyse un collage de John Heartfield intitulé « Zum 30. August 1932 » (« À propos du 30 août 1932 »), en tant que représentation du passage de la vie démocratique « normale » à un régime autoritaire, voire dictatorial. La mise au pas de la société et de l’espace public en Allemagne passa par la neutralisation du Parlement national, opérée par le vote de la loi des pleins pouvoirs, le 23 mars 1933. Ce vote fut obtenu par l’interdiction du parti communiste (Kommunistische Partei Deutschlands, KPD), l’arrestation massive de députés communistes et sociaux-démocrates, l’intimidation, la répression et la contrainte. Entre 1933 et 1945, le Reichstag nazi n’était plus qu’une chambre d’acclamation servant de décor aux discours de politique étrangère d’Adolf Hitler.
Dans l’après-Seconde Guerre mondiale, la reconstruction du parlementarisme se fit différemment dans les deux parties de l’Allemagne divisée. La RDA, fondée le 7 octobre 1949, était un régime autoritaire centralisé, entièrement contrôlé par le bureau politique du parti unique, le SED. Si elle disposait bien d’une assemblée populaire, la Volkskammer, cette dernière était dénuée de pouvoir. Elle ne faisait que valider les décisions du Politbüro qui avait pouvoir de décision sur la vie politique et économique au sein de l’État communiste est-allemand. De l’autre côté du « Rideau de fer », à l’Ouest, la parlementarisation fut progressive. Elle passa par la constitution de « pré-parlements » (Vorparlamente) institués par les Alliés américains et britanniques, puis par l’élection du Conseil parlementaire, chargé de rédiger une Constitution qui entra en vigueur en 1949. Les débuts du Bundestag furent difficiles, car la dictature nazie avait entraîné, pour le parlement, une incommensurable perte de ressources et de mémoire. Agathe Bernier-Monod (doctorante contractuelle en civilisation germanique à l’université Paris-Sorbonne) examine l’année 1953, passage de la première à la deuxième législature, comme mise en place de tendances de longue durée au Bundestag de Bonn. L’adoption d’une première loi fédérale d’indemnisation des victimes du nazisme posa le premier jalon d’une politique de réparation, amenée à se consolider. La domination chrétienne-démocrate qui se cristallisa alors perdura dans la culture politique ouest-allemande jusqu’à la fin des années 1960.
Puis, le mouvement de 1967-1968 constitua un défi pour le Bundestag. Nicolas Batteux (Université de Lorraine, CEGIL) décrit l’opposition extraparlementaire éminemment composite qui émergea à cette période dans le but d’incarner une véritable opposition démocratique à la Grande Coalition, composée des deux grands partis, les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, alors au gouvernement. L’exemple du groupe parlementaire social-démocrate montre la fixation des députés sur le respect du temps et de la procédure parlementaire, au détriment du symbole qu’un traitement législatif plus rapide aurait pu représenter aux yeux des manifestants.
Les principales modifications que le Bundestag connut par la suite sont géographiques. Lors de la réunification, Le Parlement fédéral accueillit les députés des nouveaux Länder, qui adhérèrent à la République fédérale. Les élus du Bundestag votèrent en faveur du déménagement du Parlement de Bonn vers Berlin pour rejoindre le palais historique du Reichstag. Bettina Tüffers (article traduit de l’allemand par Nicolas Batteux et Agathe Bernier-Monod) relate l’entrée des élus de l’Est dans l’assemblée et livre leur point de vue original, notamment sur la décision de migrer vers la capitale de l’Allemagne réunifiée. Dans son commentaire de la photographie en couverture, la façade du Reichstag en chantier avant le déménagement à Berlin du Parlement fédéral, Hélène Miard-Delacroix analyse la dimension symbolique de cette réimplantation. Des parutions récentes s’attachent également, dans le prolongement du spatial turn, à étudier les lieux de la vie démocratique. L’ouvrage collectif, Ende der Bonner Republik ? Der Berlin-Beschluss 1991 und sein Kontext, se penche ainsi sur ledit transfert du Bundestag de Bonn à Berlin dans les années 1990. Un colloque, qui s’est tenu en septembre 2024 à Düsseldorf, analysait, lui, l’architecture parlementaire en Europe en tant que source historique et en tant que matérialisation d’un système politique ou d’une Constitution. Cette dimension symbolique et matérielle de la culture politique se retrouve dans la recension que propose Nicolas Patin (Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Bordeaux-Montaigne) de l’ouvrage de Christoph Schönberger sur la place que réserve le cérémonial des parlements nationaux aux représentants du pouvoir exécutif. Nicolas Patin fait deux autres compte-rendu dont l’une porte sur la publication de la thèse d’Agathe Bernier-Monod, Les Fondateurs. Reconstruire la République après le nazisme, 2022 et l’autre sur le professeur de droit Christoph Schönberger, Auf der Bank. Die Inszienierung der Regierung im Staatstheater des Parlaments (Münich, C. H. Beck, 2022, 283 pages) qui est une analyse du « banc du gouvernement » à l’Assemblée au Bundestag, appelé « banc des ministres » en France, au Palais Bourbon.
Dans un dernier mouvement, ce dossier décrit les transformations actuelles qui déterminent le fonctionnement parlementaire et parfois le perturbent. Valérie Dubslaff (Maîtresse de conférences à l’Université Rennes 2) analyse ainsi les conséquences de l’entrée historique de l’extrême droite au Bundestag par le biais du discours tenu par Bernd Baumann, député de l’AfD, lors de la séance inaugurale de la 19e législature du Bundestag, le 24 octobre 2017. Dans sa prise de parole, le député critique les « manœuvres » des députés des partis « établis » ayant in extremis et de manière inédite voté le changement du règlement intérieur du Parlement pour empêcher l’octroi de la fonction de doyen (Alterspräsident) à un député d’extrême droite. Cette source permet de questionner le rapport à la démocratie parlementaire des députés de l’AfD et leur difficile « parlementarisation » ainsi que le « cordon sanitaire » anti-extrémiste mis en place au Parlement pour tenir à l’écart les nouveaux parlementaires.
Dans un entretien, enfin, Annette Lensing (Maîtresse de conférences, Université de Caen Normandie / ERLIS) interroge un représentant de la nouvelle génération politique allemande, David Schiepek (né en 2001), qui a été porte-parole du mouvement des jeunes pour le climat, Fridays for future, dans la ville bavaroise de Dinkelsbühl. À seulement 18 ans, il est élu au conseil municipal de sa ville natale pour le parti Bündnis 90/Die Grünen, qu’il avait rejoint deux ans plus tôt. Dans son témoignage, il présente le passage douloureux de la mobilisation de « la rue » à la politique institutionnelle, ses frustrations et marges de manœuvre limitées en tant que conseiller municipal de l’opposition et représentant de la jeune génération, et explique qu’il se sent parfois exclu de la culture et des pratiques politiques institutionnalisées. Ayant quitté les Verts début 2025 comme d’autres jeunes de sa génération – le bureau de l’organisation de jeunesse du parti, la Grüne Jugend, a démissionné quelques mois plus tôt – David Schiepek nous livre sa perception d’une transition écologique ambitieuse mais socialement juste et revient sur les défis et reconfigurations de la démocratie parlementaire allemande au lendemain de l’éclatement de la coalition « feu tricolore » et des élections anticipées de février 2025.
À l’heure où vient de se constituer le nouveau Bundestag sous les auspices noirs-rouges (CDU/CSU et SPD) pour sa 21e mandature, après une campagne électorale courte, intense et mouvementée, les observateurs s’accordent sur les défis historiques que devront relever le gouvernement et le Parlement dans les quatre années à venir : réconcilier une Allemagne de plus en plus clivée et tentée par l’extrême droite, assurer la stabilité du pays dans un contexte géopolitique incertain, préserver la sécurité et l’intégrité du territoire national, répondre aux risques et défis climatiques et relancer la machine économique en panne pour préserver le niveau de vie, la prospérité et la paix sociale. Pour ce faire, il leur faudra avant tout restaurer la confiance en la politique et la démocratie parlementaire dont certains critiquent la lenteur des processus décisionnels. Or, tel est bien le propre de toute phase transitoire : le « changement d’époque », dans lequel se trouvent l’Allemagne et l’Europe, requiert la mise en place avisée de nouveaux jalons et un re-paramétrage politique qui prend du temps. La démocratie allemande, en tout cas, a prouvé ces derniers siècles qu’elle avait des capacités de résilience et d’adaptation aux temps nouveaux.
Dans la partie [VARIA], avec son article intitulé La Transylvanie, l’Alsace-Moselle de l’Est ?, Jérémy Floutier montre que la Transylvanie et l’Alsace-Moselle sont deux territoires frontières se trouvant au cœur d’une intense querelle entre deux nations. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Alsace-Moselle devient le symbole de la réconciliation franco-allemande, tandis que la Transylvanie demeure une importante source de tensions entre la Hongrie et la Roumanie. Si Allemands et Hongrois sont les deux « perdants », leurs réactions face à cette séparation marquent de profondes différences. En mobilisant la méthode comparative, cette étude entend mettre en lumières les divergences et les similitudes dans la perception des deux régions. Avec l’article, Le Premier ministre et la bombe, les auteurs Florian Galleri, Benoît Grémare et Yannick Pincé explique que, dans la Ve République, le Président est reconnu comme le décideur en matière de dissuasion nucléaire. Pourtant le Premier ministre ne s’efface pas toujours. Il prend la parole sur la doctrine et parfois, en cas de cohabitation, exprime une ligne différente pour manifester la politique de son gouvernement. Le présent article démontre que la pratique des institutions l’a d’abord dépossédé de son rôle avant de confirmer juridiquement cette évolution.
Dans la partie [LECTURES], outre les trois recensions de Nicolas Patin, Camille Desenclos (CHSSC, Université de Picardie-Jules Verne), avec le dernier ouvrage de Fanny Cosandey, Reines et mères. Famille et politique dans la France d’Ancien Régime (Fayard, 2022, 294 pages) montre que l’autrice appréhende la figure de la reine par un autre prisme, celui de la maternité, et ce dans ses deux acceptions : la procréation et la qualité maternelle.
Avec l’ouvrage de Frantz Laurent, Charlemagne-Émile de Maupas (1818-1888). Étude d’une trajectoire administrative, politique et notabiliaire, des monarchies censitaires à la Troisième République, (Paris, Dalloz, 2024, 712 pages), Anthony Hamon (Tempora, Université Rennes-2) présente la publication presque identique de la thèse effectuée sous la direction d’Éric Anceau et soutenue à Paris le 3 décembre 2022.
Avec le livre Enrico Serventi Longhi, Il dramma di un’epoca. L’Affaire Dreyfus e il giornalismo italiano di fine Ottocento (Rome, Viella, 2022, 308 pages), Frédéric Attal (LARSH, Université Polytechnique Hauts-de-France) explique qu’Enrico Serventi Longhi (professeur à l’Université de Rome III) analyse comment la couverture journalistique de l’Affaire Dreyfus en France contribua, en Italie également, à accélérer le processus de modernisation de la presse transalpine sous toutes ses formes.
Avec la publication de la thèse de Matthieu Boisdron, Joseph Paul-Boncour (1873-1972) (Paris, Sorbonne Université Presses, 2023, 514 pages), Emmanuel Jousse (Centre d’histoire, Science Po Lyon) revient sur cette carrière exceptionnelle qui personnifie donc tout un régime politique de la Troisième République. C’est le grand mérite du livre de Matthieu Boisdron que de permettre au lecteur de comprendre, à partir des pratiques situées d’un individu devenu emblématique, les mécanismes et les principes de la IIIe République sur quatre décennies.
Pour Michele Marchi (Université de Bologne), le sous-titre de cet ouvrage réalisé à partir des archives du Centre d’Histoire de Sciences Po illustre bien l’intense trajectoire politique et intellectuelle de Jean Charbonnel dans l’horizon du gaullisme, essai du regretté Gilles Le Béguec et de Jérôme Pozzi (dir.), Jean Charbonnel. Un intellectuel gaulliste en politique (Paris, L’Harmattan, 2023, 296 pages).
Pour Paul Smith (Université de Nottingham), Le Promeneur enraciné ressemble presque à de l’histoire ancienne. En effet, est-il possible d’imaginer un futur présidentiable comme François Mitterantd prenant autant de soin à cultiver sa base politique locale ou à connaître intimement une si grande partie du territoire national, ouvrage sous la direction de François Dubasque et Anne-Laure Ollivier (dir.), Le Promeneur enraciné. François Mitterrand, un cheminement politique et sensible à travers les territoires (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023, 269 pages).
Enfin, selon Philippe Nivet (CHSSC, Université de Picardie-Jules Verne), la longévité et la variété de la carrière politique parisienne de Jean Tibéri (quarante-neuf ans conseiller municipal, quarante-trois ans député, vingt-cinq ans maire du Ve arrondissement, six ans maire de Paris, un an membre du gouvernement) méritaient une étude qui dépasse la question des « affaires ». C’est chose faite avec le livre de Laurent Godmer (maître de conférences en science politique à l’université Gustave-Eiffel et chercheur au Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique-Hannah Arendt [LIPHA]), spécialiste notamment de l’ancrage en politique : Laurent Godmer, Jean Tiberi, le métier d’homme politique (Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2023, 303 pages). Les Clionautes (Jean-François Bérel pour La Cliothèque)
[1] Créée en 2003 sous le titre Parlement[s], Histoire et politique, la revue du CHPP change de sous-titre en 2007 pour affirmer sa vocation à couvrir tous les domaines de l’histoire politique. Chaque volume est constitué pour l’essentiel d’un dossier thématique [Recherche], composé d’articles originaux soumis à un comité de lecture, qu’ils soient issus d’une journée d’études, commandés par la rédaction ou qu’ils proviennent de propositions spontanées. Quelques [Varia] complètent régulièrement cette partie. La séquence [Sources] approfondit le thème du numéro en offrant au lecteur une sélection de sources écrites commentées et/ou les transcriptions d’entretiens réalisés pour l’occasion. Enfin, une rubrique [Lectures] regroupe les comptes rendus de lecture critiques d’ouvrages récents. Enfin, la revue se termine systématiquement par des résumés et des contributions écrites en français et en anglais (suivis de mots-clés). Cette revue a été publiée successivement par plusieurs éditeurs : Gallimard (n° 0) en 2003, Armand Colin (n° 1 à 6, H-S n° 1 et 2) de 2004 à 2006, Pepper / L’Harmattan (n° 7 à 20, H-S n° 3 à 9) de 2007 à 2013, Classiques Garnier (n° 21 et 22, H-S n° 10) en 2014 et, enfin, les PUR (depuis le n° 23 et le H-S n° 11) à partir de 2016.