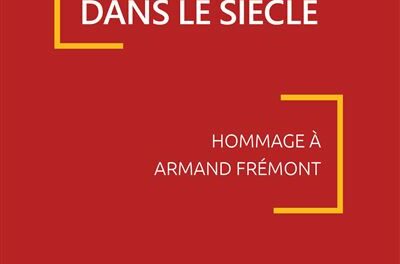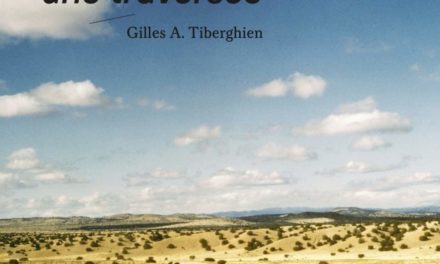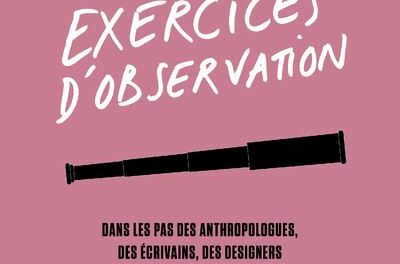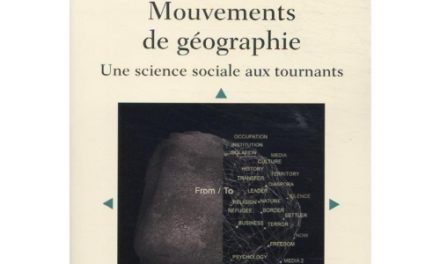« Paris, ça pue ». Telle a été longtemps l’opinion dominante de beaucoup des non Parisiens, énoncée souvent comme une des raisons majeures de leur peu d’envie de vivre à Paris. »
Quelle drôle de façon de présenter Paris, ville lumière ! C’est ainsi que François Ascher débute la préface du livre de Lucile Grésillon consacré à Paris. Décédé en 2009, il avait suivi l’élaboration de l’ouvrage (issu du travail de thèse de l’auteure) et tenait à montrer, par là, l’avancée que constituait cette approche. Car on a bien affaire ici à de la géographie avec cette étude de Paris par le biais de ses odeurs ! Le propos est basé sur un travail d’enquête et d’observation analytique dans différents quartiers parisiens (quai du RER B, Rue de la Huchette, mais aussi des quartiers résidentiels tels que le Square des Peupliers et la place Pinel dans le XIIIème arrondissement ou bien encore la Rue Lagrange dans le V°). Par le biais de cinq lieux emblématiques au niveau olfactif, il s’agit d’approcher la géographie parisienne. C’est ce que l’on appelle de l’urbanisme sensoriel.
Lucile Grésillon est urbaniste et maître de conférences en géographie à l’IUT d’Alençon et à l’Université de Caen. Ce livre est tiré de sa thèse soutenue en 2005 à l’Université Panthéon – Sorbonne, sous la houlette de Nicole Mathieu. Le mémoire de maîtrise de Lucile Grésillon portait déjà sur un thème adjacent et lui avait valu en 1998 de participer au colloque « La géographie des odeurs » mis sur pied par J.R. Pitte et R. Dulau. Les travaux de Lucile Grésillon s’inscrivent dans le cadre d’une étude réalisée entre 1999 et 2002 suite à un appel d’offre lancé par le MATE (Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement).
Notre mode d’habiter rend compte de la recherche du bien être. Pourtant, il apparait que l’élément sensoriel est trop peu pris en compte jusque là par les urbanistes. La question que se pose Lucile Grésillon est savoir « en quoi l’étude des sources sensorielles du bien être des Parisiens remet-elle en question notre manière de fabriquer la ville aujourd’hui et contribue-t-elle à tracer de nouvelles pistes ? » S’il est acquis que l’odorat tient une place centrale dans les rapports amoureux, comme dans les actes d’achat, le fait qu’il puisse entrer en ligne de compte dans notre mode d’habiter est moins évident à première vue. L’idée de la chercheuse est de considérer l’odeur non pas comme un « objet de recherche en soi, mais un instrument pour saisir le vécu sensible des citadins ».
Elle consacre pour cela beaucoup de temps à mener des enquêtes auprès des habitants ou des passants des quartiers sélectionnés. La Rue de la Huchette, bien connue pour ses nombreux restaurants grecs, se distingue des 4 autres lieux par ses odeurs de nourriture, de « graillon », disent certains. Pour d’autres, selon les heures de la semaine, c’est l’odeur de poubelle qui l’emporte quand ce n’est pas celle d’urine ! Les stratégies pour lutter contre les odeurs font florès (refus d’ouvrir les fenêtres, installation de climatisation, obligation d’installer des extracteurs de fumée dans les cuisines des restaurants) mais s’avèrent assez limitées.
L’étude consacrée au RER B et à son quai, non- lieu, au sens ou Marc Augé le définit (1992), est particulièrement intéressante. Elle montre en quoi la matérialité du lieu est source de mal être (ce qui n’est pas vrai du métro, construit selon des normes hygiénistes : réflectance, blancheur des céramiques, aération…). Tout joue contre le bien être des personnes au-delà des mauvaises odeurs qui caractérisent le lieu (la très reconnaissable odeur d’œuf pourri, résultat de la décomposition du gypse sous l’action de l’humidité et du dioxyde de carbone rejeté par les voyageurs). Ce n’est pas la senteur muguet du parfum Madeleine incorporé dans les détergents de nettoyage qui rend le lieu plus agréable. L’auteure montre que tout est fait ici pour que l’on s’y sente mal : les quais se tournent le dos, le revêtement sur les murs et au plafond est trop foncé et ne laisse pas la lumière se réfléchir. Les espaces sombres sont synonymes de mal être voire d’insécurité.
L’étude des quartiers résidentiels révèle les stratégies mises en œuvre par les occupants pour lutter contre la pollution atmosphérique. Les témoignages montrent que cette lutte s’inscrit dans le cadre d’ « angoisses contagionnistes du XVIIIème et XIXème siècles où il fallait se prémunir de l’air méphitique de la ville sous peine de succomber ». Les plans des appartements haussmanniens ne rejettent-ils pas d’ailleurs les cuisines et autres lieux d’aisance à l’arrière dans des pièces donnant sur une petite cour ? L’auteur appuie ses analyses sur les travaux des historiens qui ont travaillé la thématique (Alain Corbin, Roger-Henri Guerrand ou bien encore Georges Vigarello).
L’étude laisse apparaître que la perception de Paris, de ses odeurs et du bien être des lieux dépend du degré d’appropriation des habitants, de leur âge et du sexe des personnes interrogées. Les femmes sont particulièrement sensibles à la question telles des « sentinelles sanitaires ». Il apparait aussi que les différences sont importantes selon les lieux et selon les échelles d’étude (la rue ou le quartier). Le recours aux neurosciences est nécessaire pour éclaircir le rapport être humain et matérialité urbaine. Les travaux de Holley (L’éloge de l’olfaction, 1999) comme le travail mené par le professeur Mac Leod (ancien directeur du laboratoire de neurobiologie de l’Ecole pratique des Hautes Etudes), parallèlement au développement de l’imagerie cérébrale fonctionnelle ont permis de confirmer que la phénoménologie (le fait que des personnes perçoivent une même chose de manière différente) n’est pas une idée vaine. C’est ainsi que le classement de la perception des cinq sens a totalement été remis en cause par ces travaux et remplacée par un autre neurophysiologique : photorécepteurs, mécanorécepteurs, thermorécepteurs ou chimiorécepteurs. Rendre compte de cela est difficile et c’est le but de la recherche menée par Lucile Grésillon, qui vise à mettre au point une méthode pour étudier ce terrain sensible. Il est difficile de quantifier le ressenti, de faire la part entre le discours formel (ce qu’il est de bon ton de dire) et le ressenti personnel. « Nommer une odeur pour qualifier un lieu, c’est accepter de se révéler en se référant à ses souvenirs, ce qui met en valeur le lien entre perception, mémoire, émotion et plaisir ».
On est ici dans le cadre d’une démarche exploratoire qui s’inscrit dans la lignée de ce que Eric Dardel ébauche en géographie en 1952 avec son livre L’homme et la terre. S’intéresser aux odeurs, c’est mettre en avant notre vécu individuel et collectif dans notre rapport au lieu mais cela vise, par cette géographie sensible, à mettre en place un urbanisme du désir, dans l’objectif de la mise en place de la ville durable.
Ouvrez grand vos narines ! Humez l’air du temps pour savoir ce que sera la ville de demain !
Catherine Didier-Fèvre © Clionautes