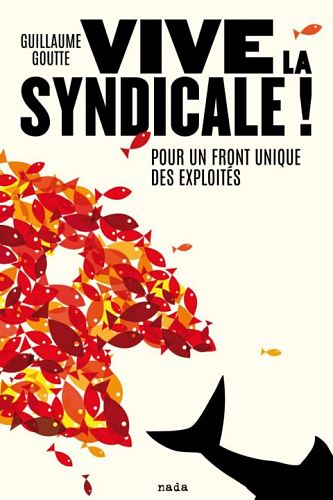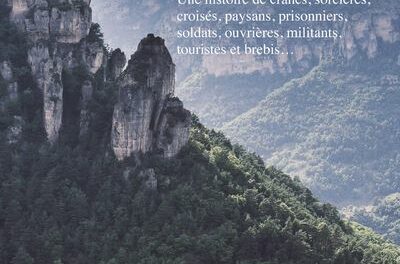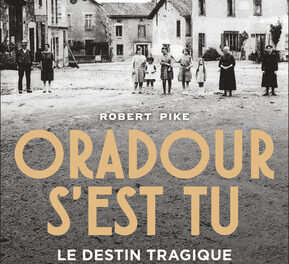Dans ce petit ouvrage mais très dense, Guillaume Goutte montre en quoi le syndicalisme révolutionnaire garde toute son actualité aujourd’hui, et qu’il ne reste pas cantonné aux années précédant la première guerre mondiale, époque de sa pleine expression. Il cherche à démontrer en quoi ses mots d’ordre d’unité d’action peuvent être un moyen de faire progresser les droits sociaux. Il se base pour cela sur les échecs face à la loi « travail » adoptée en 2016Il s’agit en fait de la loi « Macron », adoptée sans opposition en 2015, et de la loi dite « El Khomri » (en réalité fortement inspirée par le premier), qui a suscité un mouvement social plus important, mais avec les mêmes résultats.. La loi « El Khomri » avait pourtant été l’occasion d’une intersyndicale assez large — à l’exception de la CFDT —, rejointe par des éléments étudiants.
Guillaume Goutte dénonce plusieurs faits qui ont compromis la réussite du mouvement. En premier lieu, il s’agit de l’action violente de certains manifestants qui ont développé leurs actions sans concertation avec la base (ce que Pierre Monatte dénonçait déjà en 1913). Il attribue aussi cet échec à la régression de la sociabilité ouvrier, à l’absence d’espaces stables « de rencontres, d’entraide et de partage » (p. 14), comme pouvaient l’être les bourses du travail. Nuit debout a pu être l’un de ces lieux, éphémères, mais le cadre des discussions a rapidement dépassé celui de la lutte contre la loi « El Khomri ». Guillaume Goutte évoque aussi les appels à la grève générale, voire à l’insurrection révolutionnaire, qui tiennent davantage de l’incantation (p. 17) qu’autre chose, du fait de l’absence d’organisation du mouvement s’il venait jamais à l’emporter. Plus grave, selon lui, est la tendance des plus radicalisés (ce qu’il appelle l’ « ultra-gauche ») à dénoncer les organisations syndicales, ce qui revient à en affaiblir l’action par le discrédit. Or, s’il parle d’incantations, Guillaume Goutte ne renonce par ces formes d’action, mais veut dénoncer la mise en avant d’une idéologie souvent déconnectée du contexte réel.
Examinant les faiblesses des organisations syndicales — et notamment de la CGT dont il fait partie —, l’auteur explique ce qu’il apprécie. S’agissant par exemple de la grève générale, il rappelle la grande autonomie dont jouissent chacun des syndicats confédérés, et le fait que les impulsions en proviennent : un mouvement lancé du haut de l’organisation n’aurait aucun sens, et n’est même pas pensable. En revanche, beaucoup plus sérieuse est l’impuissance actuelle des syndicats à établir un réel rapport de force durable. Ils hésitent à se lancer dans une grève, ce qui implique des sacrifices pour ceux qui la suivent, sachant qu’elle ne doit se produire que dans la perspective d’une victoire, une défaite ayant des conséquences désastreuses ne serait-ce que pour remobiliser à terme. On le voit avec les grèves à répétition, dont on ne comprend plus le sens. Pourtant, la France est un pays où le taux de syndicalisation est encore relativement élevé, et où l’opinion publique n’est pas a priori hostile aux buts recherchés, à savoir des progrès sociauxLe poids et la responsabilité des médias dominants sont ici écrasants.. Le phénomène de la « grève par procuration » est cependant vu par lui comme un autre élément explicatif aux échecs sociaux depuis 1995 ; « avec une syndicalisation plus importante, plus forte et plus large au sein du monde du travail, organisée par industrieL’auteur y voit d’autres avantages, notamment le fait de bénéficier du soutien de l’ensemble d’une « industrie » (p. 46), mais aussi de rassembler toutes les catégories de salariés, au-delà des statuts (p. 47), y compris ceux qui sont exclus du travail (p. 48). Ainsi est rompu le sentiment d’isolement, surtout si l’on ajoute une dimension interprofessionnelle par le biais d’unions géographiques de syndicats (p. 52). (en syndicats locaux et en fédérations) et non par entreprise, les mouvements sociaux pourraient rompre avec cette habitude « (p. 27). Or, cela gêne la grève, qui ne parvient à mettre en œuvre la paralysie destinée à atteindre ses objectifs. Enfin, en hésitant à appeler à la grève, les syndicats finissent par en affaiblir la portée symbolique, à savoir la constitution d’une force capable d’obtenir gain de cause, et surtout un moment de prise de conscience que cette force peut être constituée, autrement un moment d’acquisition d’une culture syndicale (p. 71). Enfin, l’auteur voit une autre explication aux échecs dans l’absence d’un élargissement des luttes restreintes à un ou quelques secteurs d’activité : la dimension interprofessionnelle a gravement manqué (p. 69 et suiv.).
Guillaume Goutte s’emploie ensuite à expliquer en quoi consiste le syndicalisme révolutionnaire, incarné aujourd’hui par les CSR (comités syndicalistes révolutionnaires), qui existent au sein de la CGT mais qui ont vocation à être présents dans les autres formations syndicales. Il se distingue de l’anarcho-syndicalisme (dont il est cependant très proche) dans son « rapport aux courants révolutionnaires et, de là, au projet de société » (p. 32). Si celui-là « se pose ouvertement en projet anarchiste de transformation sociale — le communisme libertaire » (p. 32), le « syndicalisme révolutionnaire , lui, préfère l’unité du mouvement ouvrier en œuvrant à rassembler [au sein d’une même confédération] tous les travailleurs soucieux de leurs intérêts de classe et d’indépendance syndicale, qu’ils soient réformistes, partisans d’une émancipation qui se construit pas à pas dans les cadres parlementaires, ou révolutionnaires, convaincus d’une rupture violente, par la grève générale et l’expropriation directe des capitalistes (p. 33), comme l’indique très clairement l’article 2 de la charte d’Amiens, en 1906. Guillaume Goutte reproche précisément à l’anarcho-syndicalisme le fait d’utiliser l’action syndicale pour faire triompher une idéologie, ce qui revient à « sacrifier les capacités politique des travailleurs sur l’autel d’un subordination idéologique […] appelée à se substituer à [leur] réflexion dans la construction de leur émancipation ». Voilà qui explique le farouche attachement du syndicalisme révolutionnaire au vieux principe d’une autonomie du syndicalisme à l’égard du politique. Pour autant, il ne s’agit pas de rejeter « la dimension politique du syndicalisme [mais bien d’affirmer qu’il] peut et doit élaborer lui-même son projet politique » (p. 39), ce qui permet de renforcer « la confiance que le prolétariat a en ses propres capacités politiques, c’est-à-dire à […] à penser son émancipation » (p. 42).
Pour autant, Guillaume Goutte estime que les campagnes électorales doivent être utilisées pour porter les revendications sociales (p. 59 et suiv.), sans que les organisations interfèrent en quoi que ce soit dans le jeu politique, en préconisant telle ou telle attitude.
Court et bien écrit, l’ouvrage séduit par la capacité de son auteur à transmettre sa réflexion de façon fluide. Chacun y trouvera ce qu’il veut bien y trouver. Cependant, il paraît important que des enseignants disposent de ce genre d’ouvrage, ne serait-ce que pour alimenter leur propre culture sociale ou leur besoin de satisfaire leur curiosité idéologique. Il est également indispensable pour leur permettre de comprendre les racines et les enjeux qui animent les mouvements sociaux actuels, à propos desquels ne manquent pas de s’interroger les élèves. Il l’est encore pour approfondir le regard critique sur la société sans lequel le métier d’enseignant n’est rien.