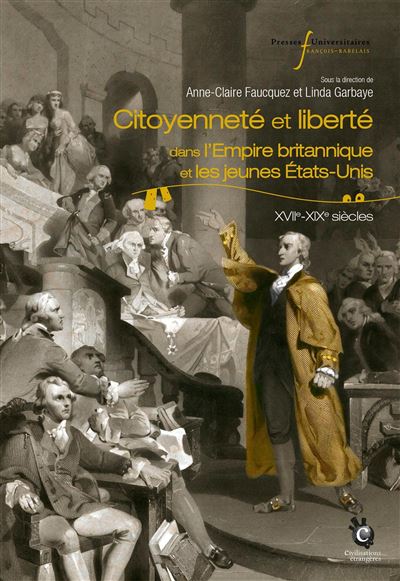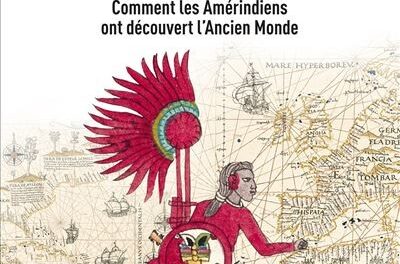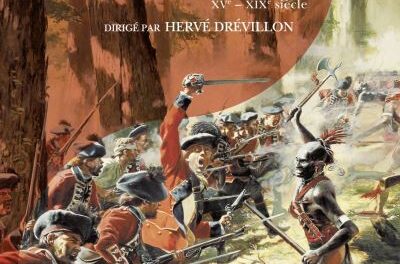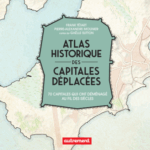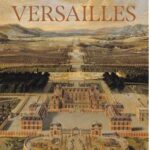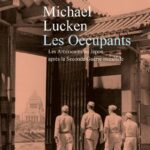Citoyenneté et liberté : deux idées, deux notions qui n’ont jamais été autant invoquées ces deux dernières années en Europe et aux États-Unis, sans pour autant qu’un consensus soit possible. L’actualité récente en France montre combien celle de liberté n’est pas entendue de la même manière par des individus pourtant acquis à la démocratie. C’est dans ce contexte que les Presses Universitaires François Rabelais proposent depuis début juin l’ouvrage intitulé « Citoyenneté et liberté dans l’Empire britannique et les jeunes Etats-Unis, XVIIe-XIXe siècles » publié sous la direction d’Anne-Claire Faucquez et Linda Garbaye.
Cet ouvrage collectif est divisé en trois parties, chacun proposant quatre à cinq contributions mettant en lumière un aspect particulier de la question. L’ensemble est à chaque fois resitué dans une perspective historiographique précieuse, et, disons-le desuite, le professeur chargé de l’enseignement de spécialité et de l’EMC ne manquera pas de trouver des éléments intéressants afin de nourrir la réflexion des élèves mais aussi de prolonger la sienne. Pour des raisons pratiques, il est préférable de lire l’ouvrage en suivant l’ordre des chapitres.
En introduction, les auteurs rappellent combien l’année 2020 fut un tournant. En effet, pangolin à part, les États-Unis ont fêté le 100ème anniversaire de la ratification du 19ème amendement à la constitution concernant le droit de vote des femmes à toutes les élections, tandis que le Brexit a engendré des modifications de la citoyenneté britannique.
Pourtant, la citoyenneté est un terme peu employé au XVIIème siècle en Grande-Bretagne et, comme l’ouvrage le démontre au cours des diverses contributions proposées, ce concept demeure un vocable à la signification très variable des deux côtés de l’Atlantique, selon le moment et les intérêts en jeu. La formation des États modernes s’accompagne d’une réflexion sur la place et le rôle politique et social des gouvernés. Pour Hobbes, le citoyen est un sujet et il est nécessaire d’avoir un gouvernement absolu. A l’inverse, John Locke souligne l’importance du contrat social et les citoyens ont une part de souveraineté politique.
***
La première partie « la citoyenneté à l’ère moderne » propose quatre contributions. Le chapitre 1 « être sujet britannique ou citoyen anglo-écossais ? Le débat sur les Post-nati dans la politique britannisante de Jacques VI et 1er » proposé par Sabrina Juillet-Garzon débute en 1603 au moment où Jacques VI d’Écosse veut faire de l’Ecosse un royaume dont les sujets jouiraient des mêmes privilèges et opportunités que les Anglais, idée vite rejetée par les deux Parlements mais le débat est ouvert à cette occasion. L’année 1603 est marquée plus largement par l’Union des deux couronnes, anglaises et écossaise, et la remise en question identitaire et nationale de leur statut. Successeur d’Elizabeth 1ère, Jacques VI est roi d’Écosse depuis 1567, cette dernière étant un royaume indépendant. La question des Post-nati, (enfants nés après le 27 mars 1603) a été posée par Robert Colville pour son propre fils.
La question centrale posée par la situation est la suivante : les sujets dépendent-ils du Roi ou du sol où ils sont nés et où ils habitent ? Globalement l’idée d’un droit commun est rejetée : d’un côté les Anglais craignent de voir les Écossais, réputés pauvres, débarqués en hordes de mendiants en Angleterre, de l‘autre les écossais perçoivent les anglais comme des animaux.
Une proposition est cependant formulée : seraient considérés comme étrangers (ante-anti) ceux nés avant 1603, et comme sujets à la fois écossais et anglais ceux nés après (les Post-nati). Francis Bacon se montre favorable à l’idée car cela permettrait un afflux de personnes compétentes sources de richesses pour le Royaume. Il plaide pour une naturalisation. Dès lors la question de l’uniformité des lois est (forcément) posée car elle doit être la même pour tous. L’affaire Corville force cependant à trouver un premier compromis, prémices du statut de citoyen britannique et d’une nouvelle identité commune.
Le deuxième chapitre, rédigé par Anna Lloyd Hellier et intitulé « la campagne des quakers anglais pour la liberté religieuse et des droits civils au XVIe siècle » offre un autre exemple d’interrogations et de luttes pour l’obtention de l’égalité des droits. Secte protestante non conformiste née en 1647 dans le contexte des guerres civiles britanniques (1642-1649), les quakers sont marginalisés et dépourvus de droits politiques et civils sous Cromwell et Charles II. Cette minorité s’engagent activement pour faire valoir ses droits et sa liberté religieuse et civile.
Rejetant l’idée de toute intervention de l’État et de l’Église dans ses affaires religieuses qui relèvent selon eux d’un lien direct entre l’individu et Dieu, les quakers développent également une conception égalitariste de l’individu et rejettent l’église en tant que lieu de culte ainsi que toute idée de hiérarchie épiscopale, le tout accompagné d’une rhétorique apocalyptique et de critiques dénonçant les excès et les injustices du pouvoir. Vus comme une menace pour la stabilité du Royaume, la répression fut brutale, en particulier à partir de 1660 et l’établissement du Clarendon Code qui encadre la répression des sectes non conformistes. S’estimant trahis, « les quakers mirent en place une offensive sophistiquée » (p. 55) reposant sur deux axes principaux : leur pacifisme (revendiqué) et la légitimité de leur action.
Les publications dénoncent les préjugés, les souffrances et les injustices subies, comme le Saul’s Errand to Damascus en 1653. Cette littérature de souffrances se double de pétitions, et d’adresses qui ont deux buts : informer le public sur les raisons les mettant en conflits avec les autorités judiciaires, et montrer que les quakers promeuvent des réformes pour garantir les droits civils et religieux pour tous mais pas seulement puisqu’on trouve également une proposition pour l’abolition de la peine de mort pour les crimes contre la propriété.
Le discours reprend notamment l’idée d’ «hommes nés libres » présentes aussi chez les Niveleurs. Dès c’est une notion très particulière de la citoyenneté (qui n’envisage cependant pas l’égalité politique homme-femme, ni l’égalité pour tous les hommes !) qui se développe chez les quakers qui trouve une concrétisation avec la fondation de leurs premières colonies en Amérique du Nord.
Très logiquement, le chapitre 3 « les engagés de la Chesapeake – Dans les limbes de la citoyenneté » rédigé par Élodie Peyrol-Kleiber débute avec une mise au point des termes employés et leur définition. Ainsi, un citizen (citoyen) est un habitant d’une ville (city), un sujet (subject) et un étranger (alien) ont des différences marquées, tandis que le recours aux termes de naturalization et denizenship (adoption par le roi) sont fréquemment employés. La naturalisation, coûteuse, était réservée aux protestants mais plus facilement octroyée aux étrangers (européens) dans les colonies qu’en Angleterre, garantissant le droit à la propriété terrienne et la possibilité d’être juré.
Dans ce contexte, l’auteur revient sur la place et le statut des engagés (indentured servants) qui ont été au cœur de la construction coloniale américaine, des hommes et des femmes recrutés pour servir un maître durant un certain temps (p.72), statut très précaire et soumis à une forte mortalité inspiré par celui de l’apprenti et du husbandsman en Angleterre. C’est là qu’on touche à la différence entre la théorie (une citoyenneté qui garantit la liberté et des droits égaux entre sujets anglais) et la réalité. Les engagés bénéficient de la protection garantie par la common law mais durant leur engagement ils ne bénéficient pas des mêmes droits que leur maître (interdiction d’acheter une terre, de commercer, de se marier, d’avoir des enfants …).
Les contrevenants peuvent être marqués au fer rouge au visage. Certes, en cas de maltraitance de la part du maître il est possible pour eux de porter plainte mais la procédure est rarement engagée, la procédure étant délicate et complexe. La situation des femmes engagées est encore plus frappée d’injustice surtout en cas de grossesse durant leur contrat.
Le chapitre 4 « nationalité et citoyenneté dans une société multi-ethnique : New York au tournant du XVIIIème siècle », proposé par Anne-Claire Faucquez, s’interroge sur la manière dont les autorités font face et gèrent la diversité ethnique et culturelle de la ville, ainsi que les conditions d’obtention de la nationalité anglaise dans les colonies nord-américaine en général et à New-York en particulier au XVIIème siècle. La réflexion prend pour point de départ une lamentation de Charles Lodwyck, maire de New-York en 1692, qui regrette la faible part des anglais dans la population de la ville et la mixité trop importante.
En effet, comme le rappelle une note de bas de page, en 1664, les Anglais ne représentent que 4,5% du total tandis que les néerlandais sont 88%. Ce chapitre démontre qu’alors, nationalité et citoyenneté ne sont pas forcément liées. Trois groupes restent ostracisés : les juifs (rappelons l’antijudaïsme primaire de Peter Stuyvesant par exemple), les catholiques et les africains mais, en raison des nécessités économiques liées au manque de main d’œuvre, New-York sait faire preuve de largesse en accordant exceptionnellement le statut de freemanship à certains.
***
La deuxième partie « le tournant révolutionnaire de la citoyenneté » s’ouvre sur la contribution d’Annie Léchenet « Virginie, 1776. Un débat autour du droit de suffrage et de la citoyenneté » synthèse analytique qui revient sur l’échange, essentiellement épistolaire ayant eu lieu entre Edmund Pendleton et Thomas Jefferson durant l’été 1776 sur la question de la représentation qui relève au fond d’une querelle des Anciens et des Modernes dont les conséquences à moyen et long terme ont été majeures des deux côtés de l’Atlantique. Les Anglais d’Amérique du nord rejettent catégoriquement la théorie de la représentation virtuelle. Pour eux, la représentation s’appuie avant tout sur les intérêts locaux et particuliers.
Pour les colons le droit de vote est essentiel à la liberté, et permet le maintien des autres. Parmi les intérêts défendus, la propriété tient une place centrale et fondatrice du droit de vote. En 1780, 25 à 75% des habitants mâles blancs votent sur cette base comme le rappellent les travaux de Jeanne-Marie Rossignol citée par Marie Léchenet. Cette position est défendue par Edmund Pendleton tandis que Jefferson propose une nouvelle approche de la citoyenneté, une autre logique de la société politique : le suffrage universel masculin avant tout puisque concernant les chefs de famille, propriétaires ou non. Pour Jefferson, le droit à la propriété n’étant pas naturel, mais découlant de la volonté de la société, contrairement au droit d’usufruit de la terre. Le vrai droit naturel est celui de travailler pour assurer son existence, ce qui se confond avec le fameux droit au bonheur.
Or le chef de famille est porteur des intérêts de cette dernière et donc, à ce titre il a le droit de faire entendre sa voix. Société civile et politique se confondent. L’intérêt particulier ne se résume plus à la simple question de la possession de la propriété mais à celle de l’indépendance à travers laquelle se concrétise l’autogouvernement où l’intérêt particulier devient, par le biais de la discussion entre citoyens, le moyen de définir l’intérêt général. Penseur radical pour son époque, Jefferson donne donc un droit de vote à chaque intérêt (p .125) où le chef de famille réalise sa capacité d’autogouvernement dans une perspective d’indépendance économique personnelle.
Rémi Duthille propose dans le chapitre 2 d’aborder le thème « De la négation à l’affirmation de la citoyenneté des femmes chez les réformateurs masculins anglais 1774-1795 », qui est complété et illustré par le suivant et l’étude de cas consacré à la poétesse Annis Boudinot Stokton (1736-1801) proposé par Linda Garbaye. Alors que la représentation virtuelle des hommes est battue en brèche comme le montre le chapitre précédent, celle des femmes est au contraire solidement maintenue au nom d’un argumentaire qui fait consensus : le droit de vote des femmes est inutile car elles sont déjà représentées par les hommes, elles font preuve de capacités intellectuelles inférieures aux hommes et s’intéressent peu à la chose publique et, enfin, le port d’arme est corollaire du droit de vote. Or les femmes ne peuvent y prétendre !
Si, au pire la misogynie de l’époque et au mieux la passivité et l’inertie empêchent une quelconque progression de l’intégration des femmes à la vie politique active, quelques hommes féministes posent néanmoins la question à l’instar de Cartwright et, durant la Révolution Française, William Hodgson et Thomas Spence, qui à travers son utopie Spensonia, envisage une égalité homme-femme presque totale. Pour autant, il ne faudrait pas croire à un enthousiasme et à une conviction profonde. Pour Spence, cette conviction est fondée sur les besoins économiques et physiologiques concrets. De fait, les femmes participent déjà dans les années 1780 activement à la vie publique que ce soit en participant à des débats, en organisant des patronages et des collectes de fonds.
Le chapitre 4 « Liberté et représentation politique en Amérique du Nord dans le débat public britannique (1783-1815) » proposé par Alice Lemer-Fleury, au cours de la Révolution américaine, les questions de liberté et de représentation ont été au cœur du conflit entre l’Angleterre et ses treize colonies. En 1783, le débat n’est pas clos et touche désormais la province de Québec, devenue une terre d’asile pour les loyalistes américains qui, d’un côté rejettent la nouvelle République mais qui, de l‘autre demeurent attachés aux assemblées électives. Alors que l’indépendance des États-Unis vient d’être proclamée, comment les Britanniques perçoivent-ils les demandes de réformes des institutions de Québec ?
L’accueil réservé aux revendications est frileux, certains redoutant de nouveaux troubles. Mais les colons canadiens, conscients des difficultés à présenter leurs revendications, font tout pour les rendre équilibrées et présentables. Pour cela, ils mettent en avant leur loyauté envers la Couronne, le patriotisme et le commerce, et prennent soin de se démarquer des républicains tentés par la sédition. Dès lors, les débats ayant lieu au Parlement en 1786 sont un moyen pour les Britanniques de se poser en défenseurs des libertés et de s’enorgueillir des droits conférés par la common law, donc in fine, de discuter de la manière dont les libertés britanniques doivent être diffusées dans les colonies.
Deux visions s’affrontent : celle véhiculée par exemple par Charles James Fox, et celle du Premier ministre William Pitt qui rappelle qu’un certain nombre de sujets canadiens sont pour le maintien de l’Acte de 1774. Dans le même temps, le discours sur les libertés se doublent d’une propagande anti-américaine où la liberté acquise n’aurait engendré que le chaos et la confusion, le but étant de convaincre les migrants de choisir le Canada plutôt que les États-Unis.
La France n’étant jamais loin des débats, c’est quasi naturellement que le chapitre 5 de cette partie rédigée par Carine Lounissi s’intéresse aux « Américains en France de 1792 à 1799 ». La citoyenneté américaine possède trois dimensions : la première (commune à la France) l’adhésion aux principes républicains, l’appartenance à la nation, et le droit de cité. Par conséquent, le fait de s’affirmer citoyen des États-Unis à l’étranger renvoie à une conception minimale de la citoyenneté (p.196). Mais cette coïncidence entre nationalité et allégeance républicaine se double d’une absence de papiers d’identité (sauf pour les marins !) or, à partir de 1793 comment distinguer un anglais d’un américain ? Le chapitre revient sur les évolutions perceptibles durant cette période et distingue 3 ruptures : 1792, 1793 et la période du Directoire, l’attitude envers les ressortissants américains étant changeantes en fonction du moment et des tensions diplomatiques, le chapitre l’illustrant bien à travers quelques cas emblématiques.
***
La troisième et dernière partie « citoyenneté et liberté à l’épreuve de la participation » débute avec la contribution d’Isabelle Sicard « femmes, citoyenneté et droits de pétition dans le Massachusetts de l’ère coloniale à l’ère jacksonienne ». Partant des manifestations des lycéens de Parkland en Floride en 2018, lycéens qui n’ont pas le droit de vote mais participent activement à la vie politique en contestant le IIème amendement, l’auteur fait le parallèle avec le droit de pétition hérité de la Grande Charte de 1215 qui permet à l’ensemble de la population (esclaves compris) de soumettre leur doléance au législateur (p. 217), tandis que le droit de vote est réservé aux hommes sous condition de ressources. Isabelle Sicard revient donc sur la participation des femmes à la fin du XVIIIème siècle dans le contexte du second grand réveil.
Le chapitre 2 proposé par Augustin Habran vient combler un vide que le lecteur pouvait ressentir. « l’« être » indien dans la jeune république des États-Unis (1783-1830) ». Si le projet et la politique d’assimilation des Indiens à la culture des colons devient la ligne directrice de la politique fédérale menée, le chapitre revenant sur celle-ci) cette acculturation imposée entend faire d’eux des fermiers propriétaires de la terre exploitée, pratique indissociable de la citoyenneté comme les chapitres précédents l’ont démontré. Par ce biais l’État entend faire des Indiens des citoyens alors qu’ils ont été exclus du processus en 1787, niant ainsi un droit à l’autodétermination. Quelle fut la réaction des indiens ?
Si dès le départ au Sud-est du pays un métissage de la population s’opère et trouve une place de choix dans la société grâce à ce double héritage culturel, indien et européen, elle se double aussi d’une réflexion sur ce qu’ils acceptent ou pas afin de préserver l’ « être indien », développant de cette manière une citoyenneté parallèle à la citoyenneté américaine (rappelons que les Indiens n’obtiennent la nationalité américaine qu’en 1924 !)
Le chapitre 3 proposé par Anne-Catherine de Bouvier « une citoyenneté sous condition – Les Irlandais, la loi et les élections (1800-1832) » revient sur la question de la citoyenneté dans l’histoire irlandaise et son évolution, complexe, au début du XIXème siècle. Mais c’est surtout le dernier chapitre « la citoyenneté aux États-Unis et en France en 1830 – le triomphe de la liberté ? » proposé par Yohanna Alimi-Levy, qui ne manquera pas d’intéresser les professeurs ayant en charge la spécialité en 1ère et qui leur offrira des idées de comparaisons pour le thème concernant la démocratie.
Après un rapide résumé du contexte dans lequel les « Trois Glorieuses » se déroulent, la chercheuse revient sur Alexis de Tocqueville qui embarque pour rédiger un rapport sur le système carcéral américain, au moment où la citoyenneté des deux pays connait un moment charnière, voyage qui lui inspire De la démocratie en Amérique, dont le premier tome paraît en 1835. Certes elle progresse, et cette progression est commentée des deux côtés de l’Atlantique, mais elle reste aussi limitée comme l’analyse Yohanna Alimi-Levy : ainsi, l’électorat-fonction l’emporte sur la souveraineté populaire, le suffrage censitaire étant considéré comme le garant des libertés et protecteur contre les excès du peuple.
Cependant le suffrage censitaire est élargi pour les élections municipales, tandis que la liberté de la presse, bafouée sous et par Charles X s’impose peu à peu comme une liberté fondamentale. Du côté des États-Unis, Tocqueville estime la démocratie à un stade plus avancé qu’en France : pour lui c’est « le peuple qui gouverne ».
En effet, depuis le début du XIXème siècle, l’accès au vote est peu à peu révisé par les États, en 1828, le suffrage universel par bulletin (et non plus viva voce) l’emporte tandis que la presse devient incontournable. C’est dans ce contexte de la période jacksonienne que, cependant, les Noirs libres se voient retirer le droit de vote qui devient exclusifs aux seuls hommes blancs, alors que dans le même temps, la révolution de 1830 soulève l’enthousiasme des commentateurs américains et du pari démocrate et du Président Andrew Jackson.
Mais le mouvement des travailleurs, fondé à Philadelphie en 1827 et qui est sensible aux revendications des ouvriers français, similaires aux siennes n’est pas dupe des contradictions de ce dernier. En effet si le droit de vote est enfin acquis, non sans mal, ils estiment que les intérêts ne sont pas représentés par les partis et, à ce titre s’organisent dans le but de fonder une démocratie sociale où le peuple devient un acteur politique et social, ressenti et objectifs également présents en France à cette époque (et toujours d’actualité).