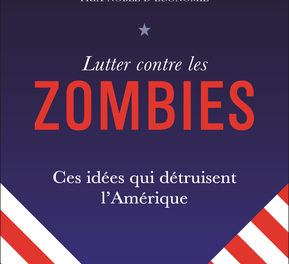Sébastien Ledoux est chercheur en histoire contemporaine, il travaille sur l’histoire du temps présent et en particulier sur les enjeux liés à la mémoire. Il a publié en 2016, Le devoir de mémoire. Une formule et son histoire, aux éditions du CNRS, ouvrage déjà passionnant. La difficulté ne semble pas le rebuter puisque dans son nouvel ouvrage, il étudie la mise en récit de la nation depuis les années 1970, à un moment où certains diffusent une version passéiste et passablement réactionnaire de l’histoire de notre beau pays. Pour lui, la nation et les « mises en récit successives de son histoire » sont des objets d’étude légitimes et « ne valent pas adhésion aux thèses nationalistes » (introduction).
Il distingue 5 temps depuis les années 1970, depuis l’après 1968 surtout.
Une histoire différente ?
Dans les années 1960-1970, le récit linéaire, progressiste et universaliste, diffusé par les historiens du 19ème, avec de grands hommes qui auraient bâti l’exceptionnalité de la France, se brise. La fin de l’empire colonial et en particulier la guerre d’Algérie débouche sur une réduction du territoire et de l’influence de la France et les exactions commises font douter du caractère civilisateur de la colonisation. De plus, dans les années 1970, le mythe résistancialiste s’effrite. Par ailleurs, de nouveaux vecteurs que l’école apparaissent. Ainsi, la télévision diffuse nombre d’émissions historiques ou de débats sur l’histoire.
Pensons aux mythiques Dossiers de l’écran. L’intérêt pour l’histoire de France se maintient mais investit de nouveaux domaines : le patrimoine, la mémoire populaire, la vie des gens ordinaires, les régions… et les figures héroïques tendent à être effacées. Les historiens participent à ce mouvement, c’est l’époque de Montaillou, village occitan, des Carnets de guerre de Louis Barthas… Contrairement à une idée reçue, l’histoire ne disparaît pas de l’école mais elle change. plus lentement cependant que ce que recommandaient alors les instructions officielles. Et la chronologie ne disparaît pas des cours réellement donnés aux enfant (p. 72).
Une crise de l’histoire ?
Au début des années 1980, « un consensus politique » se dégage « sur la crise de l’histoire et de l’identité nationale » (p. 75). Un leader d’opinion (Alain Decaux), un média prescripteur (Le Figaro magazine, du 20/10/1979) lancent une controverse « par un procédé de ‘scandalisation’ portant sur l’abandon de l’histoire nationale à l’école ». Le journal titre « Parents on n’apprend plus l’histoire à vos enfants ! » donnant naissance à un problème public qui devient politique. Méthode réutilisée depuis à de nombreuses reprises ! L’État doit agir. Commence alors le temps des rapports sur l’enseignement de l’histoire. Alors que sont introduites à l’école l’étude des mémoires, de l’immigration, le bicentenaire de la Révolution française permet de réaffirmer la vocation universaliste de la nation française et de l’État. Les historiens participent aussi de ce tournant narratif : Pierre Nora avec ses Lieux de mémoire, Fernand Braudel publie L’identité de la France, Suzanne Citron, Le mythe national …
Le temps du devoir de mémoire
De 1990 à 2007, l’auteur repère un « tournant narratif », le récit national est marqué par l’importance accordée au « devoir de mémoire ». Phénomène mondial qui touche aussi la France. Nombre d’émissions télévisées évoquent ce devoir censé permettre de dépasser les traumatismes des victimes ou de leurs descendants. « Le problème public statué n’est pas tant la disparition de l’histoire nationale […] qu’une mémoire nationale trouée faisant obstacle au bon fonctionnement de la société » (p. 118). Ces trous de mémoire sont liés à des violences, des crimes que la collectivité nationale aurait volontairement évacué. Évidemment la question du génocide juif est centrale au départ. Ces demandes de reconnaissance sont souvent portées par des associations de victimes ou de descendants de victimes et diffusées auprès de l’opinion par des livres, des films, des documentaires, des émissions TV…
La commémoration de la rafle du Vél’ d’Hiv’ et le discours de Jacques Chirac en 1995 inaugurent ce « tournant narratif ». Des descendants d’autres victimes prennent la parole, s’adressent aux pouvoirs publics et s’emparent du thème du devoir de mémoire : Français d’origine arménienne, descendants d’esclaves vivant aux Antilles ou en métropole, divers groupes ayant participé à la guerre d’Algérie aux mémoires différentes voire conflictuelles (appelés, pieds-noirs, harkis, enfants de l’immigration algérienne vivant en France).
L’État légifère avec des lois mémorielles qui ne font pas forcément consensus et sèment le trouble parmi les historiens. Le devoir de mémoire ne résoud pas miraculeusement les problèmes de la société française et n’empêche pas sa fragmentation. Certains cependant estiment que la nation est menacée par cet éclatement des mémoires et considèrent que cet intérêt pour les pages sombres de l’histoire nationale nuit à l’image de la France. D’où le retour de « récits identitaires de défense nationale » (p. 171) les années suivantes.
L’instrumentalisation politique du récit national
Entre 2007 et 2017, le récit national, l’histoire de France sont utilisés dans le débat politique. Pendant sa campagne électorale, Nicolas Sarkozy en fait un thème important de ses discours pour gagner des voix d’électeurs tentés par l’extrême-droite. Il évacue le thème du devoir de mémoire, s’affirme comme le défenseur d’une identité nationale qui serait menacée par le communautarisme, les ennemis de l’intérieur, les adeptes de ce qu’il appelle la « repentance ». L’histoire du pays basée sur l’action de grands hommes doit être source de fierté. En parallèle un certain nombre de journalistes (Lorant Deutsch, Éric Zemmour, Stéphane Bern…) accompagnent, avec succès, cette offensive dans les médias, tout en affirmant sur tous les tons et dans nombre de chaînes TV, de radios ou de journaux, qu’ils sont persécutés par la bien-pensance de gauche. Selon eux, l’école ne remplirait pas sa double mission : faire aimer la France et son histoire.
Ces discours « nostalgiques et déclinistes » (p. 188) privilégient les grands hommes, la période monarchique et insistent sur les racines chrétiennes de la France. L’auteur présente clairement les principaux axes de ce discours, on regrettera cependant qu’il n’explique pas pourquoi ces thèmes sont largement repris par une partie des médias. Mais c’était peut-être un autre livre…
Des historiens sont interpellés par ces discours et tentent d’y répondre en s’appuyant sur des connaissances scientifiques solides : Patrick Boucheron avec son Histoire mondiale de la France ou Michelle Zancarini-Fournel et Gérard Noiriel avec des histoires populaires de la France. Il n’est pas sûr que, malgré le succès de librairie du premier de ces ouvrages, ils recueillent un large assentiment dans l’opinion. François Hollande, élu en 2012, n’adopte pas le discours clivant de N. Sarkozy. Il tente de rassembler en rendant hommage aux victimes du 17 octobre 1961 sans faire acte de repentance et en panthéonisant des héroïnes et des héros de la Résistance.
Le récit national depuis les attentats de 2015
Les attentats de 2015 changent la donne. Les victimes des attentats meurtriers sont présentées comme des héros et les références à la guerre sont fréquentes. En 2017, lors des élections présidentielles, la droite et l’extrême-droite reprennent un discours clivant. Emmanuel Macron est plus nuancé. Il évoque l’histoire millénaire de la France, les grands hommes et plus particulièrement les monarques ainsi que l’importance de la langue française dans la construction de l’unité nationale. Pour lui, la mise en récit de la nation a pour but de favoriser un redressement national. Il ne nie pas cependant les fautes commises lors de la période coloniale mais entend dépasser les ressassements et les clivages (p. 251-252). En parallèle, l’offensive de penseurs traditionnalistes voire réactionnaires se poursuit.
Cent fois sur le métier remettre (et renouveler) son ouvrage ?
Le dernier chapitre, « (Re) Commencer ? Devenirs du récit national », tente de répondre à la question de la construction d’une histoire nationale alors que la société se sent vulnérable, est de plus en plus diversifiée et marquée par l’individualisme. L’auteur présente les limites et les effets involontaires du devoir de mémoire et propose des pistes de réflexion afin d’éviter l’instrumentalisation de l’histoire. Il rappelle l’importance pour y parvenir de la paix et de la justice sociale et plaide pour ce qu’il appelle une « narration inachevée des biens communs de l’histoire nationale ».
Construire une histoire sans nostalgie ni finalisme qui montre les combats d’hommes et de femmes très divers, dont des immigrés, en faveur de biens communs (liberté, égalité, justice sociale). Cette histoire devrait aussi évoquer les limites de leur action ainsi que ce qu’il reste à conquérir et ne pas éluder le caractère discontinu de ces combats avec les périodes de recul des droits que furent le rétablissement de l’esclavage ou le régime de Vichy…
Un livre dense, très riche, sur un sujet d’une brûlante actualité et qui aide à mieux comprendre les évolutions du récit national depuis 50 ans.