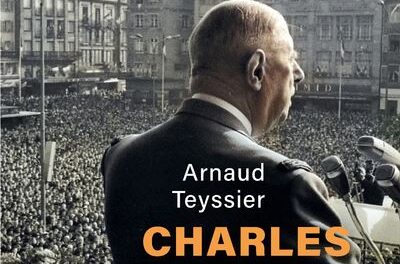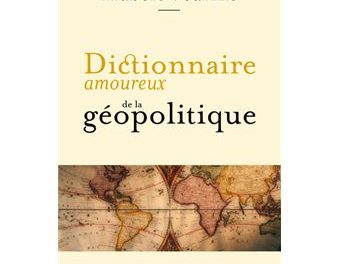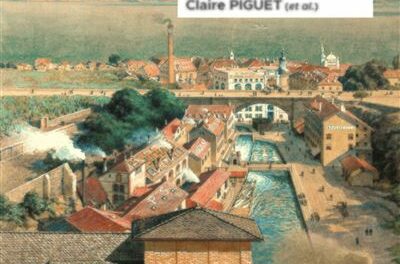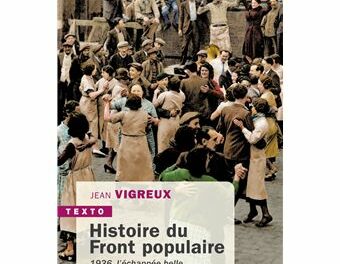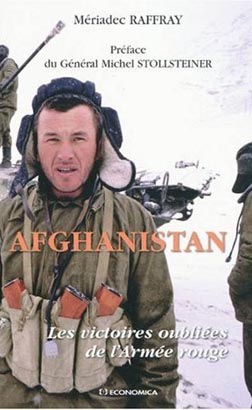
Les études de défense qui alimentent avec profusion le milieu des décideurs civilo-militaires anglo-saxons constituent un genre beaucoup plus rare et confidentiel dans la production intellectuelle française. L’intervention américaine en Irak et l’implication française en Afghanistan, marquée par la tragédie d’Uzbin, ont cependant suscité un certain élan éditorial. Citons, parmi les publications les plus marquantes, la redécouverte du théoricien militaire français David Galula, promu l’un des maîtres à penser de la doctrine opérationnelle américaine actuelle, les travaux de Michel Goya, qui s’affirme comme un des penseurs les plus pertinents des formes contemporaines de la guerre, ou encore l’essai récent sur la Guerre en montagne : renouveau tactique (2006) élaboré par trois colonels en résonance avec la participation française à la guerre en Afghanistan. C’est dans ce sillage que s’inscrit la courte et claire synthèse de Médéric Raffray. La facture tout à la fois accessible et technique du propos porte la marque de la double casquette de l’auteur, journaliste et officier de réserve.
Le jour de Noël 1979, la 40e armée soviétique envahit l’Afghanistan en application du «plan Chtorm 333». Son irruption prend le visage d’une opération de secours en faveur d’un régime frère en voie d’effondrement dans la guerre civile, mais répond aussi à des mobiles de stratégie régionale et mondiale face à une superpuissance américaine alors diminuée par l’humiliation de la prise d’otages de son ambassade à Téhéran. Cet engagement militaire s’effectue selon des normes inadaptées aux réalités afghanes, dont la complexité mouvante reste obstinément réfractaire au matérialisme dialectique. Corsetée dans les doctrines d’emploi victorieuses issues de la Seconde Guerre Mondiale et formatée pour une confrontation mécanisée dans la Trouée de Fulda, la troupe engagée est impropre à la guerre insurrectionnelle en milieu montagneux qui l’attend. Les déconvenues des méthodes classiques de combat, face à des insurgés agiles et rustiques dont les modes d’émergence et d’organisation sont dépeints avec clarté, font évoluer l’Armée Rouge. Démentant son image de monolithisme, celle-ci s’adapte aux réalités du terrain, en s’inspirant notamment de l’expertise tactique des camarades vietnamiens, conviés sur le terrain en voyage d’étude afin de partager les bonnes pratiques de leurs succès asiatiques contre les Français et les Américains…
A partir de 1981, la 40e armée se segmente en deux entités répondant à une double vocation : le contrôle statique de l’Afghanistan utile par des «îlots rouges», et l’impact dynamique des «marteaux pilons» chargés de porter l’insécurité dans les zones contrôlées par la rébellion. En combinant évolutions tactiques, innovations techniques et créativité opérationnelle, la grande machine de l’Armée Rouge échappe à l’enlisement. Les blindés lourds, peu utiles, sont renvoyés en URSS. La guerre des mines et des hélicoptères prend une ampleur massive. Les forces spéciales autonomes et manoeuvrières des «Spetsnaz», qui représentent 5% de l’effectif de la 40e armée, réalisent 40% de ses résultats, et expérimentent même des opérations de pacification civilo-militaires au service du gouvernement communiste afghan. Les coups de pouce de la CIA et du Pakistan en faveur de la résistance n’inversent pas la donne, et l’effet de l’arrivée des redoutables missiles Stinger sur le théâtre afghan, à partir de 1986, a été surestimé.
Même si ce conflit extérieur a été vécu par la société soviétique avec une souffrance dont a témoigné un livre émouvant de Svetlana Alexievitch, Les cercueils de zinc (1990), le retrait soviétique final n’est pas dû à la pression militaire de la résistance afghane, mais à la déliquescence du modèle soviétique en voie d’implosion. Le fait est que l’Armée Rouge se retire en 1989 invaincue et la tête haute. En vérité, l’Afghanistan n’a jamais été plus pour elle qu’un conflit de faible intensité : les effectifs engagés par la 40e armée n’ont guère excédé une centaine de milliers d’hommes. Si, par le jeu des relèves, 620 000 hommes ont servi en Afghanistan, seulement 26 000 (soit 4%) y sont morts (au combat, mais aussi par accident ou de maladie). Le bilan est infiniment plus tragique pour le peuple afghan, auquel ces dix ans de martyre ont coûté un million de morts et cinq millions de réfugiés. En outre, le départ de l’ennemi commun brise l’unité de ses adversaires. Dans le chaos qui en résulte, le régime prosoviétique se survit encore trois ans. La guerre civile et l’anarchie préparent l’avènement des taliban. Jusqu’à un certain 11 septembre…
Médéric Raffray donne ainsi de la profondeur et de la perspective aux antécédents d’un des conflits les plus incertains et les plus cruciaux du monde contemporainEn complément, il propose aussi deux témoignages émanant du chef résistant afghan Amin Wardak et de l’aventurier français Patrick Franceschi, qui s’engagea militairement à ses côtés. D’un intérêt propre assez limité, ils donnent lieu à quelques préconisations de l’auteur sur la conduite de l’actuelle intervention en Afghanistan.. Exercice de vulgarisation réussi, d’une lecture rapide et d’un contenu très accessible, son exposé peut nourrir utilement les problématiques des programmes actuels – et semble-t-il futurs – de Terminale. Malgré le commandant Massoud, l’Afghanistan n’a donc pas été le Vietnam de l’URSS. Encore faut-il qu’il ne soit pas non plus celui de l’OTAN.