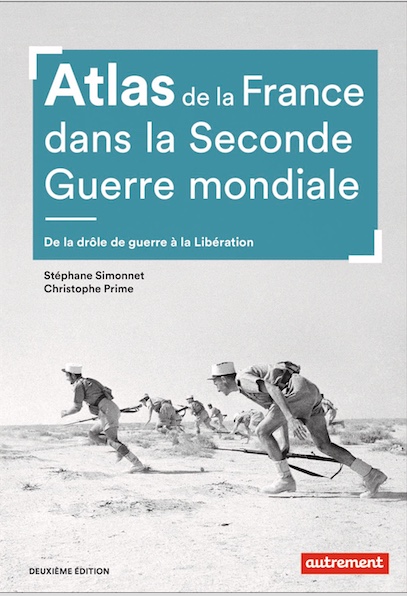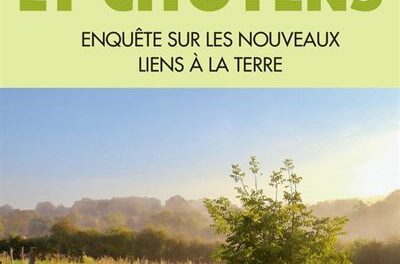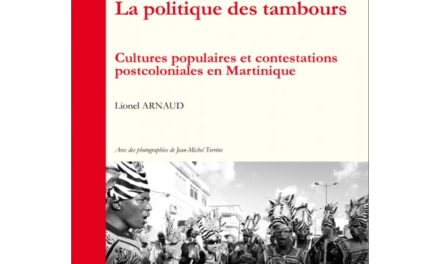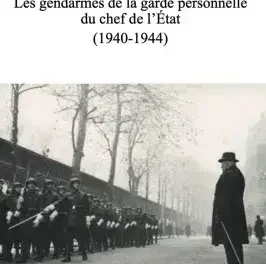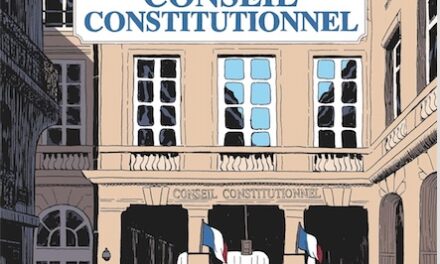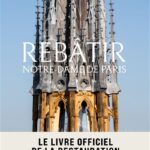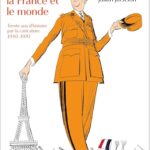Cet ouvrage est paru une première fois en 2015. Il est structuré en quatre parties. Les auteurs rappellent dans l’introduction que l’armée française a été balayée en six semaines malgré de sérieux combats dans le Nord et sur la Somme. « De la drôle de guerre à la Libération, fruit de dissolution, de fusion et d’amalgames successifs, l’armée française ne fut pas une mais multiple ».
Les auteurs
Stéphane Simonnet est historien et directeur scientifique du Mémorial de Caen. Il a notamment écrit une biographie de Philippe Kieffer. Christophe Prime est historien et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Responsable des collections au Mémorial de Caen, il a notamment écrit « La bataille du Cotentin ».
La guerre de 39-40
La production pour la guerre augmenta en France mais resta insuffisante par rapport aux besoins. La France a une bonne artillerie et d’excellents blindés, mais son aviation n’est pas à la hauteur. Les auteurs détaillent plusieurs opérations de cette première phase de la guerre comme la campagne de Norvège d’avril à juin 1940. Lors de la bataille du Nord, près de 500 000 militaires et 80 000 civils se retrouvent encerclés dans le secteur de Dunkerque. Les pertes humaines sont lourdes avec 60 000 pertes pour les Alliés et presque autant pour les Allemands. On trouve également une carte sur l’invasion de la France entre le 5 et 25 juin 1940. Le bilan de la campagne est le suivant : 60 000 soldats français tués et 120 000 blessés. 1 850 000 soldats français sont faits prisonniers. Le pays est meurtri et traumatisé comme le montre, notamment, une carte de l’exode des populations. D’autres cartes très utiles montrent le découpage de la France en plusieurs zones.
Des combats sur tous les fronts
Cette partie évoque notamment les guerres franco-françaises qui se déroulent en Afrique entre août et novembre 1940. Un encart est spécifiquement consacré à l’expédition de Dakar en septembre 1940. Cet échec pour De Gaulle creuse durablement le fossé établi entre la France Libre et la puissance américaine. Cependant, en ralliant l’AEF à sa cause, le général De Gaulle prend une nouvelle stature. Les auteurs évoquent aussi les combats de Vichy contre les Anglo-Américains. Après la victoire d’El Alamein et le débarquement des troupes anglo- américaines au Maroc et en Algérie, les FFL et l’armée d’Afrique du Nord du général Giraud sont engagées en Tunisie. Leur faiblesse numérique les cantonne à jouer les seconds rôles. Le chapitre se poursuit avec la libération de la Corse. Les auteurs rappellent que les forces armées françaises ne disparaissent pas totalement au lendemain des armistices de juin 1940. Les Allemands ont compris qu’il était dans leur intérêt de maintenir le nouvel Etat français en capacité de se défendre contre des attaques de résistants. La partie se termine sur la lutte contre les maquis et parle également des camps d’internement et de transit.
L’action de la Résistance en métropole
Le BCRA est le moteur de l’action clandestine. Il est censé imposer l’autorité de de Gaulle auprès des résistants, tout en faisant respecter la souveraineté nationale par les Alliés. Stéphane Simonnet et Christophe Prime évoquent ensuite les mouvements et les réseaux et détaillent le cas du réseau Alliance. Il regroupe 3 000 personnes dont un quart de femmes. Une double page sur l’unification de la Résistance propose une carte avec le parcours de Jean Moulin. Elle pourrait être utilisée pour faire raconter son parcours. Le drame du maquis des Glières est abordé. Pour la Résistance, le combat des Glières est certes une défaite des armes, mais aussi une importante victoire d’un point de vue psychologique et symbolique. Cela fait prendre conscience aux responsables du BCRA des dangers d’une insurrection prématurée pouvant exposer les maquis à une terrible répression. Le rôle de la Résistance au moment du Débarquement est aussi l’objet d’une double page.
La libération du territoire juin 1944-mai 1945
Le chapitre évoque à la fois le cas de la Normandie et de la Bretagne. Dans ce dernier cas, et afin de consolider la tête de pont créée en Normandie, les Alliés concentrent leur attention sur la résistance bretonne qui doit fixer les 150 000 soldats allemands stationnés dans la région. L’atlas continue avec la libération de Paris. Il faut rappeler que le fait que la capitale n’ait pas été détruite est une immense victoire. Le coût humain est de 1 000 morts et de 1500 blessés chez les FFI, de 600 morts chez les civils et de 130 dans les rangs de la 2ème DB. L’ouvrage s’arrête ensuite sur la débarquement en Provence, la prise de Marseille ou la conquête des ports sans oublier la campagne d’Alsace.
Cet atlas pourra servir notamment pour traiter certains points de passage et d’ouverture du programme de Terminale comme « Juin 1940 en France : arrêter ou continuer la guerre » ou encore « De Gaulle et la France libre » ainsi que « juin 1944 le débarquement en Normandie » qu’il faudra alors compléter pour la partie Bagration.