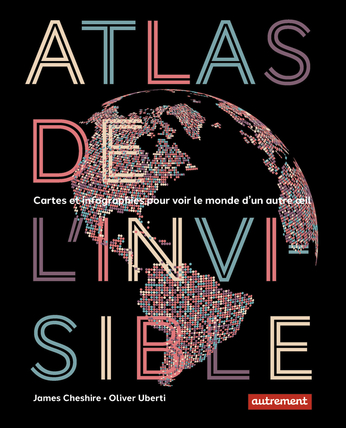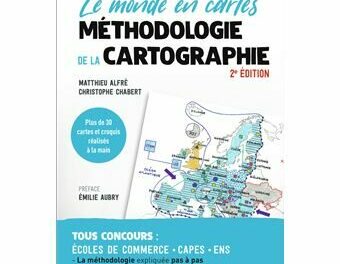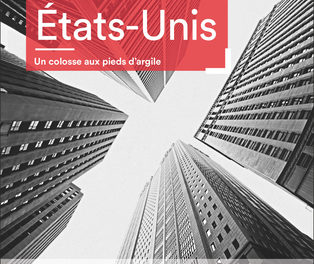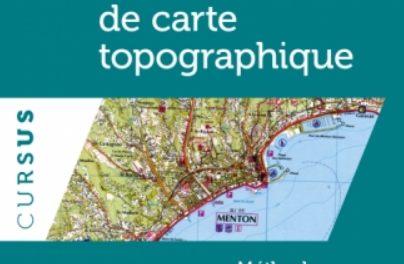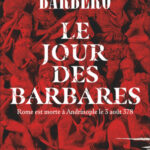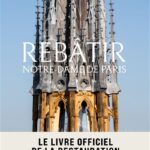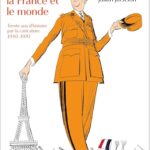James CHESHIRE est professeur de géographie et de cartographie à l’University College de Londres. Oliver UBERTI est designer. Dans cet atlas, ils nous proposent une soixantaine de cartes avec pour objectif de nous ouvrir « les yeux sur le monde d’aujourd’hui et de demain ». Elles sont complétées par des textes, traduits par Laurent CANTAGREL et Martine SGARD, qui ouvrent chacune des parties : D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Comment allons-nous ? Où allons-nous ?
Pendant des siècles, les atlas représentaient en effet ce que les gens pouvaient voir autour d’eux : des routes, des rivières, des montagnes. Aujourd’hui, nous avons besoin de représentations graphiques révélant les modèles invisibles qui façonnent nos vies. « L’Atlas de l’invisible est une ode à ce que l’on ne voit pas, à un monde d’informations que l’on ne peut pas transmettre uniquement par des textes ou des chiffres ». On le peut aujourd’hui grâce à la révolution numérique qui, dès le début des années 1960, nous permet plus rapidement et plus facilement de représenter (carto-)graphiquement des informations de plus en plus nombreuses, variées et diffuses. « A chaque seconde, les données du monde entier s’accumulent en un écheveau toujours plus grand. » L’objectif est donc principalement de rendre visibles des schémas ou des tendances, et non des lieux.
Le début de l’atlas est consacré à l’analyse et à la visualisation d’ensembles de données qui remettent en question certains mythes concernant notre passé, notamment ceux concernant la façon dont les humains se sont déplacés à travers le monde. On est surtout ému par la carte sensible de WESTERVELD (p.32-35) retraçant les trajets des survivants de la Shoah : Jacob BRODMAN et Anna PATIPA. « Pour chaque lieu évoqué, il a dessiné un cercle ou une tache de taille proportionnelle à celle de ce lieu par rapport aux autres (échelle relative) et dont l’opacité correspondait à la fréquence avec laquelle ce lieu était mentionné (c’est-à-dire son importance dans le récit du témoin) ». De même, les représentations schématiques de la traite négrière transatlantique (p.48-51) sont un moyen de mieux représenter les flux entre régions d’embarquement et de débarquement et de rendre hommage à « ces millions de personnes dont nous n’entendrons jamais l’histoire ».
Ensuite, plusieurs cartes nous montrent en quoi l’afflux de données nous venant des téléphones mobiles ou des satellites et les modélisations informatiques nous renseignent sur ce que nous sommes, individus ou sociétés, des fois bien plus que de bons vieux recensements de populations. Ainsi elles ont permis de repérer les lieux où la population avait diminué après le passage de l’ouragan Maria à Porto Rico (p.70-71) et de mesurer approximativement les transferts de population vers la Floride. Les géographes Garrett NELSON et Alasdair RAE (p.72-75) proposent de leur côté de redéfinir les frontières des Etats américains en se basant sur les déplacements pendulaires de leurs habitants. On peut aussi représenter la révolution des deux-roues (p.88-89) par un graphique combinant le nombre de vélos en libre-service dans une métropole et le nombre de trajets effectués chaque jour. S’opposent alors Auckland en Nouvelle-Zélande et Rio de Janeiro au Brésil.
Par ailleurs, les cartes peuvent être une grande alliée de la démocratie, révélant les inégalités voire les exclusions. Des cartes à différentes échelles ou des schémas peuvent nous montrer les émissions de gaz à effet de serre des avions (p.112-115), la pollution atmosphérique due aux déplacements ou à l’industrie en Europe (p.116-117), la gentrification de certains quartiers et donc le déménagement d’habitants à New York (p.126-127) ou même les inégalités des tâches ménagères (p.130-131). Mais « elles ne suffisent pas à faire cesser les injustices ».
Autre thème dont nous sommes de plus en plus témoin : le réchauffement climatique. « Il influence tout, depuis les ouragans jusqu’au pèlerinage à La Mecque ». Le monde se réchauffe globalement d’année en année mais une comparaison de cartes de 1890 à 2019 (p.153-157) montre que ce phénomène n’est pas uniforme. A ce point que le risque encouru par les pèlerins de La Mecque en 2044-2051 et 2075-2083 – les années où le hajj a lieu pendant les mois chauds – sera très élevé avec des températures avoisinant les 50°C (p.158-159). Là encore les incendies (p.160-161), l’augmentation de la température marine (p.162-163), la fonte du champ de glace de Juneau aux Etats-Unis (p.164-165) ou l’élévation du niveau de la mer (p.168-169) peuvent être cartographiés, rendant l’invisible visible, mêmes pour les plus sceptiques. Davantage que « lanceuses d’alertes », ces cartes doivent d’abord être des aides à la décision.
Cet altas est d’abord une source d’émerveillement devant les capacités infinies permises par la collecte et le traitement des données. Les représentations utilisées sont souvent originales, mais toujours avec l’objectif de la clarté au service de l’information. Les changements d’échelles, parfois sur des double-pages, sont particulièrement pertinents : ce qui ne se voit pas à une certaine échelle peut se voir sur une autre, ou différemment. Toutefois, l’auteur conclut sur l’importance de la gestion de ces données qui, par leurs représentations graphiques, peuvent constituer une aide à la décision au-delà d’un simple constat. Mais la pandémie du Covid-19 montre également qu’une sur-collecte de données infiniment personnelles (notamment médicales) par les gouvernements, particulièrement dans les pays asiatiques, peut être une source de danger et une menace, celle-ci, bien visible.
CR de Nicolas Prévost
______________________________________________________________________________
CR de Jean-Pierre Costille
Cet ouvrage montre des représentations graphiques révélatrices de ce que les données peuvent nous dire. « L’atlas de l’invisible est donc une ode à ce qu’on ne voit pas, à un monde d’informations que l’on ne peut pas transmettre uniquement par des textes ou des chiffres ».
Après avoir donné quelques repères sur l’histoire de la cartographie, James Cheshire et Olivier Uberti proposent des visualisations qui nous donnent le pouvoir de prendre de la distance, de comparer, de nous souvenir. Bref, il s’agit de voir le monde sous un jour nouveau. Le livre est structuré en quatre parties et offre un véritable plaisir de lecture.
D’où venons-nous ?
Les auteurs évoquent la question de la localisation des vagabonds au XVIII ème siècle et se demande si nous n’avons donc rien appris de cette période par rapport à aujourd’hui ? La relocalisation ne met pas fin à l’existence des sans-abri, elle ne fait qu’empêcher de les voir. Le livre propose aussi une façon originale de représenter les camps et le destin de quelques témoins durant la Seconde guerre mondiale. En effet, l’idée centrale est de dire que nos souvenirs ne coïncident pas toujours avec l’espace géographique. Il faut donc envisager d’autres façons de représenter ce qui s’est alors passé pour chacun d’entre eux. Le livre propose une double page qui traduit cette idée. Un article est également consacré puis on découvre une très intéressante visualisation des traites négrières qui montre, entre autres, l’importance du Brésil. Sur un point plus léger, les auteurs s’arrêtent sur l’âge des génies.
Qui sommes-nous ?
Une entrée est consacrée à l’importance du recensement aux Etats-Unis. Compter la population pour fixer et distribuer le nombre de sièges au Congrès était à l’origine une idée révolutionnaire. On voit quelques exemples étonnants de découpage des circonscriptions. On découvre des informations inattendues. Ainsi, aux Etats-Unis, il existe 4 millions de va-et-vient quotidiens entre les états américains et on s’aperçoit que ces mouvements ignorent complètement les frontières officielles. Une autre représentation graphique originale montre la diversité d’utilisation du vélo dans différentes villes à travers le monde. Le chapitre se termine par une visualisation sur les câbles sous-marins. A la vitesse fulgurante de 200 térabits par seconde, le câble le plus rapide du monde pourrait transférer des Etats-Unis à l’Espagne l’ensemble des 280 millions de disques vendus par les Beatles dans le temps qu’il faut pour lire cette phrase.
Comment allons-nous ?
Bruno Latour a comparé le pouvoir d’une carte à » la manière dont quelqu’un convainc quelqu’un d’autre d’adopter un énoncé et de le transmettre pour qu’il se transforme en fait ». Les auteurs rappellent le rôle de Du Bois dans la représentation des Noirs. Il fut un pionnier de la sociologie afro-américaine et un défenseur des droits civiques. Sur des périodes plus récentes, on constate que le développement des données ouvertes offre une mine inépuisable d’histoires à exploiter. En 2019, une application a servi aux habitants de Hong-Kong à se rassembler pour manifester. Le but était de les aider à réagir aux mouvements de la police. Dans un autre domaine, un article montre combien le monde est plus ou moins ouvert selon le passeport que l’on possède. L’Afghanistan se trouve tout en bas de l’échelle : il n’autorise aucun citoyen étranger à entrer sans visa et son passeport n’est valable que pour voyager trente jours. Les auteurs proposent également le cas de Taïwan qui a mis en place une police de l’air. On a encore d’autres cartes étonnantes comme celles qui révèlent des opérations de la guerre du Vietnam grâce à une mine de dossiers déclassifiés.
Où allons-nous ?
Cette partie commence par des informations sur la météorologie. En 1961, le présentateur put pour la première fois montrer en direct à la télévision l’oeil d’un ouragan. Aujourd’hui, le traçage des navires de pêche peut permettre de révéler des activités illégales. Les satellites font désormais partie des moyens utilisés pour les premiers secours comme le montre l’exemple d’un séisme en 2018. Grâce aux images avant-après cela a permis de mesurer l’ampleur des déplacements de terrain. Ainsi, on peut mieux cibler les zones sur lesquelles intervenir prioritairement. Facebook veut numériser toutes les routes de la planète. Chaque mois, 40 000 contributeurs s’inscrivent sur Openstreet map pour cartographier leur quartier par exemple.
Epilogue
Il est fondamental de mesurer que les données nous permettent d’améliorer notre compréhension du monde. Les auteurs reviennent sur la période du covid et développent l’exemple de la politique menée par la Corée du sud. La question de la préservation de la vie privée se pose et se posera toujours plus. Chacun doit être conscient qu’il crée des miettes numériques par ses activités quotidiennes. Le livre prend le temps de décortiquer l’exemple d’un tweet et montre combien de données il contient. Le livre se termine par quelques pages sur les projections cartographiques.
Cet ouvrage propose une approche qui renouvelle la cartographie. Les données sélectionnées permettent d’établir de nouvelles représentations. Stimulant et agréable visuellement, voilà en tout cas un atlas qui rend bien visible ce qui jusqu’alors était invisible. Pari réussi et plaisir de lecture garanti.