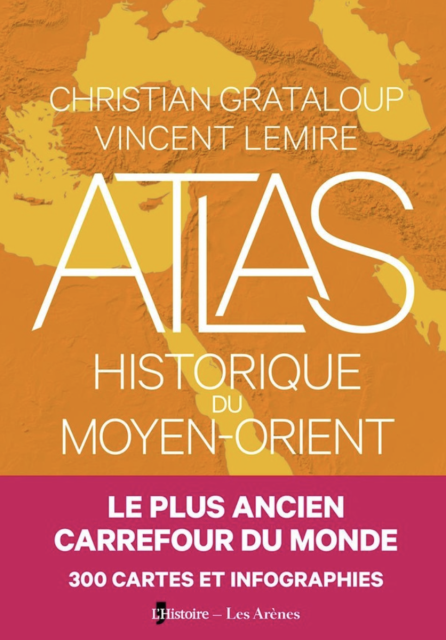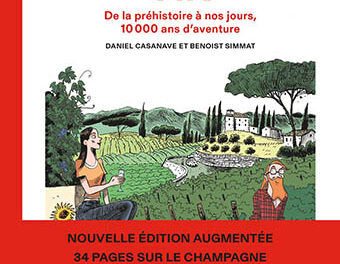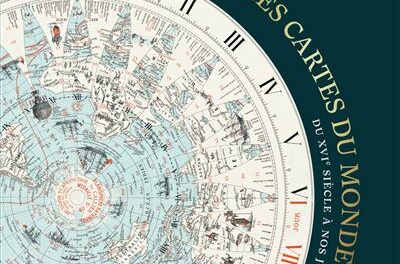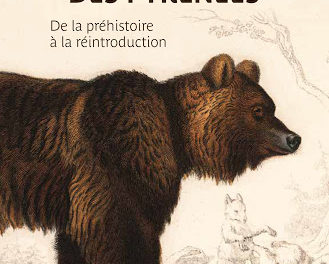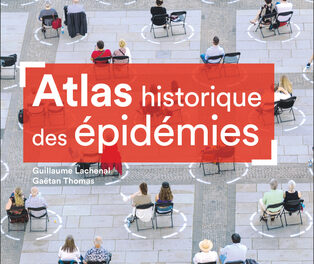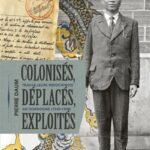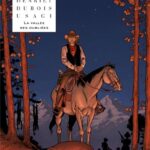Le Moyen-Orient, « un lieu du monde » comme l’écrivent Christian Grataloup et Vincent Lemire dans leur préface, incarne l’histoire des hommes dans un espace géographique dont la plasticité repousse les limites parfois jusqu’aux steppes asiatiques. Difficile à nommer, sa centralité en fait un carrefour particulièrement ancien, parcouru et à maintes reprises conquis. Les temps de lutte et de domination s’y succèdent inexorablement. Enjeux des empires et des puissances, plus que jamais point chaud du globe au XXIe siècle, le Moyen-Orient a une longue histoire que les cartes dessinées par Héloïse Kolebra permettent d’appréhender au mieux.
Le plus ancien carrefour du monde
Observer le Moyen-Orient avant notre ère, c’est regarder les hommes qui se redressent et se construisent. Berceau des civilisations, il les accueille à leur sortie de l’Afrique. La sédentarisation, la domestication des animaux, la pratique des semences y ont laissé des traces. Les usages multiples des plantes, le savoir-faire du four permettent aussi l’épanouissement de véritables sociétés organisées et marchandes. Les premières grandes villes donnent naissance à de véritables empires. Ces derniers, rapidement, diffusent leurs savoirs et principaux traits culturels par la conquête et l’implantation de colonies.
Le Nil devient alors l’axe principal de la région : la Nubie puissante et l’Égypte pharaonique développent des civilisations exceptionnelles par la maîtrise du fleuve. L’eau permet la vie dans cet espace aride. Les rivalités de puissances voisines se succèdent inéluctablement. La bataille de Qadesh (1274 avant notre ère) où les Hittites venus du nord et les hommes de Ramsès II s’affrontent est le plus ancien de combat dont le récit est parvenu jusqu’à nous. À toute époque, le Moyen-Orient voit se multiplier les guerres entre puissances conquérantes : le contrôler, c’est dominer. L’unifier, c’est laisser une empreinte dans l’Histoire.
Empires et monothéismes
L’empire perse (VIe-Ve s. av. n. è.) repousse toujours plus loin ses confins par une stratégie d’expansion centralisée. C’est avec lui que se dessine un Moyen-Orient double : celui qui se tourne vers l’Occident et celui qui regarde vers l’Asie centrale et, même plus loin encore. Alexandre Le Grand réussit, par la fondation de villes du Caucase à la Méditerranée, une créolisation de la région. Sa postérité va bien au-delà des limites géographiques de sa présence : des griots d’Afrique aux principautés javanaises. Le Moyen-Orient est encore plus vaste que sa réalité territoriale.
Le christianisme né à Jérusalem et la législation de l’empereur Justinien (527-565) se propagent en Occident. Ce véritable carrefour commercial est devenu la plaque tournante entre l’Océan indien et la Méditerranée. Le site stratégique de Constantinople s’épanouit sur le Bosphore. À partir du VIIIe siècle, l’Islam et les conquêtes arabes stabilisent de manière inédite la région. Vaste territoire de l’Espagne aux bastions sous influence chinoise, seul le fragile empire byzantin reste un verrou méditerranéen. La rupture de 1096 et de la Première Croisade va replonger pour des siècles où les États latins d’Orient servent de base arrière à l’Occident.
Turcs et Mongols : la mondialisation des steppes
Objet de toutes les convoitises, le Moyen-Orient voit déferler des peuples lointains. Les troupes mongoles particulièrement mobiles et conquérantes sous Gengis Khan offrent à celui-ci « le plus grand empire du monde« . Présenté comme le souverain universel, il règne de la péninsule de Kyoto à Zagreb qui tombe en 1241. Digne successeur, Timour – Tamerlan – né dans l’actuel Ouzbékistan, marque à jamais l’Asie Centrale et propage l’Islam dans la région à la fin du XIVe.
De leur entrée dans Bagdad en 1055 à la défaite de 1243 face aux Mongols, les premiers empires turcs écrivent l’histoire naissante de ce peuple dans la région. Diminués par le sultanat mamelouk, les Ottomans enchaînent les victoires après la prise de Constantinople (1453). À la suite de la défaite de Soliman le Magnifique devant Vienne en 1532, l’empire ottoman décline lentement. Incapable de contrôler ses périphéries « l’homme malade » comme l’appelle le tsar Nicolas perd en 1830 la Grèce et l’Algérie.
Sous la pression de l’Occident
Les rivalités européennes transforment à partir du début du XIXe siècle la région en un nouveau champ de bataille. Pas moins de 35 000 et 35 navires permettent à Bonaparte de mener la campagne d’Egypte en 1799. Rapidement, les Égyptiens et les Ottomans en profitent pour s’affranchir de tutelles pesantes et restaurer leur prestige passé. Cependant, à l’image de la crise de Fachoda en 1898, du démembrement de l’empire perse en 1907 ou de la construction du canal de Suez (1869), les Européens investissent le Moyen-Orient à leur profit.
La Première Guerre mondiale née dans les Balkans voisins se diffuse rapidement de l’autre côté de la Méditerranée. Seul territoire désertique de la Grande Guerre, des troupes mobiles s’affrontent quand, ailleurs, elles creusent des tranchées. L’engagement ottoman du côté des Empires Centraux donne naissance à la Turquie moderne. Le génocide des Arméniens que les auteurs de l’Atlas éclairent par une carte remarquable, la déclaration Balfour (1917) en faveur d’un foyer juif en Palestine sont autant d’échos de la Guerre qui résonnent encore.
Au coeur de la géopolitique mondiale
Si l’eau est un instrument géopolitique régional ancestral, le pétrole dessine un nouveau visage du Moyen-Orient. Les jeunes dynasties qui se sont installées en Arabie Saoudite et en Iran voient leur richesse exploitée par des compagnies étrangères. Source de conflits, c’est aussi une arme et une manne financière exceptionnelle que surveillent les grandes puissances. La nationalisation du Canal de Suez en 1956, la révolution islamique iranienne en 1979 relancent les tensions au-delà de la région.
Cependant, c’est sur une mince bande de terre à l’échelle du Moyen-Orient que se tournent les regards du monde. À partir de 1917, les implantations juives sont en augmentation sous l’administration britannique. La naissance de l’État d’Israël le 14 mai 1948 embrase la région pour des décennies. Le fragile espoir de paix des Accords d’Oslo (1993-1995) face à « la paix sabotée » ainsi que l’écrivent Christian Grataloup et Vincent Lemire. Les opposants à la solution à deux États dominent en ce début de XXIe siècle. À nouveau, les attentats et la guerre font des ravages depuis le 7 octobre 2023.
Christian Grataloup et Vincent Lemire ainsi que les nombreux contributeurs qui ont participé à l’écriture de l' » Atlas historique du Moyen-Orient » inscrivent cette région du globe dans le temps long en un seul ouvrage. Les remarquables cartes de Héloïse Kolebka produites par l’atelier Légendes Cartographie donnent la mesure en une double page de la géométrie variable et les enjeux de ce territoire. Au-delà des empires, l’écriture, le Déluge, l’astronomie, les étapes du pèlerinage à la Mecque, la géopolitique de l’eau (…) trouvent aussi place dans cet atlas. L’ouvrage s’achève par une carte intitulée » Le Moyen-Orient d’aujourd’hui et demain » qui ne peut qu’interpeller chaque lecteur. Un atlas historique incontournable pour comprendre la complexité de cette mosaïque.