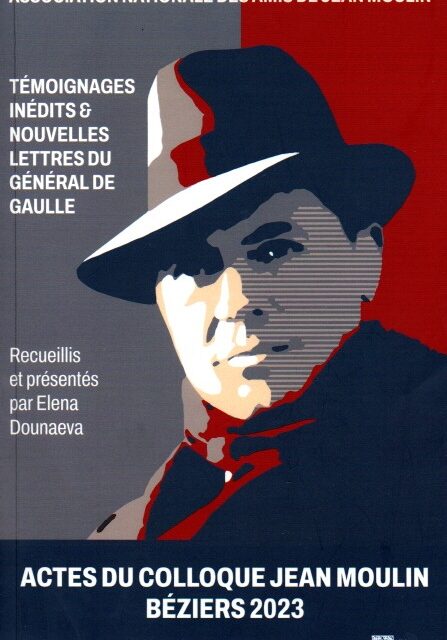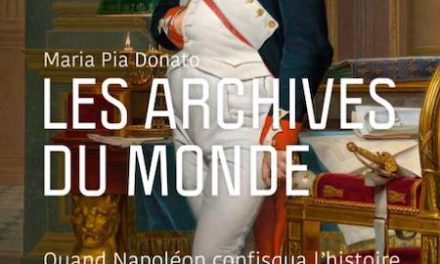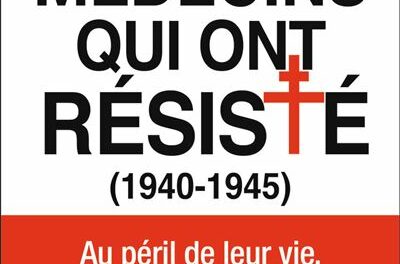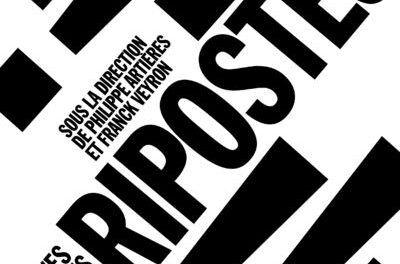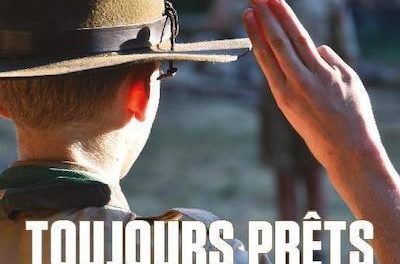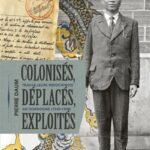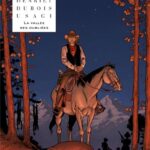En mai 2023, à Béziers, ville natale de Jean Moulin, à l’occasion du 80e anniversaire de sa disparition, l’Association nationale des Amis de Jean Moulin, avec le concours de la ville de Béziers, de la famille de Jean Moulin, de la Fondation Charles de Gaulle, a organisé un colloque consacré à Jean Moulin. Tout n’a-t-il pas déjà été dit et écrit sur l’unificateur de la Résistance ? On aurait tort de le croire. D‘abord parce qu’il s’est agi d’un colloque atypique : Il s’est en effet déroulé dans le cadre de la semaine Jean Moulin et « pendant une semaine se sont succédés les meilleurs spécialistes : historiens français et étrangers, conservateurs d’archives et de musées, enfants de résistants et membres des familles de Gaulle et Moulin ». Ensuite parce que ce sont des actes de colloque atypiques : d’une part parce qu’ils sont enrichis de nombreuses illustrations de grande utilité et de photographies ; d’autre part, parce qu’aux communications savantes qui habituellement composent à elles seules les actes d’un colloque, s’ajoutent plusieurs témoignages inédits qui enrichissent notre connaissance de l’entourage proche de Jean Moulin dans la Résistance, et d’une vingtaine de lettres inédites du général de Gaulle
Plusieurs communications portent sur Jean Moulin
Celle de Bénédicte Vergez-Chaignon (historienne de la Résistance et de l’Occupation, biographe de Pétain et de Jean Moulin) porte sur Jean Moulin artiste : elle présente et commente quelques aquarelles, huiles, eaux-fortes et caricatures, qui « révèlent un homme au regard à la foi sensible et lucide ».
Jean Moulin a toujours dessiné, dès la petite enfance. Il publie à 16 ans des dessins de guerre dans la presse nationale. A 20 ans, il dessine pour des revues étudiantes « avec une légèreté qui lui fait adopter le pseudonyme de Juanito et signer ses dessins de ses seules initiales ». En 1922, il choisit le pseudonyme de Romanin, et le garda toute sa vie d’artiste. Pendant ses congés, il séjourne dans le quartier de Montparnasse, fréquente les peintres, court les galeries et les expositions, s’exerce d’après modèle dans les académies. Il a bientôt ses entrées dans plusieurs journaux satiriques ou des magazines d’actualité culturelle. « Il est connu et reconnu, exposant aussi au salon des humoristes. » En poste à Châteaulin, il fait la connaissance de Max Jacob, affine ses goûts esthétiques, s’ouvre à l’art moderne et apprend de nouvelles techniques, comme la gravure, les eaux-fortes, la céramique.
Il délaisse le dessin de presse, se tourne vers le dessin d’illustration des textes littéraires. Il s’intéresse au poète Breton Tristan Corbière, mort à 28 ans. Il illustre d’eaux-fortes un de ses recueils de poèmes. Il commence sa propre collection de peintures et de dessins, « au gré de ses coups de cœur et de ses moyens financiers ». Admirateur de l’impressionnisme et en particulier de la sensualité de Renoir, il privilégie néanmoins l’art moderne, avec un goût marqué pour les nus féminins et les paysages. Il fait quelques caricatures antifascistes et les derniers dessins de Romanin seront de nouveau pour illustrer des poèmes de Tristan Corbière, en 1935. Au moment de se choisir une phrase servant de base au codage de ses télégrammes, en 1941, il choisira deux vers de Corbière. Durant ses missions en France, il s’assure une couverture en ouvrant à Nice une galerie d’art moderne, la galerie Romanin, parfaite pour justifier ses ombreux déplacements. Il parvient à organiser trois expositions. De temps en temps, il dessine pour le plaisir. On ne sait pas s’il plaisantait en disant qu’après la guerre, il aimerait devenir ministre des Beaux Arts.
Serge Boyer (chargé de cours à l’Université de Montpellier) présente les dessins réalisés par Jean Moulin pendant la Grande Guerre. Il publie ses deux premiers dessins dans La Baïonnette, le 3 juillet et le 28 octobre 1915. Serge Boyer met en rapport les dessins de guerre de Jean Moulin avec ceux de Pierre Dantoine, agent technique en gare de Carcassonne, plus âgé que Moulin et donc combattant, dont la « vision réaliste de la vie quotidienne du Poilu marque l’ensemble de ses camarades, et plus tard après l’armistice, une grande partie de la société méridionale française qui découvre ses œuvres dans la Dépêche du Midi, dans La Démocratie de l’Aude, et dans de nombreuses revues régionales ». Malgré leur différence d’âge et d’expérience de la guerre, « les deux hommes présentent de nombreuses convergences formelles et fondamentales, notamment dans la précision du trait, dans la contextualisation rigoureuse de la guerre, et dans le foisonnement des décors (…) Pierre Dantoine et Jean Moulin cadrent leur objectif sur les armes, les soins infirmiers, les attaques, les morts, dans un hyperréalisme salutaire ».
Pour qui ne fréquente pas les dépôts d’archives, la communication de Patricia Gillet (Conservateur général du patrimoine, responsable du pôle « Guerres mondiales » aux Archives nationales), « Jean Moulin à travers les archives du BCRA » est une magnifique expérience. Une cinquantaine de documents essentiels y sont reproduits et commentés. Dommage que leur taille et la qualité de reproduction ne permettent que difficilement de les lire, mais c’est un véritable trésor, et une belle démonstration des l’utilisation des sources primaires dans l’écriture de l’histoire.
Après avoir retracé l’histoire des archives du BCRA (services secrets gaullistes) et précisé que toutes ne sont pas aux Archives nationales, elle propose un « florilège des documents concernant Jean Moulin ». Ils permettent de faire l’histoire des missions de Jean Moulin, de son arrivée à Londres et sa rencontre avec de Gaulle, à son arrestation par la Gestapo, y compris dans ses aspects concrets lorsqu’on découvre par exemple un tableau des opérations de parachutage, qui mentionne le parachutage de Jean Moulin. On y lit les noms de code de ses compagnons de voyage, Sif (Raymond Fassin) et son opérateur radio Sif W (Hervé Monjaret). On découvre ensuite la version initiale, de la main de Jean Moulin de son premier courrier adressé à Londres, le 1er mars 1942. Quinze mois plus tard et quelques pages plus loin, on lira le dernier rapport de « Rex » (l’un de ses pseudonymes), et, très émouvante, la dernière lettre de Jean Moulin à de Gaulle. Manuscrite, elle commence ainsi « Mon général, Notre guerre, à nous aussi, est rude ». Se sachant très menacé, il critique âprement le manque d’aide venue de Londres et conclut « Je vous en supplie, mon Général, faites ce que j’ai l’honneur de vous demander ». Six jours plus tard, il était arrêté à Caluire.
L’historien britannique Julian Jackson, auteur d’une biographie de De Gaulle et d’une synthèse remarquable sur La France sous l’Occupation, propose un article que l’on s’attend à trouver classique et qui est presque iconoclaste. Il a pour titre « Jean Moulin et le général de Gaulle ». Après avoir présenté le contexte et la vision des choses à Alger, où se trouve de Gaulle depuis mai 1943, à Washington, où l’on cherche à se débarrasser de De Gaulle au profit de Giraud, et à Londres, où l’on choisit toujours Roosevelt plutôt que De Gaulle ; après avoir montré combien l’arrivée de Moulin à Londres avait été essentielle pour de Gaulle, alors dans l’ignorance de la situation en France, et combien Moulin avait été efficace dans l’unification de la Résistance, il remet en question la version largement admise du fait que c’est l’annonce de la création du Conseil national de la Résistance, donc de la totale légitimité du général pour l’opinion française, qui a été déterminante dans sa reconnaissance par les Alliés et dans l’échec de la solution Giraud. Il pense démontrer que l’essentiel, plus que le CNR, ce furent les « pouvoirs de persuasion, la médiation et la diplomatie de Catroux et de Macmillan », respectivement représentant de De Gaulle et représentant de Roosevelt, à Alger. Jackson de conclure : « Je dirais, d’une façon provocatrice, que de Gaulle doit plus à Catroux, à Macmillan et même à Monnet qu’à la première réunion du CNR ».
Jacques Nougaret (membre de la Société Archéologique de Béziers) fait revivre l’enfance et la jeunesse de Jean Moulin à Béziers, en illustrant son propos de cartes postales et photographies anciennes de la ville
Cécile et Gilberte Benoit-Escoffier (cousins et ayants-droit de Jean Moulin) « ont puisé, dans le trésor des souvenirs de leur famille, quelques-uns de plus beaux documents iconographiques concernant l’homme, le haut fonctionnaire et l’artiste ».
Michel Fratissier (professeur à l’Université de Montpellier, auteur d’une thèse de doctorat : « Jean Moulin. Enjeux et lieux de mémoire 1945-2000), « spécialiste de la présence de Jean Moulin dans la conscience collective » s’élève contre l’affirmation souvent faite, de l’oubli de Jean Moulin dans par la mémoire collective jusqu’à sa panthéonisation en 1964. Il démontre par les faits, que de nombreux hommages lui ont été rendus dès l’immédiat après-guerre, à Paris, à Béziers, puis dans les lieux où il a vécu et exercé ses successives responsabilités dans sa carrière de sous-préfet puis de préfet. Il explique comment et pourquoi Jean Moulin est très présent dans la mémoire collective, et note que son nom est plus consensuel que celui du général de Gaulle, « parce que l’unificateur de la Résistance de l’intérieur est emblématique à la fois de la Nation, de la République et des réformes sociales et économiques prônées par le CNR », bien que le fameux programme du CNR n’ait été adopté que près d’un an après sa mort.
D’autres personnalités en lien avec Jean Moulin ont fait l’objet de communications
Vladimir Trouplin (conservateur du Musée de L’Ordre National de la Libération) a sorti de l’oubli la figure de Jacques Bingen, le successeur le Jean Moulin, « et brossé de lui le portrait d’un des hommes les plus chaleureux et attachants de la France Libre. Grand bourgeois cultivé et épicurien, Juif et patriote intransigeant, il rencontre Jean Moulin au BCRA à Londres en février et mars 1943 et choisit de le rejoindre ». L’entente entre les deux hommes est complète.
Volontaire pour servir dans les territoires occupés en remplacement de Jean Moulin arrêté, un avion le dépose près de Tours dans la nuit du 15 au 16 août 1943, avec un ordre de mission le désignant comme Délégué du Comité français de la Libération nationale (CFLN) en zone sud. A partir d’octobre 1943, avec Claude Bouchinet-Serreulles, il assiste Emile Bollaert, nouveau délégué général pour la Résistance, et lui succède de décembre 1943 à avril 1944. Après l’arrivée fin mars 1944 d’Alexandre Parodi comme Délégué général du CFLN, il retourne, malgré les menaces qu’il sent peser sur lui, à son action de Délégué pour la zone sud. Victime de la trahison d’un agent double français de l’Abwehr, il est arrêté, le 13 mai 1944, à la gare de Clermont-Ferrand. Il s’évade en assommant un des gardes chargés de sa surveillance mais, immédiatement repris, détenteur de secrets les plus importants de la Résistance, il préfère se donner volontairement la mort en avalant sa capsule de cyanure pour ne pas risquer de parler. Son corps ne sera jamais retrouvé.
Dominique Schmidt (membre du Comité régional du Mémorial Jean Moulin de Salon de Provence) retrace l’action de son père, Paul Schmidt, qui fut en 1942-1943, successivement le conseiller militaire du mouvement Libération et le responsable des opérations aériennes de la France libre en France occupée. « A travers lui, ce sont tous ceux qui lui ont permis de mener son action qui ont été évoqués. Daniel Cordier au premier chef ».
En novembre 1942, il se voit confier par Jean Moulin, la responsabilité du Service des opérations aériennes et maritimes dans les régions R5 (Limoges) et R6 (Clermont-Ferrand). Arrivé à Paris à la mi-mars 1943, « Kim » succède en mai à Jean Ayral en devenant le chef national du Bureau des opérations aériennes (BOA). A ce titre il est chargé de l’organisation des parachutages en zone nord ; il est également chef du BOA Centre et est directement chargé d’un territoire comprenant 27 départements qu’il parcourt en prenant les contacts nécessaires et en procédant personnellement au recrutement de ses chefs départementaux et des comités de réception. Le 13 septembre 1943, sa sécurité se trouvant très gravement compromise, il regagne Londres par une opération aérienne avec son épouse Françoise qui est aussi sa secrétaire dans la Résistance. En Angleterre, il est affecté au Service d’action du BCRA. En octobre 1944, Paul Schmidt rentre en France et est muté à la Direction générale des études et recherches (DGER) où il s’occupe de la liquidation des réseaux.
Il rend aussi hommage à Daniel Cordier, qui comme Paul Schmidt fit partie des 35 hommes sur près de 800, qui refusèrent de rentrer en France occupée après la bataille de Narvick, et firent le choix de rester en Angleterre, et de s’engager dans a France libre. Les deux amis suivirent ensemble les formations nécessaires à l’envoi en mission en France pour laquelle ils étaient volontaires. Tous deux furent parachutés pendant l’été 1942 pour des missions auprès de Jean Moulin. Daniel Cordier devint le secrétaire de Jean Moulin, et Schmidt, organisateur d’atterrissages et de parachutages. Raymond Fassin et Joseph Monjaret furent aussi de l’aventure. Daniel Cordier rentra à Londres au printemps 1944. Paul Schmidt et Daniel Cordier se retrouvèrent le 19 décembre 1964 autour du cercueil de Jean Moulin. Paul Schmidt est mort en 1983, au moment où Daniel Cordier entamait sa carrière d’historien et publiait son premier livre Jean Moulin et le CNR. Plus tard il raconterait son engagement et son action auprès de Jean Moulin dans Alias Caracalla.
François-René Cristiani-Fassin (membre du Comité régional du Mémorial Jean Moulin de Salon de Provence) évoque lui aussi son père, Raymond Fassin, qui fut parachuté le 2 janvier 1943 avec Jean Moulin pour être l’officier d’opérations auprès du mouvement Combat. Après cette première mission achevée au moment de l’arrestation de Jean Moulin, il assume la lourde responsabilité de Délégué militaire régional dans le nord de la France. Dénoncé par un de ses agents de liaison retourné par la Gestapo, il est arrêté à Paris le 2 avril 1944, avec sa compagne Sif 5 (Solange, Carolle), enceinte. Interné le 2 mai 1944 à la prison de Loos-les-Lille (Nord), il est déporté le 31 août 1944 par le « dernier train de Loos », d’abord, le 5 septembre, au camp de Sachsenhausen-Oranienburg, puis, vers fin octobre1944, à Neuengamme. Il meurt de maladie et de mauvais traitements, le 12 février 1945.
Thomas Rabino (historien de Jean Moulin et de la Résistance) propose une communication sur Laure Moulin, la sœur admirative, efficace et dévouée, à laquelle il a consacrée une passionnante biographie. « Elle le confirme dans sa vocation d’artiste ; elle le conseille dans ses études et l’assiste dans sa vie privée ; elle lui sert d’agent de liaison dans la clandestinité ; enfin elle contribue notablement à la construction de sa gloire posthume. »
Témoignages inédits sur Jean Moulin, sur le général de Gaulle et sur la Résistance. Lettres inédites du général de Gaulle
Ces textes ont été recueillis et établis par Éléna Dounaeva, Vice-Présidente de l’Association Nationale des Amis de Jean Moulin. Elle écrit : « Dans cette partie, à travers des documents, lettres et témoignages inédits, nous souhaitons rendre hommage à quelques-uns de ces compagnons de Jean Moulin, certains illustres, d’autres oubliés, et redonner vie à l’image du héros à travers leur souvenir ». C’est une partie de plus de 120 pages, qui nous permet d’entrer dans la vie quotidienne du petit groupe de celles et de ceux qui épaulèrent Jean Moulin à Lyon, puis à Paris, ainsi que de préciser quelques aspects de l’affaire de Caluire, la trahison et l’arrestation de Jean Moulin.
Baudoin Lebon raconte l’action résistante de sa mère, Suzanne Olivier Lebon qui fut un agent de liaison de Jean Moulin puis de Daniel Cordier, multipliant les voyages entre les deux zones, entre Lyon et Paris, avec des documents de la plus haute importance, présentant le plus grand danger en cas d’arrestation. Arrêtée en 1943, elle ne parle pas ; déportée, elle rentrera mais resta dans l’ombre, ne cherchant pas les honneurs. Meurtrie par sa déportation, elle mourut en 1968 à l’âge de 45 ans. On peut lire aussi le témoignage de Suzanne Olivier sur son arrestation et détention à Fresnes, recueilli au printemps 1946, et conservé dans les archives du Musée Général Leclerc/Musée Jean Moulin de la Ville de Paris, ainsi que celui de sa mère, d’après des notes d’Henri Michel conservées aux Archives nationales. Une lettre de 1946, de Suzanne Olivier à Antoinette Sachs, qui fut la compagne de Jean Moulin et qui agit pour la défense de sa mémoire, nous fait regretter qu’elle ne soit pas plus présente dans ce colloque. Elle méritait largement une communication.
Les témoignages du juge Ernst Roskothen, ancien Conseiller au Tribunal militaire allemand du Commandement du Grand Paris en 19443-1944 nous font pénétrer du côté des acteurs de la répression, ici l’un de ceux qui prononçait les jugements à l’issue d’une instruction accompagnée de tortures dans la plupart des cas. On aborde l’affaire de l’arrestation du général Delestraint, et celle du rôle de René Hardy.
Deux témoignages de Pierre Meunier (1977 et 1987) sont l’occasion de mettre plus en lumière celui qui fut lui aussi un proche de Jean Moulin. Il l’a connu en 1934 au Ministère de l’Air, détenu par Pierre Cot, duquel ils allaient tous deux rester très proches. Il fut l’une des rares personnes à connaître les préparatifs de Jean Moulin pour son départ à Londres, et c’est lui qui lui conseilla de rester en poste jusqu’à sa révocation. Il fut son agent en zone Nord, et prépara la réunion du CNR, dont il fut nommé secrétaire général.
Un petit dossier concerne Paulette Rouquet et Tony de Graaf. Ils se marient en janvier 1942 et s’installent à Lyon, entrent dans la Résistance aux côtés de Jean Moulin. Tony réceptionne l’argent parachuté pour la Résistance et le répartit entre les organisations, tandis que Paulette le distribue, en le cachant dans le landau de leur petite fille. Ils hébergent Jean Moulin et d’autres responsables de la Résistance. Tony succède à Daniel Cordier à Lyon, quand celui-ci part pour Paris, et échappe de peu aux arrestations de Caluire. Il doit partir pour Londres, tandis que Paulette se cache, est arrêtée, puis libérée faute de preuves. Le couple ne survit pas à l’aventure et se sépare. Tony garda le silence jusqu’à sa mort, Paulette ne se décida à témoigner qu’à l’âge de 100 ans, sous l’insistance de sa famille. On peut lire ce témoignage, recueilli en décembre 2023. On est étonné et admiratif de sa qualité et de sa précision, il remplit une vingtaine de pages.
On peut lire la déposition de Tony de Graaf devant le BCRA de Londres, en août ou septembre 1943. Ce document du plus grand intérêt historique, nous permet de prendre connaissance des premières interrogations à chaud sur les événements de Caluire. Sa déposition au second procès de René Hardy en 1950, complète l’approche de cette affaire et éclaire la responsabilité de René Hardy, bien qu’il soit acquitté de justesse.
Le témoignage inédit de Colette Pons-Dreyfus est extrait d’une lettre datée du 18 octobre 1981, adressée à Daniel Cordier. Elle rencontre Jean Moulin à Megève en février 1942 ; elle a 28 ans. Il vient de revenir de Londres, il commence sa première mission. Il veut apparaître en public pour détourner les soupçons de la police de Vichy. « Jean Moulin est immédiatement séduite par cette jeune femme belle, intelligente et distinguée ; il se présente à elle comme un agriculteur de Cavaillon –ce à quoi elle ne croit pas un instant- et la rejoint les jours suivants. Elle lui résiste… » Elle est fiancée à Philippe Dreyfus, un Français libre. Jean Moulin accepte la situation, sans renoncer. Daniel Cordier estime que ce fut « son dernier amour ». Elle accepte de devenir la directrice de la galerie d’art que Jean Moulin veut ouvrir à Nice. A la mi avril 1943, période de fortes tensions au sein de la Résistance, il parcourt avec Colette les galeries parisiennes pendant une semaine. D’après Daniel Cordier, ce fut son dernier bonheur. Elle échappe de peu à l’arrestation.
On lira encore des « Notes personnelles » du colonel Passy, chef du BCRA, sur la vie au BCRA de Londres entre 1940 et 1943, et enfin plusieurs lettres inédites du général de Gaulle, à Jacques Soustelle, au colonel Passy, à Jean-Louis Théobald (qui fut arrêté avec le général Delestraint)…
Ce compte-rendu, qui n’a évidemment pas la prétention d’être exhaustif, suffit néanmoins à montrer la richesse et l’originalité de l’ouvrage. Si l’on se souvient de la publication de deux gros volumes Jean Moulin. Ecrits et documents de Béziers à Caluire, rassemblés et présentés par François Berriot[1] en 2018, on se doit d’apprécier la qualité et l’importance du travail de recherche historique et de diffusion des connaissances que réalise l’Association Nationale des Amis de Jean Moulin.
[1] A propos desquels nous écrivions « A ceux qui ne peuvent fréquenter les dépôts d’archives, cet énorme corpus offre l’occasion de se confronter aux documents primaires, ceux avec lesquels les historiens écrivent l’histoire. Il permet d’approcher comme jamais la personnalité et l’action d’un acteur de l’histoire. Il permet de se forger sa propre opinion et de constater combien furent ineptes certaines des accusations portées contre Jean Moulin. Pour les chercheurs il sera un outil de travail, d’autant plus efficace que l’index et le sommaire détaillé en facilitent l’usage. »