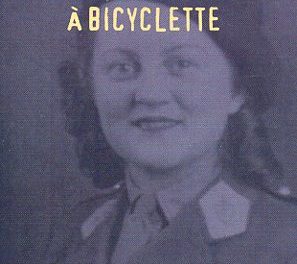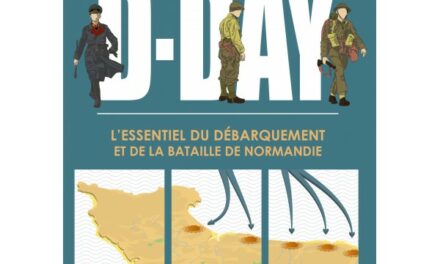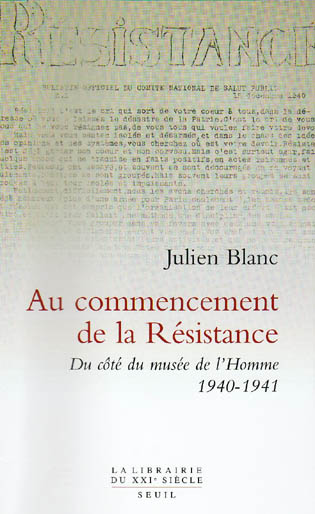
L’ouvrage se compose de six parties : présentation de la zone occupée de l’été 1940 à l’été 1941 ; étude de la genèse et des structures du « réseau du musée de l’Homme » ; analyse des activités résistantes ; analyse des motivations de l’engagement ; sociologie et idéologies de ces pionniers ; modalités et conséquences de la répression.
Une organisation à « l’architecture déroutante »
L’appellation officielle de « réseau du musée de l’Homme. Houet-Vildé » est une appellation posthume, choisie en 1946 par Germaine Tillion à l’occasion de l’homologation de cette organisation. Il s’agissait d’une procédure administrative obligatoire et nécessaire pour permettre aux survivants ou à leurs ayants-droit de faire valoir leurs états de service afin de toucher pensions, décorations et titres de reconnaissance. Il fallait faire vite et Germaine Tillion n’avait pas connaissance de toutes les ramifications de l’organisation à laquelle elle avait appartenu. Elle schématisa sans le vouloir car l’étude de Julien Blanc démontre que cette organisation n’est pas un réseau et qu’elle ne se limite pas au groupe constitué au sein du musée de l’Homme.
L’étude montre que de nombreux groupes autonomes formés dès l’été 1940, à Paris et en province, se sont trouvés mis en relation les uns avec les autres, constituant une organisation à « l’architecture déroutante ». L’auteur identifie quelques groupes à l’origine distincts :
– Un groupe constitué au sein du musée de l’Homme dès août 1940 autour de Boris Vildé, né à Pétrograd en 1908, naturalisé français en 1936, directeur du département des Peuples polaires, prisonnier de guerre évadé, Anatole Lewitsky, né en 1901 en Russie, spécialiste du chamanisme sibérien et des civilisations du Pacifique, Yvonne Oddon, bibliothécaire. Ce sont trois piliers de l’institution, trois collègues, trois amis. Le musée de l’Homme est alors « le fleuron de la muséographie française ». Il est dirigé par Paul Rivet qui a réussi à en imposer la construction au Palais de Chaillot à l’occasion de l’Exposition universelle de 1937. Par ailleurs Paul Rivet est un proche de Léon Blum, l’un des fondateurs du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes, un élu du Front populaire à Paris en 1935, l’auteur d’une « lettre ouverte au maréchal Pétain » en juillet 1940, courageuse et critique. Informé des activités du groupe constitué autour de Boris Vildé, il y prend une part active en lui procurant les indispensables moyens logistiques.
– Le « groupe des écrivains », avec Jean Cassou, Claude Aveline, Agnès Humbert, Marcel Abraham et Simone Martin-Chauffier. Ils ont milité ensemble au sein du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes et soutenu le Front populaire. Ce sont des amis.
– Le groupe constitué par un curieux trio composé du colonel Paul Hauet et du colonel Maurice Dutheil de la Rochère, tous deux condisciples à Polytechnique en 1889, réactionnaires patriotes âgés de plus de 70 ans, et de l’ethnologue Germaine Tillion.
– Des groupes constitués à Béthune, à Soissons, à Paris et en banlieue.
Ces groupes s’étoffent par recrutement au sein de réseaux professionnels, militants ou amicaux, mais aussi par le fruit du hasard : il en va ainsi de la rencontre de l’ethnologue Germaine Tillion, alors âgée de 33 ans et qui vient de passer deux ans dans l’Aurès au sein des tribus berbères et du colonel Paul Hauet, 73 ans, qui a participé en 1898 à la conquête du Soudan et a terminé la Grande guerre dans l’état-major de Foch.
Ces petits groupes autonomes se multiplient, grossissent, entrent en contact les uns avec les autres. Boris Vildé entreprend un véritable « tour de France » de janvier à mars 1941, « initiative extraordinaire à cette époque ». Il avait pour objectif de « bâtir un véritable mouvement de Résistance » ; il n’en aura pas le temps, mais on voit émerger des « secteurs » clandestins.
– Le secteur Vildé. Boris Vildé entreprend méthodiquement de recruter des résistants. Il entre en contact avec Jean Cassou et le « groupe des écrivains ». Il se déplace en Bretagne, à Béthune, à Toulouse, et regroupe en trois mois une dizaine de noyaux d’origine distincte.
– Le secteur La Rochère. Autour de Maurice de la Rochère se rassemblent plusieurs équipes : le groupe « Vérité française » qui publie dès octobre un bulletin clandestin, le groupe de Soissons, un autre implanté à Paris au cœur de la préfecture de la Seine.
– Le secteur Hauet-Tillion constitué à l’origine autour d’une activité légale d’aide aux prisonniers de guerre coloniaux ; il recrute parmi les militaires et élargit son aire géographique : Metz, Bordeaux, Saumur etc.
Boris Vildé s’impose à la tête du groupe du musée, puis comme patron des noyaux qu’il rattache : « charisme personnel, rayonnement, antériorité, capacité à convaincre et à entraîner, disponibilité, goût de l’aventure, toutes ces qualités s’additionnent et éclairent en partie le rôle moteur » qui fut le sien.
Bien qu’on parle de « secteurs » et qu’on nomme des « patrons », il ne faut pas « penser la Résistance pionnière en terme de verticalité, autorité et subordination ». Sur le terrain en effet, les différents noyaux sont presque totalement autonomes. La démarche comparative empruntée par l’auteur met en évidence de nombreuses similitudes avec d’autres organisations pionnières de la zone Nord (avec une organisation peu connue appelée « Armée des Volontaires » par exemple) qui s’étendent elles aussi suivant des lignes de forces horizontales et non pas verticales.
Un « réseau » qui n’en est pas un
Cette organisation se présente sous la forme « d’une juxtaposition de modules à la fois indépendants et interconnectés », un labyrinthe au sein duquel personne « même pas les patrons des différents secteurs, ne peut se prévaloir de tenir la totalité des fils en main ». « Au zénith de son développement (au printemps 1941), l’organisation est protéiforme, cloisonnée, compartimentée ». Il ne s’agit donc pas d’un réseau au sens strict du terme ( le « réseau du musée de l’Homme » n’a pas été créé de l’extérieur dans un but strictement militaire et n’est pas une organisation pyramidale et hiérarchisée) ; il s’agirait davantage de l’esquisse d’un mouvement de résistance dans la mesure où son action de propagande tournée vers la population est essentielle, mais il est demeuré à peu près inconnu de la France libre, il n’a mandaté aucun représentant à Londres et il ne fut évidemment pas représenté au sein du Conseil national de la Résistance qui se constitua deux ans après son démantèlement.
L’auteur utilise le registre métaphorique pour caractériser cette organisation première et atypique : il parle de « nébuleuse » (amas de matières disparates aux contours imprécis, ensemble en voie de constitution), de « rhizomes » (développement souterrain par des racines nombreuses et croisées, croissance horizontale et non verticale des groupes autonomes), d’« archipels », ou encore de… réseau, le terme étant pris dans son acception littérale et non historique : écheveau touffu de groupes dont les multiples fils s’entremêlent pour former un système modulaire interconnecté.
Les multiples facettes d’une activité intense
Les pionniers de la Résistance « affirment d’emblée une volonté d’entreprendre sans limite ». « Le fait de mener de front plusieurs activités de nature différente constitue un marqueur essentiel de cette première Résistance ». Les trois activités essentielles de ces groupes sont la propagande, l’évasion de prisonniers de guerre et le renseignement. Sur ces trois domaines, le premier en particulier, Julien Blanc parvient à jeter un regard neuf, à contextualiser avec finesse et donc à échapper à la déformation de l’analyse que la connaissance de ce que fut la Résistance par la suite impose souvent à cette toute première activité. Il montre avec simplicité et conviction ce que furent les premières réunions de ces résistants qui inventaient la Résistance, la difficulté de concevoir, fabriquer, coller, diffuser les papillons et les tracts puis enfin les journaux : autant de documents bien souvent perdus (ce qui conduit à minimiser leur réalité) qui furent des « étincelles dans la nuit » (l’expression est d’Agnès Humbert). Il en montre la diffusion géographique, dans les villes d’abord (qui virent naître la Résistance), puis dans les bourgs et les villages de la France rurale ; il en réévalue l’importance et en analyse le contenu qui fait bien souvent appel à l’ironie et à la dérision.
Lorsqu’il parvient à réaliser un journal, le groupe a franchi un fossé technique et qualitatif ; « le journal cherche à établir une relation durable avec ses lecteurs. En se dotant d’un titre, d’un numéro fondateur, d’un « logo » et parfois d’une devise, le journal affirme, dès sa naissance, une volonté d’ancrage dans le temps ». Les journaux (qui ne sont souvent que des feuilles) remplissent des fonctions essentielles, d’une part en agissant sur l’opinion publique, d’autre part en en élargissant le cercle de la dissidence : c’est en effet « autour de la fabrication et de la diffusion des feuilles souterraines que se cristallisent convergences et solidarités ».
Le « réseau du musée de l’Homme » a produit deux journaux : « Vérité française », le moins connu, bien qu’il ait publié 32 numéros d’octobre 1940 à novembre 1941, et « Résistance » dont le premier numéro est daté du 15 décembre 1940 et qui sera suivi de quatre autres jusqu’en mars 1941 (le dernier étant intégralement rédigé par Pierre Brossolette)
Plusieurs groupes de la nébuleuse ont fait de l’évasion des prisonniers de guerre, alors détenus dans des camps provisoires d’où ils devaient gagner l’Allemagne, leur activité principale, à l’image de l’Union nationale des combattants coloniaux, fondée par Paul Hauet et Germaine Tillion. Il s’agissait à l’origine d’une association légale de charité et de bienfaisance au bénéfice des prisonniers coloniaux, enfermés dans une grande détresse physique et morale. La filière constituée à Metz par sœur Hélène Studler est un modèle du genre, qui assure l’évacuation des évadés jusqu’à Paris par l’intermédiaire du frère de la religieuse, industriel parisien, ami intime de Paul Hauet.
Sous couvert de ravitaillement et de soin, les évasions se multiplient et bénéficient de complicités qui traduisent « l’importance des courants germanophobes et anglophiles dans l’opinion ». L’auteur montre l’implication active de nombreux membres du clergé, des volontaires de la Croix-Rouge, du personnel hospitalier et médical et même des structures étatiques ou paraétatiques du régime de Vichy, ce qui démontre que « les frontières entre certaines activités résistantes et les services de Vichy se trouvent, un temps, brouillées ».
L’activité de renseignement est immédiate, spontanée et balbutiante. C’est autour de celui qui trouve un moyen de transmettre le renseignement que s’organise l’activité et que se structure l’organisation. Maurice de la Rochère, ancien officier de renseignement, utilise ses compétences en la matière. Certains groupes se spécialisent dans le renseignement, ce qui est une originalité au sein de la nébuleuse, le groupe du médiéviste Robert Fawtier à Toulouse par exemple. Mais la France Libre est très mal renseignée sur ce qui se passe en métropole et les pionniers du « réseau du musée de l’Homme » ne seront pas connu avant février 1941. Les premières missions de la France Libre ne parviennent pas à nouer un fil solide avec ses premiers noyaux. C’est l’avocat socialiste André Weil-Curiel, envoyé de Londres, qui approche le groupe du musée de l’Homme et s’intègre au secteur Vildé.
Quelques pionniers ramassent des armes abandonnées par l’armée française au cours de la débâcle. Boris Vildé avait pour objectif de former des groupes paramilitaires et de mettre en place une armée de la Libération.
Le travail de Julien Blanc infirme donc « la représentation classique du « réseau du musée de l’Homme », archétype d’une Résistance purement intellectuelle qui aurait pris corps entre lettrés et aurait agi exclusivement dans le domaine de l’écrit ». Il estime d’ailleurs qu’il est artificiel d’opérer une césure entre « Résistance intellectuelle » et « Résistance active » car elle « empêche de prendre en compte (…) la pluralité des actions entreprises de concert ». « Au regard des risques encourus, les distinctions savantes entre les différentes formes de désobéissance ne tiennent pas ».
Les motivations de l’engagement résistant
Julien Blanc aborde ici un thème déjà bien exploré de l’historiographie de la Résistance. Imprégné de la parfaite connaissance des itinéraires biographiques des membres de l’organisation, il le fait avec nuance, affirmant d’emblée son parti pris méthodologique du refus de la typologie qui « aurait tendance à rigidifier une réalité volatile ». S’appuyant sur l’étude de cas précis, il dégage les différents composants de la motivation et en développe les nuances en montrant « qu’ils se mêlent de façon étroite, dans des proportions souvent variables ».
Le patriotisme structure l’univers mental des premiers résistants. « La simple vue de l’envahisseur, en touchant un élément essentiel enfoui au tréfonds de chacun, provoque une réaction épidermique de défense, un sursaut existentiel. » Mais l’auteur se refuse à faire du patriotisme la « clé de voûte majeure » de l’engagement résistant. Il observe que le patriotisme est un « concept fourre-tout » qui recouvre « des choix contradictoires et parfois même diamétralement opposés ». S’appuyant sur des concepts définis par l’historien François Marcot, il distingue les « patriotes intransigeants » qui opposent à l’occupant un refus viscéral et sentimental, les « patriotes réactionnaires » qui refusent la défaite, l’armistice et la collaboration mais approuvent les projets politiques et sociaux du régime de Vichy, les patriotes défenseurs du « modèle républicain » qui se réfèrent à 1789 et 1792 et se classent à gauche. Il s’attache ensuite à détruire une autre idée reçue qui ferait du musée de l’Homme le temple d’une « science progressiste, allergique aux conceptions nazies » et donc quasiment « prédestiné à devenir une citadelle de la Résistance ». Plusieurs travaux récents montrent au contraire que l’ethnologie française n’a pas unanimement résisté à la tentation vichyste et même collaborationniste.
Si certains engagements résistants se situent dans la continuité et la cohérence des engagements d’avant guerre (ainsi dans de nombreux cas l’antifascisme demeure vivace), il arrive aussi fréquemment que cet engagement, par nature transgressif, soit en contradiction avec les modèles de comportement d’avant guerre : ainsi des nombreuses recrues appartenant à la bourgeoisie catholique, conservatrice ou réactionnaire.
Une mosaïque sociale
La nébuleuse du « musée de l’Homme » compte au printemps 1941 une quarantaine de groupes à Paris, dans le Pas-de-Calais, l’Aisne, à Nancy, Metz et Strasbourg, en Bretagne, dans les pays de Loire, à Lyon, Perpignan, Toulouse, rassemblant plus de 750 résistants. Les noyaux originels se sont constitués sur une base sociale homogène, mais leur développement ultérieur a entraîné une réelle diversification sociale.
Les noyaux parisiens concentrent une forte proportion d’individus diplômés issus de la bourgeoisie ; les cadres intellectuels perdent leur position de quasi monopole tout en conservant la direction des organisations. Les éléments paysans sont rares.
Ces pionniers de la Résistance ne sont pas des « inadaptés » comme on l’a beaucoup dit ; ils sont au contraire bien insérés dans la société. Les dirigeants ont tous des activités professionnelles qui leur permettent de disposer d’un bien précieux : la maîtrise totale ou partielle de leur emploi du temps ; ce qui facilite les activités clandestines ou illégales.
Si la jeunesse est bien représentée parmi ces pionniers, elle est loin d’être dominante. Beaucoup ont passé la quarantaine, la cinquantaine ou davantage : Paul Hauet et Maurice de la Rochère ont plus de 70 ans.
Les femmes sont surreprésentées dans cette organisation et elles exercent des responsabilités, étant d’ailleurs souvent à l’origine des premiers noyaux. Il n’est d’ailleurs pas impossible que cette situation soit généralisable à l’ensemble de la première résistance : « à mesure que le temps s’écoule et que la Résistance se structure, les pesanteurs socioculturelles refont surface et on assiste à un retour aux commandes de la gent masculine ».
Ces individus qui se sont cooptés forment une « fratrie » ; l’amitié et la fraternité, qui possèdent parfois des racines anciennes, imprègnent les relations. Quelques belles pages (334 à 340) sont consacrées à l’évocation du « bonheur de se battre ensemble, côte à côte avec des gens que l’on a choisis et avec lesquels on partage l’essentiel ». Ce bonheur ressenti est une « dimension essentielle de la lutte clandestine ». Ces pionniers étaient gais, optimistes, passionnés, ce moment de leur vie fut unique, quand ils n’en sont pas morts.
Nuances idéologiques
Une part importante des premières organisations de résistance fut maréchaliste (attachement sentimental à la personne du maréchal Pétain), voire même pétainiste (adhésion aux principes de la Révolution nationale). Le détachement s’effectua à la fin de 1941 pour la plupart d’entre elles. La condamnation du régime de Vichy par les pionniers de la Résistance n’a donc été ni immédiate, ni unanime ; de nombreux groupes ont entretenu des relations plus ou moins longues et plus ou moins étroites avec des institutions vichystes. Il en est ainsi de la nébuleuse du « réseau du musée de l’Homme ».
Les engagements politiques sont divers : Boris Vidé, Agnès Humbert, Jean Cassou sont de gauche mais Paul Hauet et Maurice de la Rochère sont d’extrême droite. De Gaulle est considéré comme un symbole et une référence, mais pas comme un chef politique auquel on se doit d’obéir. Le ralliement moral à de Gaulle ne vaut pas allégeance.
Répression
Ces pionniers « perçoivent la dimension sacrificielle de leur combat » ; ils sont conscients du danger et de la nécessité de respecter des règles de prudence, mais les exemples d’imprudence sont légion. On peut s’en étonner et parler d’amateurisme mais il faut faire l’effort de concevoir qu’ils devaient tout apprendre et qu’ils avaient tout à inventer. Novices et inexpérimentés, ils étaient désarmés et vulnérables. Ils furent donc décimés : sur les 757 membres affiliés après guerre à l’organisation, 264 furent arrêtés et parmi eux 109 trouvèrent la mort.
Ils eurent à leurs trousses des policiers professionnels et efficaces qui surent infiltrer les groupes par des agents doubles (agents d’occasion ou agents stipendiés) qui firent de terribles ravages. Ouverts sur l’extérieur, ces groupes pionniers étaient d’autant plus vulnérables que le recrutement était la condition de leur développement.
La justice militaire allemande se montra implacable, prononçant dans l’apparent respect des règles juridiques des peines fixées à l’avance et impliquant la mort. Quelques belles pages sont enfin consacrées aux jours qui suivent l’incarcération, qui sont ceux de la détention, de l’instruction, du procès, de la déportation ou de l’exécution. La volonté de résister encore s’exprime en prison par des gestes de défi envers l’occupant, par l’humour et l’ironie, par le silence lors des interrogatoires, par la transgression des consignes de silence et des interdits divers.
Ce que les Allemands eux-mêmes appelèrent « l’affaire du musée de l’Homme » fut jugée en février 1942 : 10 condamnations à mort furent prononcées (trois femmes et sept hommes), ainsi que trois peines de prison et six relaxes. Certains groupes demeurèrent intacts ; Germaine Tilllion fut interpellée en août 1942 et Paul Hauet en juin 1944. Ceux qui échappèrent à l’arrestation, souvent ne renoncèrent pas. Connaissant mieux désormais les pièges à éviter, la plupart jouèrent par la suite des rôles de premier plan, tels Pierre Brossolette, Jean Cassou, Jean Paulhan et quelques autres.
Un ouvrage historiographiquement novateur, intelligent et stimulant par les questions qu’il pose, les idées reçues qu’il détruit, les méthodes qu’il applique et les concepts qu’il éclaire.