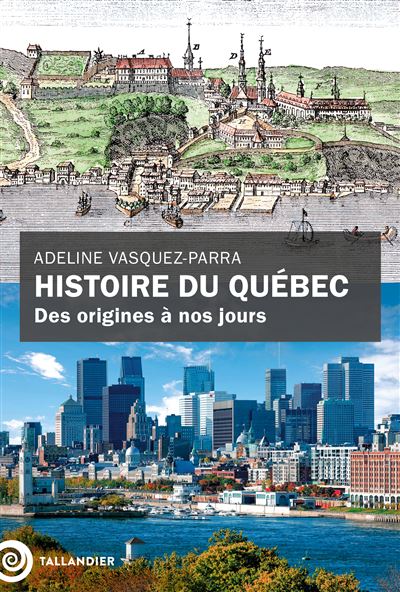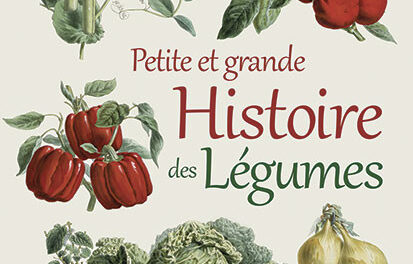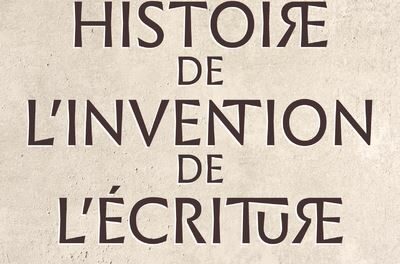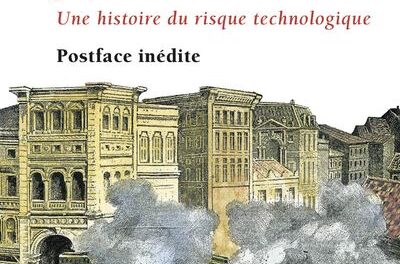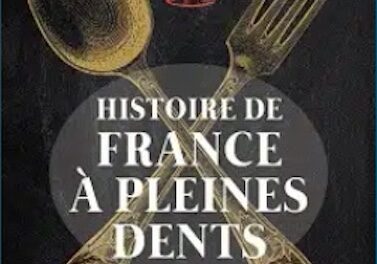Une facture très classique pour cette Histoire du Québec d’Adeline Vasquez-Parra. La démarche résolument chronologique privilégie, notamment pour les périodes récentes, le politique, laissant peu de place à l’histoire économique ou sociale.
Une terre des nations
Ce court premier chapitre présente le peuplement des premiers Amérindiens. Il décrit l’organisation en deux grandes confédérations iroquoienne et algonquienne.
La colonisation française 1524-1658
L’autrice relate les premiers contacts basiques avec les Autochtones autour de la pêche, puis de la traite des fourrures.
Les premiers voyages d’exploration sont d’initiatives individuelles, avec le soutien royal qui débouchent vers les premières installations pérennes. L’autrice propose un large panorama, au-delà de CartierCartier, Jean-Michel Demetz, Tallandier, 2021 et de ChamplainSamuel de Champlain – Aux origines de l ’Amérique française, Éric Thierry, Québec, Éditions du Septentrion, 2024. Elle restitue les premières expériences de colonisation dans la compétition économique européenne de la fin du XVIe siècle pour s’emparer des ressources minières et trouver un passage vers la Chine.
Au début du XVIIe siècle, le développement du commerce des fourrures est caractérisé, pour les marchands français, par la recherche d’un monopole royal et par des conflits entre nations amérindiennes, notamment entre la Ligue des Cinq-Nations iroquoinne et les Hurons-Wendat.
C’est avec le voyage de Champlain que se met en place le réseau d’alliances entre les Français, au nom du roi, et les chefs amérindiens, désireux de trouver une aide face à leurs ennemis. L’autrice décrit les lieux et les acteurs des premières implantations en Acadie et sur les bords du Saint-Laurent. Cette aventure a été mise en mots dès 1609 sous le plume d’un avocat picard Marc Lescarbot et en 1618 avec le récit de Champlain lui-même. Ces récits sont marqués par la lecture de la Bible et l’influence huguenote.
Si le commerce des fourrures encourage les investisseurs, l’implantation de colons est lente : fondation du poste de traite de Trois-Rivières en 1634Menacé par les Iroquois en 1648, premier hivernage en terre huronne pour Jean de Brebeuf. Une des difficultés est l’absence de femmes parmi les engagés. Partant du modèle mis en place pour les CaraïbesSaint-Domingue 1667, l’envoi forcé de jeunes femmes pour le Canada trouve son essor avec les « Filles du Roi »Ce point est repris au chapitre suivant.
L’autre point est celui du respect de la morale et de la conduite des âmes qui nécessite la présence de missionnaires. Dès 1615, les premiers Récollets arrivent à Québec, suivis par les Jésuites en 1625 en Acadie. Leurs rapports et récits de voyages sont une source pour l’historien. À partir de 1658, ils se voient confier la conversion des peuples autochtones.
L’organisation de la colonie et le rôle de la Compagnie des Cent-Associés, crée par richelieu, permet une approche des premiers temps de la Nouvelle-France.
L’État royal au Canada 1669-1698
Le rôle de Colbert est mis en évidence, une politique coloniale tournée vers les intérêts de la métropole. L’autrice décrit la politique de peuplement grâce aux « Filles du Roi » pour éviter l’ensauvagement des colons. Originaires majoritairement d’Île-de-France, elles concourent à l’adoption du « français du Roy » dans la colonie. À partir de 1663, l’administration devient royale.
Le premier intendant, Jean Talon, arrive en 1665. Les institutions de la métropole, en particulier la coutume d’Île-de-France régissent la colonie. Le pouvoir royal est représenté par un gouverneur. Depuis le début du XVIIe siècle, le foncier est organisé par le système seigneur/laboureur qui distingue le seigneur, souvent roturier, absent de ses terres confiées, pour leur exploitation, à des censitaires. L’autrice présente les différentes interprétations des historiens québécois à propos du régime seigneurial et de la définition de l’« habitant », travaillant la terre à l’opposé des « coureurs de bois »Histoire des coureurs de bois – Amérique du Nord 1600 – 1840, Gilles Havard, Paris, Les Indes Savantes, 2016 qui se livrent à la traite des fourrures. Le plus connu d’entre eux, Pierre-Esprit Radisson est présenté en détail.
Un paragraphe est consacré au premier gouverneur, Louis de Buade de Frontenac et au régiment de Carignan-Salière chargé de la défense de la colonie face aux attaques iroquoises puis aux appétits britanniques dans le contexte de la guerre de la Ligue d’Augsbourg.
D’où viennent les migrants au XVIIe siècle ? Leur nombre est évalué à environ 5 000 personnes en 1656. Les contrats d’engagement donnent une idée des origines : le Grand Ouest. Si le contrat stipule le statut de catholique, les protestants ne sont pas absentsMême si l’autrice ne le mentionne pas.
Le « moment atlantique » 1701-1789
Ce quatrième chapitre s’ouvre sur la Grande Paix de Montréal qui met fin, en 1701, aux guerres avec la Ligue iroquoise.
L’autrice consacre un court passage à la question de l’esclavage et renvoie aux travaux de Marcel TrudelDeux siècles d’esclavage au Québec, Marcel Trudel, Biblothèque québécoise, 2021
On pourra aussi se reporter à : L’esclavage et les Noirs à Montréal 1760-1840, Frank Mackey, Montréal, Canada, Ed. Hurtubise, Cahier du Québec, 2013 et Esclave en Nouvelle-France, Revue d’histoire de la Nouvelle-France N° 4, Québec, Edition du Septentrion, 2024.
Cette période, pour la colonie, est marquée par les conséquences des guerres en Europe qui alimentent la querelle avec la colonie britannique jusqu’au Traité de Paris en 1763La chute de la Nouvelle-France, Bertrand Fonck, Laurent Veyssière (dirs.), Québec, Éditions du Septentrion, 2015.
L’autrice montre les perceptions et le vocabulaire différent pour désigner le conflit entre les historiens anglophones et francophones. Elle décrit comment cette guerre est jugée comme responsable des maux du Québec, dont la déportation des Acadiens qui tient une grande place dans la mémoire québécoise. On retrouve les grandes étapes du conflit de la prise de Louisbourg à la bataille des Plaines d’Abraham. Le sort des réfugiés du Canada, de retour en France est traité, un point rarement étudié. Nombre d’entre eux rejoignent la Louisiane ou la Guyane.
La description de l’organisation territoriale de la province de Québec montre une terre défrichée sur le modèle des rangsLongues tenures perpendiculaires aux rivières ou à la route. Sous le régime britannique, après 1763, une politique d’assimilation est mise en place, assimilation incomplète puisque les emplois publics sont interdits aux non-anglophones. Les colons anglophones réclament des institutions démocratiques qui leur soient réservées. Les gouverneurs visent à empêcher toute aide ou adhésion des Canadiens francophones au mouvement de révolte des colonies anglaises.
Le régime britannique est définit par l’Acte de Québec proclamé par le roi George III, en juin 1774. Le mouvement atlantique se clôt avec d’une part l’indépendance américaine qui réduit le Québec à la vallée du Saint-Laurent et d’autre part les quelques échos à Québec et Montréal de la Révolution française.
Le Bas-Canada 1791-1841
L’acte constitutionnel du Canada en 1791 définit les limites et les modalités de la gestion de l’ancienne Nouvelle-France. Les propriétaires obtiennent une représentation dans la Chambre des députésÀ noter la suppression du droit de vote des femmes propriétaires en 1834. Cette représentation amène un réveil des élites canadiennes malgré leur faible poids face à l’exécutif colonial et une inégalité des droits par rapport aux Anglophones.
Lors de la tentative d’invasion américaine en 1812, les milices canadiennes et certaines nations autochtones ont assuré la victoire britannique.
Au plan politique, l’autrice présente le rôle de Louis-Joseph Papineau dans le rejet par les Francophones du projet d’union des Haut et Bas-Canada. Les heurts avec les gouverneurs et les autorités londoniennes débouchent sur la révolte des PatriotesHistoire inédite des Patriotes, Anne–Marie Sicotte, Montréal, FIDES, 2019 en 1837. C’est un épisode important de l’histoire québécoise, inscrit dans la mémoireSymbole de la ceinture fléchée..
L’Acte d’Union de 1841 réunit les deux Canadas, avec une nouvelle constitution et des réformes qui assurent une vie politique libérale et démocratique. L’urbanisation, le développement des voies de communication et les progrès de l’alphabétisation sont les marqueurs de la période.
L’ère de l’affirmation 1841–1887
Le chapitre est consacré aux mouvements politiques de la seconde moitié du XIXe siècle : rôle de l’Institut canadien, fondé à Montréal en 1844, dans la formation des élites, recul de la main-mise du clergé catholique sur l’éducation et la vie politique. Certains patriotes sont, à ce moment-là, favorables à une annexion du Canada-Est par les États-Unis.
Un premier navire de guerre français est de retour à Québec en 1855 dans le cadre des accords commerciaux de Napoléon III avec la couronne britannique.
L’autrice présente les leaders politiques : George-Etienne Cartier, Antoine-Aimé Dorion, Joseph Charles Taché et leurs querelles qui débouchent sur des négociations, avec les Canadiens de l’Ouest, vers le fédéralisme. Dans ce contexte, on note à la fois que le mouvement féminin de revendication politique se développe dans les années 1860 et que la question autochtone est désormais du ressort fédéralLoi sur les Indiens 1876 qui est une régression des droits découlant du traité de Paris. C’est une politique d’assimilation forcée qui se met en place.
C’est dans ce contexte que se déroule l’affaire RielL’Appel de l’Ouest – La Vérendrye, Louis Riel et leurs intrépides compagnons, Renée Joyal, Québec, ED. Septentrion, 2023, la défense des droits des Métis, contre le transfert des terres de la compagnie de la Baie d’Hudson au gouvernement fédéral. Louis Riel devient le symbole de l’héritage culturel de la Nouvelle-France.
Dans le même temps, l’Église catholique conservatrice s’oppose au pouvoir politique et soutien un projet de colonisation du territoire québécois notamment par le développement de l’industrie forestière. L’action de quelques leaders est mis en avant : le curé Latreille, le journaliste Jules-Paul Tardivel. L’autrice fait une place particulière au Premier ministre du Québec Honoré Mercier, défenseur d’une autonomie provinciale, promoteur du développement économique avec la mise en valeur de l’Abitibi, défenseur de la culture québécoise et favorable aux relations avec la France.
En cette fin du XIXe siècle, on assiste à une migration vers les industries en plein développement en Nouvelle-Angleterre. 325 000 Québécois partent vers le Massachusetts, le Maine, Rhode Island, le New-Hampshire ou le Vermont.
Guerres et crises 1896-1929
Le premier Francophone qui accède au pouvoir fédéral est Wilfrid Laurier, un libéral, favorable au compromis.
En cette fin de XIXe siècle, les femmes célibataires propriétaires et veuves obtiennent le droit de vote aux élections locales malgré l’hostilité du conservateur et nationaliste Henri Bourassa. C’est aussi le moment d’une forte immigration européenne aux dépens des communautés autochtones, chassées de leurs terres tandis que leurs enfants sont enfermés dans des pensionnats.
L’autrice évoque les oppositions politiques dans un Québec qui se modernise et où les petits exploitants se regroupent en coopérativesCoopérative d’Alfonse Desjardins, 1913.
La Première Guerre mondiale entraîne la crise de la conscription refusée par les Canadiens francophones en 1917. Le fossé politique est aggravé par la popularité des idées communistes, heurts avec les clérico-nationalistes du chanoine Groulx. L’analyse de la presse permet de décrire les évolutions politiques. La crise de 1929 touche fortement l’industrie montréalaise.
La « Grande noirceur » 1930-1959
Cette période de difficultés économiques et de fort chômage est marquée par le développement du syndicalisme. En 1940, les femmes obtiennent le droit de vote et d’éligibilité total.
Comme pour la Première Guerre, les Québécois dont majoritairement hostiles à la participation au second conflit mondial avant que le choc de la défaite française incite à accepter la mobilisation, sauf parmi les membres de la Ligue pour la défense du Canada et ceux du Bloc populaire. Cette attitude s’explique, au moins en partie, par l’unilinguisme anglophone de l’armée. Il existe aussi, au Québec, un certain attrait pour Vichy, et même le nazisme.
Au plan politico-économique, on note la nationalisation de l’hydro-électricité : Hydro-Québec.
L’après-guerre voit le succès de Maurice Duplessis et un renouveau des relations avec la FranceCoopération universitaire : Pierre Deffontaines et Raoul Blanchard enseignent la géographie, André Latreille l’histoire, dans les universités de Montréal et Laval à Québec..
Le 21 janvier 1948 est adopté le nouveau drapeau fleurdelisé du Québec.
Au plan économique et social, des grèves et des manifestations ouvrières, soutenues par le clergé se développent dans les mines et dans l’industrie textile, en 1949.
Vers un Québec souverain ? 1960-1967
Les années 1960 sont caractérisées par ce qu’on appelle la « Révolution tranquille ». Les réformes politiques du gouvernement Jean Lesage s’inscrivent dans un recul de l’influence du clergé : éducation, santé, la construction de grandes infrastructures et le relance des relations avec la France.
Dans le même temps, dans le contexte de la décolonisation, le mouvement indépendantiste renaît avec le Front de libération du Québec, en 1963. L’autrice met en lumière l’essor du cinéma québécois. Cette période de modernisation se clôt sur l’Exposition universelle de 1967.
Le tournant de Gaulle 1967-1969
Tout un chapitre est consacré à la visite du général de Gaulle et sa formule : « Vive Montréal, Vive le Québec… Vive le Québec libre » qui a pu légitimer le combat indépendantiste comme le souligne René Lévesque.
Ce voyage renforce les liens avec Paris. Le Québec se présente comme le défenseur de la langue française partout au Canada. La Loi sur le bilinguisme de 1969 garantit l’usage du français dans les services publics de tout le pays.
Cependant l’incident dit du « Lundi de la matraque » qui oppose Pierre Elliott Trudeau, favorable à l’Union à la foule ouvre une période d’hostilités entre le gouvernement fédéral et les aspirations à l’autonomie du Parti québécois.
En cette fin des années 1960, un fort mouvement féministe est incarné par le Front de libération des femmes, proche des autonomistes.
Un État francophone en Amérique 1970-1980
La francophonie facilite l’arrivée massive de migrants haïtiens, fuyant le régime de « Papa Doc » et chiliens après le prise du pouvoir de Pinochet.
Au plan politique, on assiste à une instabilité, avec l’opposition entre Robert Bourassa et le FLQ. L’autrice relate la crise d’octobre 1970 et la répression fédérale.
La politique économique de développement de l’hydroélectricité a pour conséquence de remettre au premier plan la question autochtone. L’Association des Indiens du Québec fait appel à l’histoire des droits territoriaux pour défendre les intérêts des communautésReconnaissance et exclusion des peuples autochtones au Québec du traité d’alliance 1603 à nos jours, Camille Girard, Carl Brisson, Québec, Presses de l’Université Laval, 2018.
L’échec social de Bourassa assure le succès de René Lévesque. La Loi 101, d’août 1977, fait du français la langue officielle unique du Québec.
Entre deux référendums 1980-1995
Les années 1980 sont occupées par la question de la loi constitutionnelle du Canada et la place du Québec dans la fédération.
L’autrice montre comment les projets, non sans difficultés, de Pierre Elliott Trudeau de détacher le Canada de la couronne britannique en rapatriant la constitution, entraîne un échec du mouvement souverainiste québécois, lors des référendums.
Les relations avec les France sont moins politiques qu’économiques.
La question autochtone est vive durant ces années, comme lors de la « crise d’Oka »Le refus de l’installation d’un golf sur un cimetière mohawk provoque manifestations et répression violentes. Sur ce thème voir : « C’est le Québec qui est né dans mon pays ! », Emanuelle Dufour, Québec, Ecosociété éditions, collection Ricochets, 2021.
Le nouveau Québec 1996…
Ce dernier chapitre s’ouvre sur le rayonnement culturel du Québec (Céline Dion, Marie-Claire Blias, Les Cowboys fringants, Xavier Dolan…), en particulier en France et les évolutions sociétales comme le phénomène des SnowbirdsCes Québécois qui s’installent en Floride fuyant l’hiver. Le Québec s’inscrit dans la consommation mondialisée.
Le libéralisme économique entraîne une crise sociale : chômage, recul des services publics. L’autrice présente les alternances au gouvernement québécois et les différentes positions des présidents français sur la question québécoise.
Le 400e anniversaire de la fondation de Québec, en 2008, est l’occasion de nombreuses manifestations tant au Québec qu’en France.
Un paragraphe est consacré à l’évolution de la question autochtone et à la gouvernance.
Le propos va jusqu’aux dernières élections avec la présentation des nouveaux partis et acteurs politiques, y compris indépendantistes.
Un ouvrage qui embrasse l’histoire de cette région d’Amérique, jusqu’aux tous derniers épisode. Dans son épilogue, Adeline Vasquez-Parra souhaite avoir dépassé plusieurs mythes, le pari est réussi.
On peut cependant regretter l’absence de bibliographie. Les références sont à chercher dans les notes des différents chapitres.