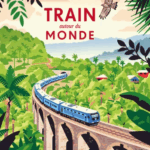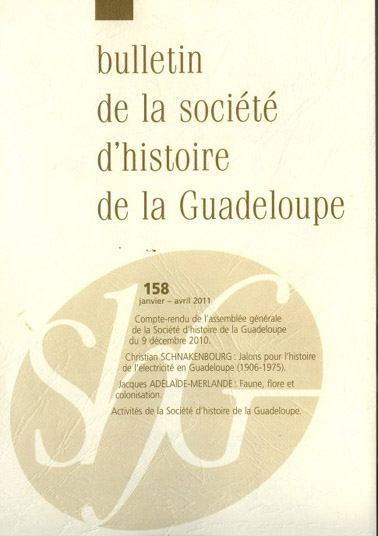
La Société d’histoire de la Guadeloupe
La Société est aujourd’hui présidée par Jacques Adélaïde-Merlande, professeur émérite à l’UAG. Comme toutes les sociétés savantes, elle s’interroge sur ses perspectives et envisage un éventuel changement de nom de ce bulletin qui n’en est pas moins dépouillé systématiquement par la Bibliographie annuelle d’histoire de France, la base de données FRANCIS (INIST) ou la Handbook of Latin American studies publiée par la Library of Congress de Washington. Son champ n’est pas limité à la seule Guadeloupe puisqu’on peut y lire des contributions sur d’autres espaces, notamment les autres îles de la Caraïbe.
Il est dommage que cette revue soit très peu connue d’universitaires et d’enseignants de France métropolitaine qui donnent parfois l’impression de découvrir, notamment sur la question de l’esclavage, des choses dont beaucoup sont publiées depuis longtemps dans cette publication. Ce bulletin a exploré de nombreux thèmes parmi lesquels les épidémies (le choléra de 1865, Dominique Taffin), la gestion des risques, notamment le cyclone de 1928 (Guy Stehle), la démographie et les attitudes devant la vie et la mort (Raymond Boutin), les protestants et les juifs des Antilles (Gérard Lafleur), l’indemnité versé aux maîtres en 1848 (Alain Buffon). La liste ne saurait être exhaustive. Depuis les années 1980, la revue, jusque là limitée à l’archéologie précolombienne et à l’histoire de l’esclavage et des activités économiques (industrie sucrière, distillerie, économie de la banane) publie de plus en plus d’articles d’histoire contemporaine touchant aux techniques, à la santé, au genre, aux questions monétaires ou au politique.
Le numéro 157 (septembre-décembre 2010, 152 p.)
Ce numéro présente six contributions sur des sujets variés. Jean-Sébastien Guibert Collègue d’histoire géographie, doctorant à l’UAG. aborde la question du développement portuaire de Pointe-à-Pitre, port dont il faut rappeler au non initié qu’il est créé par les Britanniques lors de l’occupation de la Guerre de Sept ans (« De Saint-Martin à Pointe-à-Pitre : le développement portuaire de la Guadeloupe à travers l’administration du gouverneur Pierre Gédéon de Nolivos, 1765-1768 »). L’auteur s’intéresse au projet du gouverneur de créer un port franc à Saint-Martin, contre le principe de l’Exclusif et avec l’objectif annoncé de servir aussi bien la métropole et la colonie. Il en analyse l’échec qui conduit à un projet de développement de Pointe-à-Pitre, mieux adapté aux ruptures de charges et moins dangereux pendant la saison cyclonique (ou hivernage pendant le second semestre de l’année).
La contribution de Roméo Terral Collègue d’histoire géographie, doctorant à l’UAG. concerne la ville de Pointe-à-Pitre au moment du départ du gouverneur Félix Éboué en 1938 («La ville de Pointe-à-Pitre du cyclone de 1928 au départ du gouverneur Félix Éboué : le virage vers la modernité ? »). Là encore, il faut préciser que le cyclone est une date charnière en Guadeloupe pour l’urbanisme et l’architecture, comme en témoignent les nombreuses mairies et églises de béton dessinées par Ali Tur au début des années 1930, en vue des festivités du Tricentenaire du rattachement des Antilles à la France (1935). Confrontée à une extension anarchique, la ville est particulièrement touchée par le Grand cyclone. L’auteur s’emploie à analyser les mutations urbaines et les solutions concrètes d’amélioration de la vie des habitants. Il aborde pour cela la question de la mobilité de la population, entre crises sucrières et catastrophes naturelles, qui a pour conséquence la multiplication des cases rurales en ville. De nouveaux migrants arrivent d’Italie ou des protectorats français du Levant pour colporter ou travailler comme maçonsLes Guadeloupéens d’origine italienne ou syro-libanaise sont aujourd’hui des composantes connues de la société guadeloupéenne.. Les migrants italiens servent comme maçons jusqu’à ce que les Guadeloupéens se familiarisent avec ce matériau nouveau. L’auteur analyse également les mutations idéologiques et sociales en s’intéressant à la gouvernance des travaux, dont la commune est exclue au profit de l’État et de la Colonie. Il analyse ensuite l’administration de Félix Eboué, marquée par le progrès en équipements sportifs, l’administration du Travail et de la Prévoyance sociale ou la volonté de progrès culturels. On note que cet effort d’amélioration de l’habitat s’interrompt avec la guerre pour ne reprendre qu’en 1959 avec la municipalité issue du PCG.
Avec «Les violences conjugales : bilan des recherches et des plans d’actions dans la Caraïbe anglophone», Clara Palmiste ATER UAG, Docteur de l’Institut universitaire européen de Florence. fait le point sur ce qui représente un grand débat institutionnel caribéen depuis les années 1980 et qui relève d’une pratique tolérée dans tous les milieux. Son analyse replace la question dans le contexte des différentes dispositions internationales qui s’y rapportent, notamment la Convention de Beijing sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention on the Elimination of all forms of Discriminations against Women (CEDAW-1995).. Il se trouve que contrairement à Cuba et aux Antilles française ou néerlandaises, les États de la Caraïbe anglophone ont pour la plupart fourni un rapport à la CEDAW, avec, pour l’essentiel, des analyses fondées sur les statistiques pénales. On relèvera que, selon le sexe des interviewés, entre la moitié et les trois-quarts des Jamaïcains battraient leurs compagnes pour 1/4 dans les Iles vierges britanniques. La violence masculine semble corrélée à une sociabilisation précoce privilégiant les modèles agressifs et qui se nourrit de l’insécurité financière, émotionnelle ou sexuelle. Clara Palmiste s’intéresse ensuite aux actions menées à Belize, Trinidad & Tobago et en Jamaïque. Il est patent que les changements législatifs ne produisent des effets qu’avec une meilleure prise en charge des victimes par la police.
André Castaldo Professeur émérite à la faculté de Droit de Paris II (Panthéon-Assas). revient sur la législation esclavagiste dans « Les “Questions ridicules” : la nature juridique des esclaves de culture aux Antilles ». Dans un développement linéaire, il se livre à une démonstration en 179 points-paragraphes de l’ambiguïté de la condition des « nègres de jardin » (esclaves de culture), réputés bien meubles, «s’ils ne sont attachés à la terre». Pour lui, l’article 48, qui dispose d’une forme d’attachement de l’esclave à la terre, ne relève pas du droit romain mais d’une pratique coloniale soucieuse de protéger la production locale.
La contribution s’achève sur les considérations d’Émilien Petit, qui notait en 1777 que ce genre de propriété n’était pas dans la nature des choses et de Dupin qui y voyait une « dérogation au droit sacré de la nature ».
Dans une brève mise au point, Éveline Bouclier professeur des écoles retraitée présente « Les journées du patrimoine aux Archives départementales ». Le numéro se clôt sur une autre page consacrée à la Semaine du livre d’histoire (mai 2010) en Guadeloupe, organisée par les membres de la Société, l’Université (UAG) et l’Inspection.
Le numéro 158 (janvier-avril 2011, 95 p.)
La société laisse souvent à un seul auteur un volumineux espace d’écriture pouvant faire un seul numéro. C’est presque le cas avec celui-ci, dont 82 pages sur 95 accueillent la contribution de Christian SchnakenbourgProfesseur à la Faculté d’économie et de gestion, Université de Picardie-Jules Verne.. Cet économiste de formation est connu pour la somme impressionnante de travaux historiques qu’il a consacrés à la Guadeloupe, notamment à l’industrie sucrière ou à la question du rôle de la Banque de la Guadeloupe dans la question du change en 1904. Il a récemment soutenu une thèse sur l’histoire des migrations indiennes en Guadeloupe, laquelle peut offrir un instrument de comparaison à nos collègues et futurs collègues inscrits aux concours 2012 : 7 % des Indiens du British Raj arrivés dans la Caraïbe ont en effet migré vers la Guadeloupe Il faut rappeler que, contrairement au monde britannique caribéen où cette migration est financée par des intérêts privés, le coût en est supporté dans le cas français par la colonie elle-même après un vote du Conseil général, largement acquis aux intérêts sucriers dans les années 1850..
L’auteur reste modeste : sa contribution intitulée « Jalons pour l’histoire de l’électricité en Guadeloupe » propose plus que des jalons pour l’histoire d’une question énergétique qui reste un enjeu (et un indicateur) majeur du développement. Elle paraît d’autant plus utile que la Guadeloupe n’avait pas été abordée dans un récent colloque sur l’électrification de l’empire colonial. Après divers atermoiements pour le premier tiers du XXe siècle, l’électrification est réalisée au moyen d’une concession de la colonie à une entreprise privée, la SCODEL, dont la mainmise s’exerce sans contrepartie sur la fourniture d’électricité jusqu’en 1950.
L’auteur nous montre comment l’empire peut offrir une opportunité aux petites entreprises d’électricité mais joue sur les échelles en démontrant comment le premier groupe chargé d’électrifier la Guadeloupe apparaît à l’échelle micro-insulaire comme une pieuvre qui étend ses tentacules, surtout quand elle prétend également s’occuper de la distribution d’eau. Ainsi, la convention de 28 millions de francs proposée en 1929 par le groupe Munich correspond à 43 millions de francs de 1938. Or, l’électrification achevée en 1937 par une autre société (la CGDE) représente un coût de 23,6 millions de francs de 1938 correspondant à 13 % du programme de travaux engagé après le cyclone de 1928.
Cette contribution questionne aussi le rôle de l’empire comme béquille d’une partie du capitalisme français, paradigme mis en évidence par la thèse de Jacques Marseille que l’auteur cite évidemment au passage. Affirmant clairement une socialisation des pertes et une privatisation des profits, Christian Schnakenbourg pose le problème du retour sur les investissements coloniaux et du financement public des équipements les plus coûteux et les moins rentables au profit d’intérêts privés. On retrouve également la problématique d’une gouvernance embarrassée par la technicité des dossiers et dépendant des techniciens, comme le montrent les difficultés des élus du Conseil général (dans l’entre-deux guerres des enseignants, instituteurs, avocats et quelques propriétaires et distillateurs) avec les clauses du contrat signé avec la compagnie. C’est d’ailleurs l’embauche par le Conseil général, d’un spécialiste de électricité qui permet de sortir de cette situation de pilotage sans visibilité. Sans doute faut il préciser aux lecteurs de cette chronique, surtout s’ils ont des tendances cartiéristes, que l’argent public dont il est question ici est celui de la colonie, c’est à dire du contribuable guadeloupéen et non celui de la métropole.
Le numéro comporte également une brève contribution de Jacques Adélaïde-Merlande, qui a sans doute exploré la plupart des sujets d’histoire et qui s’intéresse cette fois-ci à la découverte de la faune et de la flore par les colonisateurs : « Faune, flore et colonisation ». En s’appuyant sur les écrits du Père Dutertre, chroniqueur du XVIIe, l’auteur montre par exemple, comment, loin de notre notion élémentaire de développement durable, on a chassé le lamantin pour sa chair, sans même se soucier de préserver l’espèce, ne serait-ce que pour des chasses ultérieures.