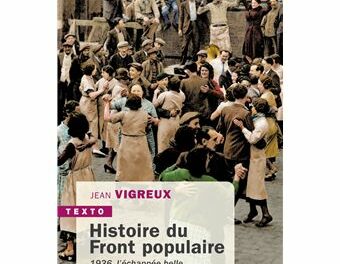Pour autant, l’auteur s’étonne du grand silence sur les violences de guerre comme objet d’étude, voire des stratégies d’évitement du sujet mises en place par les chercheurs qui craindraient de se voir taxés de sensationnalisme ou de lecture politiquement incorrecte à décrire les massacres dans leur crudité et leur réalité. La première partie de l’ouvrage, déclinée en deux chapitres, confronte, parfois de façon longue et fastidieuse, l’expérience de guerre de jeunes chercheurs en sciences sociales et l’empreinte qu’elle a laissée dans leur œuvre et dans leur champ de recherches. Stéphane Audoin-Rouzeau prend pour exemple archétypal l’œuvre de Norbert Elias à propos de laquelle aucune autre que la sienne « n’a fait autant pour exclure le phénomène guerrier du champ d’investigation des sciences sociales ». Jeune engagé volontaire en juillet 1915, envoyé sur le front oriental puis sur le front Ouest dont l’intensité guerrière est plus marquée, plus tard exilé d’Allemagne , en 1933, vers la France, puis dans l’Angleterre en guerre entre 1939 et 1945, la jeunesse d’Elias est totalement traversée par la guerre. Or, précise l’auteur, son œuvre refoule cette prégnance guerrière tout particulièrement l’expérience individuelle des champs de batailles. Et alors ? Le succès de des travaux d’Elias en France aurait des rebondissements sur la marginalisation de la guerre et de l’expérience individuelle de guerre dans le champ de la recherche : ils n’auraient « pas aidé à préparer les sciences humaines et sociales à une prise en compte des violences de guerre par elles-mêmes ».
Historiens et anciens combattants
Le deuxième chapitre reste centré sur l’étude et la confrontation œuvre/expérience personnelle de chercheurs dans le cadre des deux guerres mondiales. L’auteur part d’un constat : le premier 20ème siècle a « transformé le combat en obligation sociologique de masse, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour beaucoup d’hommes d’âge mûr ». La mobilisation s’est de fait traduite par une forte militarisation de la population masculine : 70 millions d’hommes ont pris les armes en occident entre 1914 et 1918, 87 millions entre 1939 et 1945. Quel impact dans le champ des sciences sociales ? Stéphane Audoin-Rouzeau l’aborde à travers l’expérience de jeunes spécialistes en sciences sociales déjà engagé dans leur vie et leurs recherches au moment de se convertir en acteurs de la violence de guerre. Ainsi les anthropologues Robert Hertz et Marcel Mauss ou les historiens Richard Tawney, Marc Bloch et Pierre Renouvin.
Le cas de ce dernier est intéressant : 21 ans en août 1914, mobilisé dans l’infanterie au printemps suivant, amputé du bras gauche à l’issue d’une attaque en avril 1917, Renouvin est le seul historien ancien combattant qui, toute sa vie, reste centré sur la première guerre mondiale comme objet d’étude. La encore (l’exercice frise la redondance) l’auteur traque les brefs passages de l’œuvre de l’historien. La encore : refoulement. Les lignes et ouvrages de Renouvin, complètement centrés sur les relations internationales, évitent d’aborder les comportements individuels face au déploiement d’une violence de guerre inattendue. Lorsqu’ils sont esquissés, ils sont fondés sur un savoir indirect, jamais sur sa propre expérience de guerre. Etonnante trajectoire que celui de l’historien de la première guerre mondiale qui pendant un demi-siècle fait de ce conflit le cœur de ses travaux de recherches en refoulant un aspect central du conflit.
Violence de guerre, dissimulée ou montrée ?
L’attitude de son confrère britannique Richard Tawney, 34 ans en 1914, qui fait figure, comme Marc Bloch (qui écrit davantage sur le fonctionnement de la société combattante que sur l’expérience personnelle de la violence de guerre), d’intellectuel engagé dans les débats contemporains tranche : dès 1916, il publie un article de presse dans lequel il dévoile la violence combattante, en particulier à travers son expérience propre.
Il faut attendre le dernier chapitre (p 239-315) pour entrer avec l’auteur dans la « physicalité du fait guerrier ». L’activité combattante s’inscrit d’abord sur les corps. Ce que viennent confirmer des sources littéraires et autobiographiques (voir l’ouvrage de Paul Fussel et son CR sur ce site) ou des sources médicales, jusqu’alors peu exploitées dans cette perspective. Plusieurs éléments de la physicalité combattante sont envisagés. À commencer par les lieux des combats. Ces lieux qui conditionnent un type d’affrontement particulier (espace dégagé, forêt, jungle, espace urbain ou désert…) ces lieux travaillés, remués par les ravages de « l’armement moderne ». De même les objets sont-ils des acteurs essentiels. Ainsi l’arme, rendue proche, vivante voire intime par sa proximité permanente avec le combattant-guerrier, son contact tactile. Ainsi l’uniforme, « cette enveloppe militaire des corps ». Stéphane Audoin-Rouzeau aborde ensuite brièvement la part des corps animaux, encore fort présents à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème : les pigeons ou les chevaux, par la suite « transmutés » en avions et autres chars… Enfin sont abordés les apports et les rapports des images à l’imaginaire de guerre, des premières photographies de reporters lors de la guerre de Sécession aux images fortes de la guerre du Vietnam, en passant par celles de Capa. Images qui cachent, images qui montrent les corps… de l’ennemi.
On retrouve ici une partie de ce que les professeurs de l’enseignement secondaire auront à profit de tirer de deux ouvrages du même auteur, plus efficaces et plus utiles pour la préparation des cours et la sensibilisation au sujet: le deuxième volet de La guerre au XXème siècle publié par la documentation Française en 2004 ( Documentation photographique n°8041, 1- L’expérience combattante) et le très beau livre édité conjointement par l’Historial de Péronne et le CRDP de Picardie en 1995, Combattre , premier volume d’une collection qui, arrêtée à deux ouvrages, aurait fait le bonheur des professeurs d’histoire et géographie avec une suite plus fournie.
Patrick MOUGENET © Les Clionautes