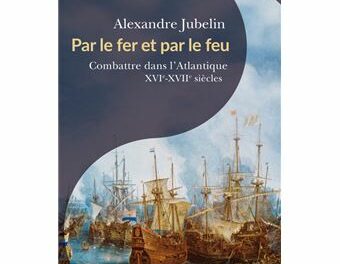Fruit de la convergence entre le besoin d’argent chronique de la monarchie et sa répugnance à convoquer les États Généraux pour lever de nouveaux impôts, la croissance de la civilisation de l’office est sensible au XVIIe siècle. Opérateurs d’une délégation de la puissance publique qui en fait des rouages essentiels de l’état moderne, mais aussi, selon une belle formule de Jean Nagle, « actionnaires de la gloire du roi » par le biais du mécanisme de la vénalité, les officiers se multiplient. Leur effectif double de 1573 à 1665. Une identité autonome émerge de leur force numérique et de leur cohésion collective. La construction symbolique d’un quatrième ordre informel s’opère alors selon un mécanisme de double distinction par rapport à la noblesse et au peuple.
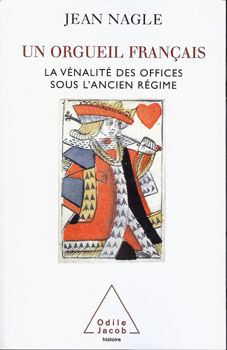
L’auteur situe l’essence de l’identité officière dans une duel dialectique entre l’honneur et la dignité. Le premier, vertu d’essence chevaleresque et attribut de la culture nobiliaire réfugiée dans les emplois curiaux et militaires, subirait une décadence progressive, supplanté par la dignité, posture associée au besoin de représentation de l’office et à l’idéologie du service public. Revisitée comme un passage de la pulsion affective à la conscience rationnelle, cette relève fait de l’office un outil décisif de la construction de l’individu moderne. Pivot de cette conversion, la dignité, vertu bureaucratique nécessaire à l’incarnation d’une parcelle de pouvoir régalien, a l’inamovibilité pour substrat. Conjuguant gravité et honorabilité, elle associe l’essor de la conscience de soi (et donc de l’autonomie de la personne) à un combat pour l’estime sociale. Dans le fil de ce raisonnement, Nagle postule la vénalité comme le socle de l’édification de l’état de droit, la dignité souveraine de l’office étant à ses yeux l’étape préalable à l’élaboration de la dignité personnelle, dont la diffusion à tout le corps social constitue la porte d’entrée dans la représentation politique démocratique.
Ce tableau émancipateur devient plus contradictoire lorsqu’il s’agit de scruter les relations ambivalentes entre la caste officière et le peuple. Dans son acharnement à se distinguer du commun, la première aurait élaboré les représentations d’une société du mépris intellectuel et culturel envers le peuple, animalisé et barbarisé. Mais elle n’en aurait pas moins joué par ailleurs, nous dit l’auteur, un rôle déterminant d’instituteur de celui-ci. Au-delà de la revendication politique formulée par les juges, prétendant à un rôle protecteur vis-à-vis de l’arbitraire monarchique par substitution aux États Généraux évincés, Nagle leur impute également le statut de médiateurs du rôle acculturant des techniques de la procédure, dont l’usage et la publicité ont développé l’idée d’égalité civile. Ainsi, nourrie par la pensée humaniste puis philosophique, la culture judiciaire serait le prisme par lequel le peuple aurait acquis le sentiment de sa propre estime. De ce fait, l’universalisation de la notion bourgeoise de la dignité serait un outil clé de la définition de l’homme égalitaire accouché par la Révolution Française.
Le champ politique n’est pas le seul affecté par la dynamique de la promotion de l’office. Élargissant leur influence à la sphère culturelle, l’auteur en vient à considérer les officiers comme la véritable force motrice d’une nouvelle synthèse des mœurs. Il fait ainsi remonter le début de la prise de pouvoir moral de la bourgeoisie aux modalités de l’institution vénale de l’administration royale. Emplis du sentiment de leur dignité fonctionnelle, les gens de l’office seraient dès lors devenus les agents de la révolution des mœurs. Nagle restitue à leur entremise le passage de la courtoisie à la politesse, la diffusion de pratiques modernes d’hygiène et d’alimentation, et la naturalisation de nouveaux codes de la préséance et de l’apparence. Exemple évocateur, perruques et cannes, deux des attributs emblématiques de la construction et de la lecture des hiérarchies officières dans l’espace social, se muent sous le règne de Louis XIV en signes adoptés par l’ensemble de la société, personne royale incluse. En décentrant ainsi de la Cour vers la Ville le rôle prescripteur des normes sociales, Nagle adopte un point de vue rénovateur qui s’inscrit en dissidence par rapport au modèle de domination formulé par Norbert Élias.
On l’aura compris, cet ouvrage est riche en perspectives nouvelles, ouvertures fécondes et réinterprétations stimulantes. Mais leur articulation est brouillée par un certain éparpillement du propos, d’autant que le flot touffu des citations risque d’égarer ponctuellement le lecteur dans la libre flânerie de l’essayiste. On surprend d’ailleurs ce dernier à faire l’école buissonnière, musardant au creux d’angles accessoires à son sujet tels que l’examen (du reste intéressant) de la hiérarchie des villes en relation avec la pyramide judiciaire du royaume. On peut davantage déplorer que l’auteur se borne à esquiver une objection de fond à sa vision de la confrontation dialectique entre la dignité et l’honneur. Car, si on conçoit bien sa nécessité logique pour le besoin de la démonstration, l’affirmation d’un antagonisme entre la robe et l’épée demeuré irréductible jusqu’en 1789 laisse néanmoins sceptique, tant le modèle développé par l’auteur dénie les indices notoires de fusion sociale et culturelle entre ces deux mondes. Démentant le titre choisi, Jean Nagle ne formule donc pas un système de l’office d’Ancien Régime. Mais il ouvre les portes par lesquelles se laissent entrevoir des lectures nouvelles de ce moment et de ses représentations. Les voyageurs du temps apprécieront sans nul doute de suivre ce guide un peu bohème mais incontestablement inspiré.