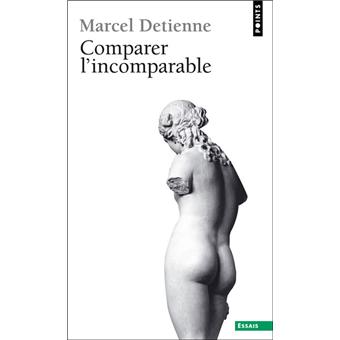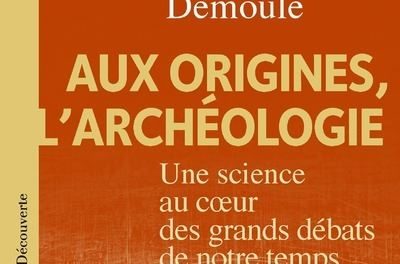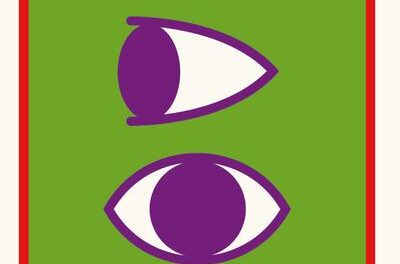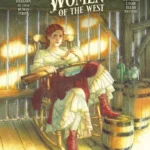Autre élément important, l’émergence de la Nation et l’enfermement dans le National qu’elle entraîne. Il faut ainsi attendre 1986 pour qu' »un département de l’Université française habilité à former des anthropologues » soit créé (26). Dès 1888, les Hautes Études créaient une chaire consacrée aux « religions des peuples non civilisés ». En 1951, Cl. Lévi-Strauss, son nouveau titulaire, en modifie le titre. Désormais, ces peuples sont sans écriture, donc sans histoire. La Nation étant par nature historique, car née de la Révolution, est un Incomparable et l’anthropologie ne doit donc comparer que ce qui est comparable ; tout comme l’historien. En effet, rien n’interdit à ce dernier de comparer des sociétés par nature proche, celle des Grandes Nations européennes. La même tendance s’observe dans tout l’Europe. Une fois ces explications données (17-39), D. s’interroge (41-59). Mais quand même, à quoi bon comparer ? Sa réponse ne manque pas de finesse. « Non pas pour trouver ou imposer des lois générales qui nous expliqueraient enfin la variabilité des inventions culturelles de l’espèce humaine, le comment et le pourquoi des variantes et des constantes. Comparons […] pour construire des comparables, analyser des microsystèmes de pensée, ces enchaînements découlant d’un choix initial, un choix que nous avons la liberté de mettre en regard d’autres, des choix exercés par des sociétés qui, le plus souvent, ne se connaissent pas entre elles » (57-58). Il met en outre en avant une dimension éthique. Les connaissances acquises par ce comparatisme permettent de vivre avec les autres.
Une fois la méthode définie, il faut montrer la pertinence d’une telle approche. D. relève le défi et donne autour de quelques thèmes l’exemple de ce qu’aurait pu être son enseignement au Collège de France si la chaire d’anthropologie comparative de la Grèce ancienne avait été créée. Il retient l’historicité (61-80), le polythéisme (81-104) et les pratiques d’assemblée (105-127).
Sur cette dernière question, l’ouvrage de D. est particulièrement intéressant car il touche à l’Incomparable même, la démocratie née en Grèce et développée en Occident (mouvement communal italien) jusqu’à son aboutissement avec la Révolution. Cependant, depuis quelques dizaines d’années, les ethnologues et certains historiens ont découvert des pratiques d’assemblée dans lesquelles il est difficile de voir des influences grecques. « Les Ochollo des monts Gamo, habitant l’Éthiopie du Sud depuis le XIXe s., ne semblent pas avoir consulté les archives communales de Sienne ou d’Arezzo ; et les cosaques de Zaporojie au XVe s. n’ont pas nécessairement trouvé dans l’Iliade, et encore moins sur le site de Mégara Hyblaea, le principe de l’agora et du cercle de l’assemblée communautaire » (106-107). Le comparatisme permet ici de réfléchir aux commencements et aux aspects concrets de l’assemblée.
Le commencement se traduit par une prise de conscience de la communauté d’elle-même. Dans le cas de la Grèce ancienne, cela se traduit par un lieu dédié à la collectivité, l’agora (exemple de Mégara Hyblaea, cité fondée par des Mégariens en Sicile au VIIIe s.). Dans celle-ci, on s’assemble et on débat des affaires publiques en suivant un rituel comme des exemples pris dans les poèmes homériques le montrent. La comparaison avec les pratiques naissantes des Constituants en 1789 est éclairante. On perçoit la réflexion autour de la forme du lieu qui doit accueillir l’assemblée, -c’est finalement la demi-ellipse qui est choisi avec en son centre le président. Cette forme paraît adaptée aux sociétés qui se veulent égalitaires. La disposition est tout autre dans l’Angleterre des Commons ; on s’adresse au président depuis sa propre place.
L’exemple des Ochollo (Éthiopie du Sud) étudié par Marc Abélès révèle une disposition analogue aux Constituants et aux anciens Grecs. « Les assemblées plénières, préparées et convoquées par des personnages ad hoc, se déroulent à l’intérieur d’un cercle de pierres dressées, taillées en forme de sièges. Qui demande la parole aux présidents s’avance dans le cercle de manière à faire face à l’assemblée » (113-114). Il y a peu, les femmes ont obtenu le droit de participer à ces assemblées au même titre que les hommes. Jusque là, elles avaient le droit de parler en restant à la limite du cercle.
La diversité chronologique et spatiale des pratiques d’assemblée doit nous amener à réfléchir à la décision qui est à l’origine de la réunion, décision qui varie selon les contextes. Pour les Grecs, le partage du butin a eu une grande importance, ce qui n’est pas le cas des communes italiennes mais des cosaques…
Cet exemple montre à quel point la démarche comparatiste défendue par D. donne à l’historien des éléments de compréhension neufs et éclairants. Certes, parce qu’il s’agit d’une recherche en cours, la comparaison ne se révèle pas toujours aussi efficace que son zélateur le souhaiterait. Du reste, D. reconnaît que l’essentiel du travail reste à faire, par exemple dans le cas de l’étude des régimes d’historicité. Mais qu’importe, en prenant le risque de défendre une démarche qui n’a pas encore fourni tous les résultats attendus, il ouvre des pistes de réflexion, propose une méthodologie et amorce des conclusions lorsque cela est possible. Le lecteur y trouve donc largement son compte et il ne prend plus garde au ressentiment exprimée par D. de ne pas avoir été élu au Collège de France. Il nous faut souhaiter que cette invitation au travail sur des thèmes communs entre historiens et anthropologues aboutisse à des réalisations concrètes qui valideront pleinement la démarche comparatiste.
Par Christophe Pebarthe