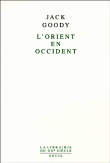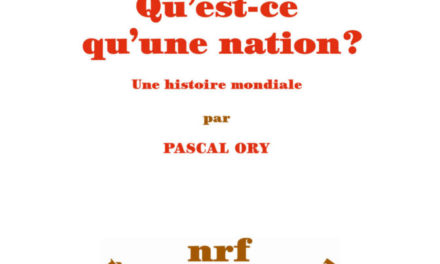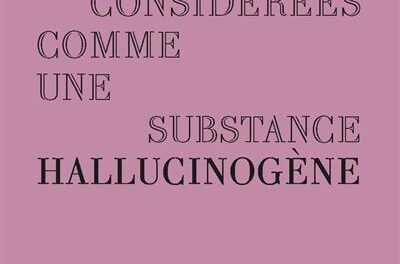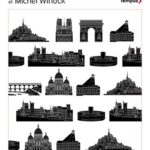Mais au XXe s., les auteurs ne nièrent plus la qualité du développement oriental à l’époque médiévale. Dès lors la question posée concerne le non développement du capitalisme en Orient avant l’époque contemporaine. J. Goody passe en revue un certain nombre d’explications traditionnelles et il les critique.Puis, il pose le problème : comment expliquer la prééminence de l’Occident entre la Renaissance et l’époque contemporaine ? En même temps, il précise qu’il rejette toute idée de coupure radicale et que le progrès fut irrégulier mais continu. L’enjeu est simple : produire une explication qui s’applique à toutes les prééminences, même à celle de l’Orient sur l’Occident. Pour cela, J.Goody entend interroger de nouveau les spécificités occidentales dans le domaine de la famille, dans celui du commerce et dans celui de la rationalité en se méfiant des explications « culturalistes » (16). Il avoue y avoir cédé. « J’ai avancé naguère, ‘collant’ de trop près à la tradition humaniste, que l’Occident avait un ‘avantage comparatif’ dû au développement de l’écriture alphabétique en Grèce » (on peut renvoyer à La raison graphique, Paris, Minuit, 1979 et La logique de l’écriture, Paris, Colin, 1986 qui cependant attestent déjà de son évolution. Ce n’est que dans son article fondateur « The Consequences of Literacy » paru dans la revue Comparative Studies in Sociology and History 5, 1963, p. 304-345, écrit avec I. Watt, que son déterminisme alphabétique est le plus évident. Dès 1968, dans l’ouvrage qu’il dirige, Literacy in Traditional Societies, Cambridge, il remarque que ces conclusions doivent être modérées à la lumière du cas de la Chine).L’étude attentive menée par J. Goody met en évidence plusieurs points.
D’abord, rien ne permet d’affirmer une quelconque supériorité de la rationalité des Occidentaux par rapport à celle des Orientaux (19-65). Bien plus, toutes les cultures connaissent la logique, même si toutes ne possèdent pas « les lois formelles de la contradiction ni les procédures logiques formelles qui caractérisent les Grecs à l’époque d’Aristote » (24). De fait, il n’est plus possible de suivre Weber lorsque ce dernier expliquait l’avènement du capitalisme par le rationalisme moderne occidental. Pour J. Goody, il est vain de chercher le déclencheur car le capitalisme ne procède pas d’une invention mais de l’addition d’événements qui ne sont pas tous européens. « Dans la longue durée, aucune région ne peut être considérée comme responsable à elle seule de la naissance de la société moderne » (57). Pour lui, la modernité se traduit avant tout par un « usage plus large des procédures de rationalisation », dont la logique formelle (58). Les mêmes potentialités de développement se rencontrent en Orient et en Occident et selon les époques l’un fut en avance sur l’autre. La rationalité doit être pensée selon une chronologie et non comme une réalité hors du temps.
Puis, J. Goody critique l’idée de Weber selon laquelle il y aurait un lien entre le capitalisme et la bureaucratie en insistant sur la comptabilité en partie double (« un système à deux colonnes indiquant les débits et les crédits » 78). Seul l’Occident aurait connu la mise en forme monétaire du capital dans le but de la formation d’un profit économique rationnel.
Or, l’étude des archives des sociétés commerciales médiévales montre que l’organisation demeurait rudimentaire dans bien des cas. Il n’est en fait pas certain que les marchands aient perçu l’intérêt de la partie double. Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur le lien entre cette dernière et le développement du capitalisme (80-81). L’utilisation de la partie double ne serait pas indispensable au fonctionnement des entreprises même si de façon générale le recours à l’écriture participe à la prospérité italienne. Du reste, si la partie double fut inconnue dans l’Antiquité méditerranéenne, les hommes du Proche-Orient, puis les Grecs, recoururent à une « rationalité de la comptabilité monétaire », dans le domaine privé, comme dans le domaine public avec la gestion des palais. Cette valeur de l’écrit se retrouve également dans le Coran. En bref, il est pour le moins aventureux d’affirmer que la partie double est à l’origine du capitalisme.
Pour renforcer sa démonstration, J. Goody décrit une entreprise indienne visitée par lui-même en 1987 qui, pour sa comptabilité, recourait encore au système « à l’italienne », c’est-à-dire à une série de livres pour noter les dépenses et les recettes et à un autre livre pour résumer les transactions, sans utilisation de la partie double (94). Pourtant, le commerce ainsi traité connaît une certaine envergure. En somme, il y a lieu de douter de l’affirmation de nombreux chercheurs occidentaux qui voyaient dans la comptabilité « rationnelle » ce qui avait manqué à l’Orient pour son décollage.
Ensuite, J. Goody décrit le commerce et l’économie de l’Inde au Moyen Âge et à l’époque coloniale afin de montrer que certaines régions extra-européennes connurent à l’époque de l’économie féodale un développement qui pourrait être assimilé aux débuts du capitalisme moderne (107-144). Il apparaît alors très clairement que le dynamisme de l’économie indienne pré-industrielle remonte au Ier s. p.C. et ne s’explique pas par l’irruption des Européens et de leur commerce. Cependant, l’arrivée de ces derniers eut pour conséquence une forte augmentation de la production à tel point qu’à la fin du XVIIe s. des mesures protectionnistes furent décidées sans avoir les effets escomptés (145-175).
Mais cela ne doit pas faire oublier le reste du réseau commercial qui allait de l’Afrique à la Chine et qui ne fut pas touché par les Européens. Ces derniers, ayant pris conscience de la concurrence et de l’importance du marché de la cotonnade, développèrent l’emploi de la machine dans la production. Cinquante ans plus tard, dans la première moitié du XIXe s., les Indiens achetèrent des machines aux Européens pour développer leur filière textile. Mais les choses avaient changé. Les Anglais avaient pris de l’avance et ils avaient donc fait baisser les prix. De plus, le développement du réseau ferré donnait aux villages de l’intérieur de l’Angleterre un accès direct aux cotonnades britanniques.
Toutefois, la production indienne ne disparut pas et le filage à la main continua d’avoir une certaine importance, importance renforcée par les actions de Gandhi. La croissance de l’industrie indienne s’est poursuivie et elle n’a pu avoir lieu qu’à cause du niveau atteint précédemment, en dehors de l’Europe. Le décalage chronologique dans les dates du décollage entre l’Europe et l’Inde s’explique avant tout par le rythme différent de la transformation du capital commercial en capital industriel.
Après avoir montré que ni la rationalité, ni la comptabilité « rationnelle » faisaient défaut à l’Orient, J. Goody en vient à la question de la famille (176-263). En effet, Weber, et d’autres avec lui, pensait que les entreprises familiales étaient un obstacle au développement et que l’individualisme était une condition de l’avènement du capitalisme. Or, il n’est pas possible de réduire l’Orient à des relations de parentés, le voisinage compte aussi. De plus, les rapports de parenté ont également participé au développement industriel indien. Ainsi, il existe en Inde des firmes familiales qui se distinguent dans l’industrie. Ces entreprises ne sont pas réduites à l’artisanat et à l’agriculture. En outre, les membres de ces communautés familiales possèdent une certaine autonomie leur permettant de mener des affaires pour leurs propres comptes. De même, ces entreprises familiales peuvent recourir à des capitaux extérieurs, tout en profitant du réseau étendu offert par la famille ainsi que des fonds pour des placements à long terme.
Mais alors, pourquoi les chercheurs se sont-ils obstinés à affirmer que la famille constituait un blocage pour l’économie en Orient et pourquoi pensaient-ils que le rôle de la famille était marginal dans le capitalisme en Occident ? J. Goody répond à ces questions en rappelant que les villes italiennes médiévales ont participé à la naissance du capitalisme, sans mariage tardif et sans marche vers la famille nucléaire. De plus, aujourd’hui, le développement industriel des pays asiatiques oblige à reposer le problème différemment. L’absence de mariage tardif et de famille à souche n’empêche pas le décollage économique, comme le cas de la Chine le démontre.
Menée en parallèle, l’étude de la situation en Occident permet d’affirmer que la famille élargie y a joué un grand rôle dans le développement économique. Les banques sont par exemple souvent à base familiale. Certes, les compagnies par actions constituent une étape ultérieure dans le développement. Mais cela ne suffit pas pour construire une opposition entre un monde agraire traditionnel et un monde industriel moderne. En effet, au sein de ce dernier aussi, certaines familles continuent de posséder des entreprises ou de participer activement à leurs gestions.
D’autres explications ont été avancées pour expliquer l’avance de l’Occident (264-290). Certains ont ainsi affirmé que le capitalisme se fondait sur le travail libre. Or ce dernier existait également dans des sociétés pré-industrielles. De plus, la notion de liberté dans le travail peut être critiquée. Pour ce faire, J. Goody rapporte une anecdote (268-269). En 1952, pour le couronnement d’Élizabeth II, il accueillit le président de la Gold Coast. Il lui fit visiter une usine dans laquelle des jeunes femmes fabriquaient à la chaîne des postes radiophoniques. L’Africain posa alors à l’anthropologue la question suivante: sont-elles des esclaves ? Car pour lui, il n’était pas concevable que des êtres humains libres acceptassent de travailler dans de telles conditions. De même, les plantations de coton dans le Sud des États-Unis ont représenté sans doute une forme de capitalisme, alors qu’elles utilisaient une main d’œuvre servile. En réalité, un système économique donne à une forme d’organisation une efficacité maximale, sans l’inventer et sans faire disparaître les autres forcément.
Au total, il y a a deux façons de regarder l’Orient et l’Occident. La première insiste sur la spécificité de chacun. La deuxième met en avant « l’héritage commun des deux versants de l’Eurasie depuis la révolution urbaine de l’âge du bronze et l’introduction, à cette époque-là, de nouveaux moyens de production (une agriculture et un artisanat évolués, avec une métallurgie, l’usage de la charrue, de la roue, etc.) et de nouveaux champs de savoir » (291). Cela ne doit pas mener à nier les spécificités culturelles de l’Occident. Mais il n’est pas possible d’expliquer une avance temporaire par des avantages permanents, comme le manque d’une certaine rationalité ou d’un certain modèle familial.
A la fin du Moyen-Âge, la Chine avait une avance de développement sur l’Europe. Elle disposait d’un vaste marché intérieur, d’une faible imposition étatique et religieuse, d’un puissant secteur productif… L’existence d’un système centralisé n’était pas contradictoire avec l’existence de situations de marché concurrentielles. L’avance de l’Occident sur l’Orient alterne avec l’avance de l’Orient sur l’Occident, en fonction des freins et des coups d’accélérateur de chacun (298). Il ne faut donc plus penser en terme d’étape car cela ne permet pas de penser l’alternance observée (318-319). Il est donc nécessaire de partir de l’héritage commun de ces sociétés issues de l’âge du Bronze. Parmi les facteurs qui ont permis à l’un ou à l’autre de prendre de l’avance à un moment donné, il y a sans aucun doute l’écriture, qu’elle soit alphabétique ou logographique (307-308). Il montre ainsi que son approche n’est en rien déterministe car le rôle de l’écrit s’inscrit dans une société et dans une période données et que ses effets ne sont pas identiques selon les situations.
On le voit, le livre de J. Goody est d’une grande importance car il revisite certaines idées trop facilement acceptées jusque là et il les confronte aux réalités. De ce point de vue, la description de l’Inde médiévale et moderne est fascinante tant elle nous révèle un monde inconnu en grande partie jusque là, en complète opposition avec l’histoire ethnocentriste et évolutionniste qui domine encore souvent les manuels du secondaire et bon nombre d’ouvrages universitaires.
L’anthropologue britannique donne ici à son lecteur une véritable leçon d’honnêteté intellectuelle et il rappelle à l’historien qu’il n’est de modèle théorique sans source. En même temps, il démontre par l’exemple que l’époque des grandes synthèses n’est pas révolue mais que d’une part leur rédaction impose une rigueur de tous les instants et une érudition sans faille et que d’autre part elle n’implique pas un langage confus et abscons.
Ce n’est pas le moindre paradoxe que de recevoir une leçon d’histoire aussi magistrale de la part d’un anthropologue. Il reste aux historiens, et aux lecteurs intéressés, à l’entendre dans toute sa finesse et sa profondeur pour en nourrir leurs réflexions ultérieures.