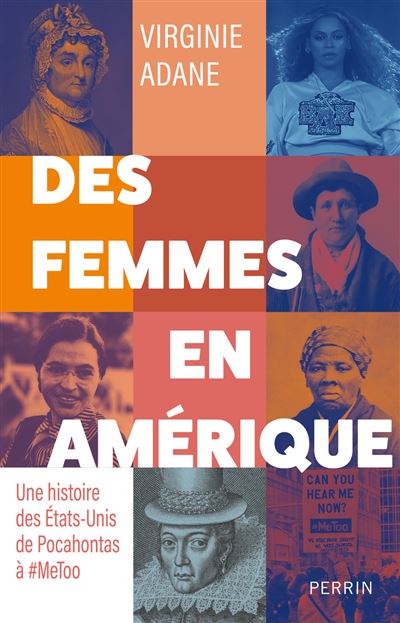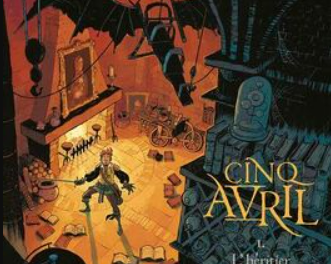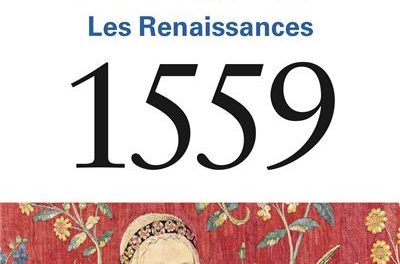Virginie Adane propose une histoire des Etats-Unis en 20 jalons, incarnés par 20 figures féminines. Le choix repose sur la grande diversité des parcours : contextes historiques différents, inégalités sociales et raciales.
L’ouvrage s’ouvre avec le mythe de Pocahontas, développé par John Smith près de 17 ans après les faits. La jeune Powhatan est en réalité une enfant d’une dizaine d’années, vantée pour sa conversion et son mariage ultérieur avec un Anglais. Au XIXe siècle, une vision romantique se développe, reprise ensuite par Disney. Les sources sont exclusivement britanniques et ne permettent pas d’appréhender le vécu de Pocahontas. Si les peuples amérindiens sont nombreux, les femmes occupent généralement une place centrale dans leurs mythologies, qui associent souvent une agricultrice et un chasseur. Virginie Adane rappelle aussi que la domination coloniale et raciale passe par le contrôle de la sexualité. D’autre part, elles ont souvent joué le rôle d’interprètes voire de chefs politiques. Elles sont ramenées à un rôle traditionnel par les colons, qui occultent la participation des femmes aux rapports de force et aux processus de négociation et de collaboration.
Les sources sont encore plus rarissimes pour Angela, femme esclave capturée dans le royaume de Ndongo, actuel Angola : un trajet et un prénom, donné par son maître, c’est tout. L’historienne rappelle les conditions du trajet et les souffrances particulières endurées par les femmes : accoucher à bord, les violences sexuelles dès la traversée de l’Atlantique. Elles ne sont pas considérées comme des mères car elles mettent au monde des esclaves qui sont vendus à l’arrivée.
Les femmes européennes qui s’installent en Amérique ne sont pas majoritairement des « filles de mauvaise vie ». Les « filles du Roy » sont généralement des orphelines, issues de familles désargentées, qui partent avec une dot accordée par le roi, se marier dans les colonies. Parmi les passagers du Mayflower, on dénombre 18 femmes et 12 filles (sur 102 personnes). Trois de ses femmes sont enceintes, deux accouchent à bord dans des conditions extrêmement difficiles. Par « sécurité », à l’arrivée, les femmes restent à bord, dans une atmosphère propice aux maladies, tandis que les hommes rejoignent la terre ferme. Un an plus tard, 14 de ces 18 femmes sont mortes. Cependant, les femmes choisissent généralement d’être accompagnées d’un homme pour migrer. Certaines se marient à bord, d’autres se travestissent. Thomas(ine) Hall, personne intersexuée élevée comme une fille, décide d’adopter une identité masculine pour partir. Jugée pour écrits sexuels, la Cour lui demande de choisir une identité sexuelle. Iel explique s’être adapté(e) en fonction des opportunités de travail. Ainsi, l’identité masculine lui semblait probablement plus sûre pour migrer. Les migrantes célibataires sont généralement des engagées ou des religieuses.
Virginie Adane évoque aussi des figures exceptionnelles telles que Margaret Hardenbroeck, femme d’affaire à poigne, qui agit en son nom propre (même quand elle se remarie) en tant d’armatrice de navire et marchande d’esclaves. Elle obtient, malgré les Actes de navigation, la permission de continuer le commerce avec les Provinces-Unies. Les premières années de la colonisation, malgré les risques, sont ainsi une période d’opportunité pour les femmes. Elles travaillent, elles héritent plus fréquemment même lorsqu’elles ont des enfants, leur rôle économique est reconnu dans le foyer où elles gèrent les comptes comme au dehors. Dans les sociétés européennes maritimes, les femmes sont amenées à prendre en charge les affaires de leur mari lorsqu’ils sont en mer, les femmes de ces milieux sont élevées pour gérer des affaires. Le rôle essentiel des femmes autochtones et l’existence de réseaux commerciaux entre celles-ci et les Européennes sont aussi évoqués. Autre cas exceptionnel : celui d’Hannah Dustan, enlevée alors qu’elle venait d’accoucher. Son bébé est exécuté, elle est soumise à des marches éreintantes avant de mener une révolte avec sa nourrice et un codétenu, qui aboutit au meurtre et au scalp d’une dizaine d’Abénaquis. Ce cas est l’occasion d’évoquer les transgressions de genre dans les colonies.
Esther Edwards Burr, fille et femme de pasteur et impliquée dans le mouvement religieux du « Grand Réveil », est l’occasion d’évoquer le rôle des femmes dans la religion. Parfois mises en valeur, le prêche est, excepté chez les Quakers, interdit aux femmes. Il est ainsi considéré comme une transgression de genre et les expose à des peines judiciaires (prison, coups de fouet). Jemima Wilkinson, quaker convertie à l’évangélisme, va plus loin en affirmant être morte en tant que femme et exister en tant d’Ami universel public, vêtu de vêtements androgynes. Elle livre ainsi des prêches itinérants.
Phillis Wheatley, esclave, reçoit une instruction étonnement complète et devient poétesse, elle est ensuite affranchie. Convertie au christianisme en plein « réveil », elle écrit sur sa foi et sur son existence de femme plutôt que sur l’esclavage. Elle constitue une exception. Son parcours est l’occasion d’évoquer les spécificités de la condition d’esclave pour les femmes, notamment en ce qui concerne la maternité et les liens familiaux. L’éducation de leurs enfants ou de ceux privés de leur mère sont un domaine où de nombreuses femmes esclaves s’affirment.
Abigaïl Adams est une figure de la révolution américaine de 1776, elle est souvent présentée comme une figure féministe. En effet, elle a rappelé à son mari « N’oubliez pas les dames » pendant la rédaction de la Déclaration d’indépendance, l’avertissant du risque d’une rébellion si « un pouvoir illimité » revenait aux hommes. Les lettres du couple ont été conservées, à l’inverse d’autres correspondances de pères fondateurs avec leurs épouses. Cette déclaration reste cependant une déclaration privée, dans le cadre de l’intimité d’un couple. Elle montre cependant une pensée politique construite et que la Révolution suscite des attentes chez les femmes. En effet, ces dernières ont participé activement à la contestation du pouvoir britannique, dans les idées comme dans les actes. Abigaïl Adams écrit ainsi en 1776 : « Si nous voulons avoir des Héros, des Hommes d’Etat et des Philosophes, nous devons avoir des femmes éduquées ». Les femmes s’affirment comme des « mères républicaines », selon l’expression de l’historienne Linda Kerber. Les activités domestiques sont au coeur de l’action politique des femmes, notamment au sein des « Filles de la Révolution ». Par exemple, les séances de filage en public permettent de produire des textes pour limiter les exportations. Le travail des femmes se fait ainsi visible et sert la Révolution américaine par une prise de position publique. Pendant la guerre, les femmes s’imposent à l’arrière, gèrent la maison et les affaires. C’est le cas d’Abigail Adams qui prend les rênes de la ferme familiale. Elles obtiennent aussi un dédommagement pour le logement des soldats. Mais elles sont exposées largement aux violences, notamment sexuelles. Si au niveau fédéral, les femmes n’obtiennent pas de droits politiques, les disparités sont grandes à l’échelle des Etats. En 1776, le New Jersey accorde le droit de vote aux femmes, certes révoqué en 1807, mais cela montre qu’il y a eu un débat autour du vote féminin et qu’il a été envisagé.
Judith Sargent Murray dénonce dès 1790 les inégalités hommes/femmes : « Pourra-t-on dire que le jugement d’un garçon de deux ans est plus sage que celui d’une fille du même âge ? ». Elle réclame un accès à l’éducation pour les femmes, qu’elle décrit comme essentiel pour participer à l’éducation des jeunes citoyens. Elle ne remet pas en cause l’existence de rôles séparés pour les femmes et les hommes. La femme doit être ainsi une « maîtresse de maison utile ». Ceci dit, la fonction domestique maternelle des femmes prend ici un sens politique. Linda Kerber a ainsi qualifié la maternité de « quatrième branche du gouvernement » (avec le législatif, l’exécutif et le judiciaire). Cet idéal ne concerne que les femmes de la bourgeoisie blanche, les autres foyers ne peuvent pas se passer du travail féminin. Quant aux esclaves, elles subissent une situation à l’inverse de cet idéal de féminité. Les femmes autochtones sont incitées à adopter un mode de vie anglo-américain et à abandonner leurs activités traditionnelles pour se consacrer à un rôle domestique. Les femmes prennent cependant position sur des sujets politiques comme la tempérance et la lutte contre l’alcoolisme, mais aussi en faveur de l’abolition de l’esclavage ou les droits des populations autochtones.
Harriet Farley fonde le premier périodique rédigée par des mill girls, des ouvrières. Destinée à leurs familles et à leurs camarades, The Lowell Offering touche une large audience, diffusée jusqu’aux milieux féministes en Angleterre. La vie ouvrière, malgré ses difficultés, est vectrice d’opportunités et d’émancipation, ceci dans un contexte où le travail des femmes est perçu négativement. Les ouvrières bénéficient d’une entraide dans le quartier ou dans le cas des villes-usines comme Lowell vivent en communauté. Elles participent à des luttes collectives. A partir des années 1840, le caractère émancipateur disparaît avec le changement du recrutement. Les filles de fermiers sont remplacées par une main d’oeuvre immigrée, notamment irlandaise. L’économie de plantation domine cependant et les Southern Belles ont peu en commun avec les mill girls : Annie Fitzgerald est une fille de planteur, mariée, au temps de la guerre de Sécession, à un officier confédéré. Elle oeuvre pour récupérer son ancien statut à la sortie de la guerre et entretenir la nostalgie d’un Sud perdu. Elle aurait inspiré le personnage de Scarlett O’Hara, mais le roman masque le fait que beaucoup d’épouses de planteurs défendent le système esclavagiste, parfois avec ferveur. Les violences physiques des maîtresses d’esclaves envers les femmes asservies sont plus fréquentes que celles des hommes.
Parmi les femmes esclaves qui résistent, Harriet Tubman est une grande figure de la lutte pour l’abolition. Bénéficiant de l’aide du chemin de fer clandestin, elle guide ensuite 19 convois. Elle se distingue aussi pendant la guerre de Sécession, notamment lors de missions d’espionnage et par sa participation à la libération d’environ 750 esclaves.
Des figures féminines incarnent aussi la Conquête de l’Ouest malgré son imaginaire très viril. Calamity Jane, éclaireuse pour l’armée, est connue pour ses exploits. Au delà de la légende, il semblerait qu’elle ait été lingère et prostituée pour les soldats. Elle s’est distinguée par ses talents de conteuse et en participant à des wild west shows. Le mythe de la frontière développé par Turner laisse d’autre part peu de place aux femmes. En réalité, le gouvernement promeut le modèle de la famille blanche avec une politique d’attribution des terres qui leur est favorable. Les femmes jouent un rôle essentiel car elles sont vecteurs de stabilité et perçues comme garantes de la moralité. Leur travail domestique permet aux hommes de se consacrer pleinement à la mise en valeur du terrain. En 1900, 4 Etats américains accordent le droit de vote aux femmes, ce sont tous des Etats de l’Ouest. D’autres lois leur sont favorables, notamment sur le divorce et les salaires. Ainsi, une législation vise à attirer les femmes sur ces terres, mais cela concerne les femmes blanches. Sarah Winnemucca Hopkins, une femme paiute qui a été envoyée très jeune auprès des pionniers comme domestique afin de recevoir une éducation anglophone. Elle joue le rôle d’intermédiaire en devenant interprète puis institutrice, mais milite aussi auprès de l’opinion publique. Elle publie la première autobiographie d’une femme autochtone.
Louisa May Scott, autrice de Little Women (Les Quatre Filles du Doctor March) propose un roman d’apprentissage pour jeunes filles. Il n’échappe pas totalement aux conventions des années 1860 malgré la jeunesse peu conventionnelle de l’écrivaine. Elle reçoit en effet une éducation poussée et la maison familiale abrite une étape du chemin de fer clandestin. Infirmière dans le camp nordiste pendant la guerre de Sécession, elle refuse de se marier à son retour. Elle fait se marier Jo March, son alter-ego, dans la suite de Little Women. Le roman ne montre pas l’effondrement économique du Sud à la sortie de la guerre ni la politique d’Andrew Johnson, marqué par le racisme et la volonté d’affaiblir l’État fédéral. En effet, la quête d’indépendance de Jo March a pour décor New York où le contexte est bien différent. Les grandes villes du Nord sont marquées par l’industrialisation et l’arrivée massive d’une main d’œuvre immigrée. Les femmes ne sont pas absentes de l’espace public et s’engagent notamment dans des mouvements ouvriers féminins.
L’engagement politique des femmes concerne également l’accès au vote. Susan B. Anthony décide par exemple d’aller voter dans l’Etat de New York aux élections présidentielles de 1872 avec 14 autres femmes. Elle argumente sur l’interdiction de lois « limitant les privilèges des citoyens » en s’appuyant sur la Constitution. Partisane de l’abolition de l’esclavage, son engagement pour le vote est parfois teinté de racisme. Ida B. Wells lutte pour le droit de vote des femmes noires, ainsi que contre les lynchages. En 1919, le 19e amendement accorde le droit de vote aux femmes, mais les Amérindiennes en sont exclues, et des restrictions subsistent pour les femmes noires.
Alice Ball et Margaret Chung, grandes scientifiques, respectivement Africaine-Américaine et sino-Américaine, sont des exceptions, mais permettent d’évoquer la « nouvelle femme », terme qui désigne les femmes des années 1890 à 1920. Les changements sont en effet multiples : éducation, vie professionnelle, vêtements moins contraignants, loisirs, vie sentimentale plus libre. Les travaux de Margaret Rossiter ont mis en avant les blocages que subissent les femmes dans le monde scientifique, ainsi que leur invisibilisation : c’est l’effet Matilda. Virginie Adane évoque également le rôle des femmes dans le cinéma.
Rosie la riveteuse, représentation inspirée par plusieurs munitionnettes, est une image iconique de la propagande. Elle a contribué à redéfinir la place des femmes dans le conflit. Si l’affiche la plus connue, We can do it! d’Howard Miller, circule très brièvement en 1942 avant d’être massivement diffusée à partir de 1982, d’autres représentations similaires sont réalisées pendant la guerre. Au delà de l’image, le travail effectué par celles qu’on appelle les « Rosie » est bien réel et physique. Il pose la question de la « masculinité » de ces ouvrières et du retour au foyer après la guerre. Leur travail est perçu comme une remise en cause de l’ordre social. Même si le travail des femmes ne commence pas à l’entrée en guerre, les deux conflits mondiaux diversifient leurs opportunités avant de les restreindre. Les femmes s’engagent aussi progressivement dans l’armée à partir de 1918, même si leurs fonctions restent genrées : cantinières, infirmières, secrétaires.
Le chapitre consacré à Rosa Parks tend à repolitiser son action, en montrant qu’elle est une militante de longue date. Elle a par exemple enquêté sur le viol collectif de Recy Taylor par des Blancs. Virginie Adane replace aussi le boycott des bus à Montgomery dans le contexte d’un long mouvement pour les droits civiques dans lequel les femmes jouent un rôle central (Une synthèse d’Olivier Mahéo revient sur l’historiographie récente sur le sujet). Ce sont ainsi avant tout les femmes qui organisent le boycott des bus, elles s’emparent aussi de sujets qui les concernent comme celui des violences sexuelles. Cependant, si elles participent activement au travail de terrain, les directions des mouvements des droits civiques ont tendance à les reléguer au second plan.
En 2022, la décision Dobbs v. Jackson révoque de fait l’arrêt Roe v. Wade qui garantissait depuis 1973 le droit à l’avortement. « Jane Roe » est un équivalent de « Madame X » qui garantit l’anonymat à Norma McCorvey, mère célibataire qui porte la question de l’avortement devant la cour suprême. Ce combat est là encore replacé dans un contexte plus large, l’impact de la publication de La femme mystifiée de Betty Friedan, co-fondatrice de la National Organization for Women (NOW) ou celui des premiers travaux d’histoire des femmes. Lors du débat autour de l’ERA, Equal Rights Amendement, projet de 20e amendement, la vision progressiste et féministe se heurte à une vive réaction des milieux conservateurs autour de Phillis Schlafly. Cette opposition persiste, Virginie Adane évoque la vague #MeToo mais aussi les Trad Wives, héritières modernes de Phillis Schlafly.
Beyoncé permet d’évoquer les liens entre féminisme et culture pop, de Miss America à la poupée Barbie. Un dernier chapitre évoque la candidature à la présidence de Kamala Harris et la « persistance d’un plafond de verre » en politique.
Un livre passionnant, qui livre une autre version de l’histoire étatsunienne en replaçant les femmes au coeur des grands événements de l’histoire américaine et des combats pour la liberté.