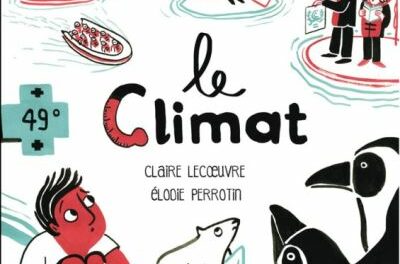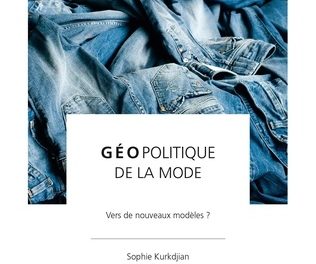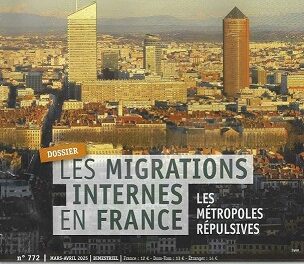L’ouvrage que nous présente Laurent Cailly, maître de conférences HDR en géographie à l’université de Tours, spécialiste du périurbain, entend contribuer à l’approfondissement des connaissances et au renouvellement du regard sur l’habitabilité du périurbain en France. Le phénomène de desserrement urbain et de méga-périurbanisation ne semble s’être arrêté, il aurait même continué à augmenter, notamment avec la crise sanitaire. « L’attraction du pavillon ne se dément pas », affirme Martine Berger dans un article paru en 2010 dans Élire domicile (Presses universitaires de Lyon). La périurbanisation joue aujourd’hui un rôle important dans la reconfiguration des espaces urbanisés et a dépassé le simple stade du fait périurbain. Comme le montre très bien Laurent Cailly, la périurbanisation est un espace de conquête et de réalisation sociale qui permet à certaines strates des classes moyennes de trouver leur place.
Pour approfondir l’analyse des modes d’habiter périurbains contemporains et la manière dont ils participent aux transformations sociales et spatiales des périphéries urbaines, Laurent Cailly propose d’interroger les liens entre mobilités spatiales, quotidiennes et résidentielles, et modes d’habiter. Ainsi, la mobilité résidentielle, c’est-à-dire les habitats successifs dans lesquels un individu a vécu depuis l’origine, est source de socialisations, d’expériences et d’apprentissages plus ou moins diversifiés. Le travail de Laurent Cailly repose sur l’analyse de plusieurs enquêtes qualitatives menées dans le cadre de différents programmes de recherches entre 2009 et 2016 par le laboratoire CITERES (CNRS & Université de Tours). C’est donc sur la base de 250 entretiens semi-directifs et de 100 enregistrements GPS de trajectoires quotidiennes dans les aires métropolitaines de Tours, Grenoble, Nantes et Aix-Marseille que Laurent Cailly a pu arriver à un ensemble de conclusions intéressantes sur les modes d’habiter périurbains.
L’ouvrage comporte cinq chapitres. Dans le premier, l’auteur s’attache à étudier les trajectoires résidentielles et la construction sociale du territoire métropolitaine. Ensuite, ce sont les formes de mobilités quotidiennes qui sont analysées. Un troisième chapitre s’intéresse à la métropolisation et aux modes d’habiter périurbains. La chapitre quatre développe un nouveau paradigme pour analyser la mobilité périurbaine : la territorialité mobile. Un dernier chapitre évoque des pratiques et trajectoires mobilitaires qui pourraient être considérées comme émergentes.
Le travail, tout à fait remarquable de Laurent Cailly, tant au point de vue de la méthodologie que des conclusions, montre, par exemple, que les trajectoires et les stratégies résidentielles des ménages exercent un rôle décisif dans l’organisation et la différenciation sociales du territoire métropolitain. Elles illustrent à la fois des logiques de transaction à double sens entre le centre et les périphéries mais également de véritables logiques d’organisations internes aux périphéries.
Les enquêtes menées auprès des périurbains ainsi que les trajectoires quotidiennens par GPS montrent l’existence de cinq profils métropolitains. Les « bords d’agglomération » et « métropolitains » concernent plus des ¾ des habitants. Ces profils ont intégré la territorialité globale de l’aire métropolitaine. Leurs déplacements sont giratoires ou en faisceau. S’ils sont une conscience du quartier où ils résident, leur territorialité urbaine est avant tout globale et globalisante. Elles offrent une particularité face aux autres types de profils tels que les « reclus » et les « villageois », ceux pour qui la mobilité intra-métropolitaine est plus réduite et se cantonne à la rue ou au quartier au sens large.
L’histoire résidentielle de l’individu structurent sur le plan affectif les sensibilités et les goûts qui participent à la reproduction des modes de vie. Ainsi, l’attachement à l’environnement périurbain en général, au territoire de résidence en particulier ou le rapport distancié à la ville-centre explique très souvent le mode d’habiter des « reclus » et des « villageois ». La mobilité est alors, pour Laurent Cailly, une possibilité de territorialité nouvelle ou autre ; reprenant ici les travaux de Denis Retaillé (2005) : « le mouvement n’est plus un déplacement, une crise, mais la possibilité d’une production d’espaces et de lieux ». Les déplacements pendulaires domicile-travail sont-ils considérés par Laurent Cailly comme des « sas spatio-temporel ». Quel que soit le mode de transport utilisé, l’espace-temps du déplacement est approprié par des logiques d’usage, des relations sociales, des représentations liées au vécu du déplacement. Laurent Cailly parle même de « territorialité mobile ». Le déplacement domicile-travail est « une coupure qui fait lien ». Comme l’exprime un usager : « C’est le moment où l’on passe d’un état de travail à un état de… dans le cercle privé ». C’est un sas entre deux sphères d’engagement : l’espace travail et l’espace privé.
L’intérêt que Laurent Cailly a su porter aux navetteurs et l’espace-temps de la « navette » domicile-travail ouvre des perspectives sur une notion-clé, la trajectoire mobilitaire. Cette notion est définie par l’auteur de la manière suivante : « La notion de trajectoire de mobilité [mobilitaire] appréhende ces changements sous l’angle d’un continuum, et non sous la forme d’une succession de ruptures. Elle s’intéresse à l’ensemble des caractéristiques de la mobilité, qu’elle considère comme faisant partie d’un système évolutif dont il s’agit de retrouver les dynamiques d’évolution et les structures d’ordre pour essayer de dégager des régularités. » (Cailly et al., 2020). La trajectoire mobilitaire s’intéresse aux stratégies et aux choix opérés en matière de trajectoire ; à l’évolution des contextes sociaux, familiaux, professionnels ou géographiques qui caractérisent le parcours biographique de l’individu ; au vécu de la mobilité. La trajectoire mobilitaire d’un individu au long de sa vie peut être « cartographiée » sous la forme d’une frise temporelle oscillant entre différentes composantes : le vécu, les valeurs-ressources-dispositions, les opportunités, la situation professionnelle, la trajectoire résidentielle et la situation familiale. L’auteur donne l’exemple de celle de Mme Da Silva dans un article écrit avec l’urbaniste Marie Huygue et le sociologue Nicolas Oppenchaim.