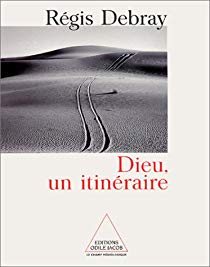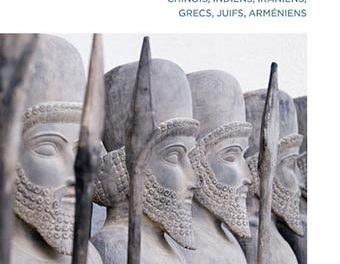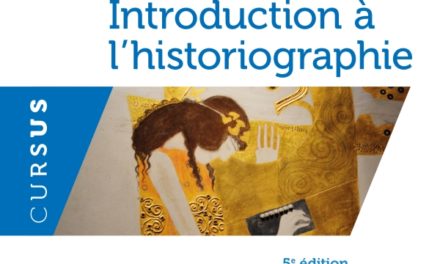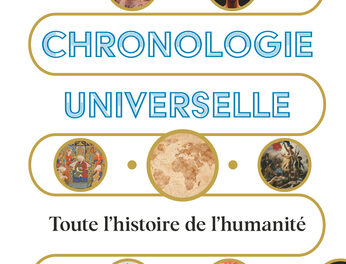Il est besoin, de prime abord, d’agréer le style de l’auteur. D’aucuns le jugeront élégant, stimulant, revigorant. Ils loueront la pertinence et l’ironie du style, la pointe à l’occasion acerbe de l’auteur, l’érudition avérée du propos, le caractère édifiant des exemples choisis, l’impossible remise en cause des aphorismes tant le propos est parfois asséné. D’autres considéreront que le parti pris d’objectivité de l’auteur le pousse à multiplier les comparaisons choquantes, que l’on ne peut réduire le chrétien « à un spectateur de cinéma qui a payé son billet et attend toujours le début depuis 20 siècles » (p. 192), qu’il est blasphématoire d’assimiler l’eucharistie à une « culmination dégustative, masticatoire, de l’union des âmes à Dieu » (p. 204), qu’il est un raccourci déplacé de faire de Lénine le « saint Paul de Marx » (p. 217), qu’il est attentatoire à la foi des chrétiens de voir dans le mystère de la virginité préservée de Marie une froide et technicienne « insémination artificielle » (p. 259). N’eût-il point été possible de préserver recul et distanciation à l’encontre du fait religieux tout en respectant – par des formulations moins à l’emporte-pièce – la foi de chacun et faire pièce, ce faisant, à un prosaïsme certain. Le chercheur en sortirait grandi. En outre, à la lecture du texte, le lecteur sera mis en demeure d’accepter un opus qui ne concerne que le christianisme, le judaïsme et, dans une très moindre mesure, l’islam.
L’un des intérêts premiers de l’ouvrage est de s’intéresser – dans une perspective médiologique chère à l’auteur – sur les moyens de corrélation entre « nos fonctions sociales supérieures (religion, art, idéologie, politique) et nos procédés de mémorisation, déplacement et organisation » (p. 18). A cette aune, Régis Debray pose les schèmes paradigmatiques d’analyse du fait religieux- dont le géographe et l’historien peuvent faire leur miel dans leur propre démarche heuristique – à savoir la mise en exergue, dans chacune des religions, « d’un organisme spirituel (famille, nation, église, secte, etc), et un appareil mnémotechnique (rouleaux, livres, effigies, figures, etc) » (p. 21). Ces deux paramètres, selon l’auteur, expliquent que la transcendance puisse s’ancrer dans les mémoires humaines et dans les paysages géographiques. D’autant qu’une « matière organisée ou MO (stèle, dalle, croix ou monticule) » (p. 22) se rappelle – de manière récurrente – au bon souvenir des fidèles, ces derniers étant intégrés dans une « organisation matérialisée ou OM – Famille, Collège, Fraternelle, Parti Eglise ou Etat » (p. 22). Les deux composantes (MO et OM) sont alors les garantes de « la mémoire externe » et de « la mémoire interne » (p. 22) propres à chacune des religions.
L’homme : d’abord un être religieux
Brossant à grands traits l’histoire de l’humanité, l’auteur en retient que l’homme est d’abord un homo religiosus et fait un sort rapide à la seule explication génétique et scientifique de l’inclination religieuse de l’humanité (qui ne serait trivialement inhérente qu’aux « bornes neuronales du transport mystique », p. 29). S’interrogeant sur le décalage chronologique entre les premières manifestations religieuses de l’humanité (l’on rappellera, avec Jean Delumeau – in Des religions et des Hommes, Paris, Le Livre de Poche, 2001 -, que les premières tombes datent d’il y a 90 000 ans) et l’affirmation du monothéisme, Régis Debray en déduit que l’idée d’un Dieu abstrait n’était pas énonçable « en delà d’un seuil de domestication minimale de l’espace et du temps » (p. 33) d’autant que la maîtrise de l’écriture s’affirme indispensable pour fixer tangiblement le fonds dogmatique.
D’ailleurs, il démontre que le monothéisme se caractérise par la recherche de la fixation d’une origine religieuse du monde et que, ipso facto, la réalité historique est souvent conditionnée aux impératifs théologiques dans la quête d’une date origine et de grands événements fondateurs. Ainsi, c’est Esdras qui, au VIe siècle av JC, donne tournure au canon biblique juif et, partant, à l’histoire du peuple juif en faisant remonter – à l’origine – des événements relevant de sa propre contemporanéité. L’histoire, ce faisant, est instrumentalisée et la mémoire passe par dessus l’histoire – fût-ce au prix d’anachronismes. De fait, le périple d’Abraham, parti de la cité mésopotamienne d’Ur jusqu’en Egypte pour revenir à Canaan, ferait sens non au XVIIIe siècle av JC, mais quand « il faut ressouder les communautés juives d’Egypte avec celles restées en Mésopotamie autour d’une terre centrale et sainte » (p. 47) lorsque « Esdras a été autorisé, voire incité, par Cyrus et son administration, qui poussaient les peuples soumis à s’autogérer, à remettre de l’ordre dans Jérusalem » (p. 44). Le monothéisme se serait alors antidaté attendu que « transmettre, ce n’est pas sortir à la demande d’un tiroir de bureau, appelé patrimoine ou mémoire collective, tel ou tel document […]. C’est y glisser à mesure du neuf et le mêler à l’ancien, pour donner de la patine à l’inventé et de l’attrait à l’hérité » (p. 47). Il demeure, nonobstant, à définir ce qui est réellement inventé…
La religion et la géographie : l’attachement strict à des lieux connotés
Retrouvant Renan, Regis Debray fait du désert le support paysager de monothéismes aux dogmes universels. Dans sa démonstration, la géographie physique tient une place prévalente. Du Djebel Mousa au désert de la Thébaïde, l’aridité – source de pureté – a attiré les premières formes du cénobitisme et de l’érémitisme. En cela, nihil novi sub sole, n’était le fait que le midbar (le désert en hébreu), où le nomadisme prévaut, aurait rendu impérieuse la présence d’un Dieu « délocalisable et transcendant » (p. 68) cependant que « le pastorat monothéiste ne pouvait apparaître n’importe où sur la croûte terrestre, mais seulement là où la végétation n’était ni trop abondante, ni trop rare » (p. 68). N’est-ce pas là dériver, sur un mode scientiste, vers un trop commode déterminisme géo-religieux ? D’autant que le propos est insistant : pour l’auteur, point de réactivité intellectuelle (donc aussi bien religieuse que technicienne) lorsque la nature est munificente (« l’Océanie par exemple » p. 68). D’ailleurs, à ce déterminisme se surimpose une taxinomie zoologique réprésentative du fait monothéiste : « l’âne s’obstine : la mémoire juive. L’agneau attendrit : l’amour chrétien. Le cheval conquiert : la guerre sainte » (p. 73).
En outre, la géographie physique influe, en partie, sur le médium choisi pour véhiculer le message religieux. De ce support, découle la durabilité du message : la pierre de Syène (Pierre Deffontaines, Géographie et Religions, Gallimard, 1948) des pyramides nilotiques rend permanente la religion égyptienne cependant que les ziggourats en briques (et donc sujettes à l’érosion pluviale et à la déflation éolienne) ont entraîné dans leur disparition le message religieux babylonien. Aujourd’hui, en France, les programmes d’histoire du collège étudient la première et ignore le second. La fortune du judaïsme naîtrait du choix de son double support : le choix de l’écrit avec une langue (l’hébreu) – récusant les lourds pictogrammes du cunéiforme babylonien (qui nécessite de nombreuses tablettes d’argile si l’on veut l’écrire) et empruntant au phénicien son alphabet – ainsi que l’adoption, comme support écrit, du volumen de papyrus (les Hébreux refusant les hiéroglyphes égyptiens mais conservant de leur terre de servitude la matrice – l’auteur évoquant alors un « techno-piratage », p 107). Dès lors, les juifs deviennent d’abord des connaisseurs et des pratiquants de l’écrit et Yahvé « un Dieu littéralisé, traduisible et exportable. En état de voyager et en puissance d’universel » (p. 96). Plus encore, le Dieu des chrétiens est d’abord le Dieu du Livre. Du codex en parchemin (il faut abattre 170 veaux pour obtenir une Bible en vélin), des in octo, in quarto et in folio, le christianisme passe au livre à la Renaissance et, parallèlement, à la Réforme. Dès le XVIe siècle, on compte en effet 438 éditions de la Bible et, de 1517 à 1520, 300 000 exemplaires des écrits de Luther sont publiés. Relayée par le support livresque, l’hérésie luthérienne (aux yeux de Rome) connaît une propagation – qui contraint l’Eglise à se régénérer – sur laquelle les thèses d’un Jean Hus, ou des Lollards n’avaient pu compter et avaient été de facto d’autant plus facilement jugulées par l’Eglise. L’Eglise tridentine redéfinit alors ses fondements et campe sur ses postions tout en donnant, contrairement aux protestants, une place privilégiée à l’image (ce qu’elle avait déjà entérinée dès le concile de Nicée II en 787 lors de la querelle entre iconoclastes et iconodoules). Or, « quand on prône le Verbe, on bride l’image et vice versa » (p. 282).
Le dogme ne s’inscrit pas seulement sur un support : il est présent dans l’espace géographique, marqué par une iconographie spatiale récurrente. Au judaïsme gyrovague succède une judaïsme fixé territorialement sur la Terre promise et polarisé par Jérusalem (ce que l’auteur résume sentencieusement par le passage du « complexe de Moïse » au « complexe de Salomon », p.140). Et l’on retrouve alors les analyses de Mircea Eliade (in Le sacré et le profane, Paris, folio essais, 1965) qui mettent en relief la définition par les religions d’un centre du monde mystique. Le « Dieu atopique » (p. 125) devient le point de cristallisation d’un « refoulé géophage » (p. 145), paradoxe évident pour un monothéisme au propos universel. Cette crispation identitaire territoriale ne laisse pas d’être regrettée par certains religieux, à l’instar du rabbin David Meyer rédigeant dans Le Monde le 9 janvier 2001 (référence citée par l’auteur) un article intitulé « Ni Terre promise, ni Terre sainte ». Les lieux de culte sacré et les lieux saints (là où la transcendance affleure) ne manquent pas d’être revendiqués par les religions, leurs Eglises et leurs écoles schismatiques, tel le Saint Sépulcre qui devient « névrotiquement territorialisé » (p. 145) et qui est divisé pour chacune des Eglises chrétiennes (l’auteur proposant une carte évocatrice). D’ailleurs, Régis Debray rappelle que le plan architectural, la décoration intérieure et le caractère des lieux de culte rendent témoignage des divergences théologiques : de l’austérité du temple protestant à la flamboyance de la cathédrale baroque catholique, de la sacralité conférée à l’église à celle attribuée à la cellule familiale protestante.
L’effacement du repère religieux, perte d’un repère majeur pour les hommes
Dans sa dernière partie, Régis Debray se fait plus philosophe, plus interrogateur. On retrouve aussi le censeur qui n’hésitait pas, dès le début de son ouvrage, à s’interroger sur la soumission du peuple chrétien à « son incompréhensible Dieu trinitaire » (p.22), le contempteur qui parle, toujours à propos de la Trinité, de « dogme migraineux » (p. 301) et qui stigmatise 20 siècles de tradition ecclésiastique qui aurait mis le Père éternel à « la portion congrue » (p. 301). Mais si l’on peut rester dubitatif devant certaines analyses, l’on ne pourra qu’abonder dans le sens de la faillite des valeurs que Régis Debray décrypte avec profondeur (« la déroute des Pères » par exemple, p. 315), dont l’avatar le plus inquiétant est, sans nul doute, « une ingéniérie du vivant qui remet en cause jusqu’à la différence des sexes et des générations [et qui] nous défilialise. Et rend l’humain un peu diabolique » (p. 316).
D’ailleurs, la perte des repères provient, pour l’auteur, d’une inadaptation des traditionnels supports médiologiques religieux. Au XVIIIe siècle, les 2/3 de la production livresque portaient sur une thématique religieuse. Aujourd’hui, 1 % du temps d’antenne télévisuel est dévolu à des émissions religieuses. Et le fait que « Le jour du Seigneur » soit la plus ancienne émission du petit écran en France n’y peut mais. A quelle orthodoxie et quelle orthopraxie se référer lorsque le livre n’est plus lu et semble disparaître ? Le livre désacralisé est le corollaire d’un monde « abiblique » (p. 348). Mais le rationalisme (dans lequel Régis Debray se classe p. 353) n’ignore pas l’aporie que constitue le désenchantement du monde. Ce dernier favorise in fine la résurgence du paganisme (p. 361), l’émergence des spiritualités orientales non théologiques, l’apparition de nouveaux concepts mondialisés (droit de l’hommisme…) qui n’évitent en rien les crispations fanatiques, les tensions identitaires et les intégrismes qui sont autant de signes irréfragables d’un réel sentiment « d’incomplétude » (p. 383).