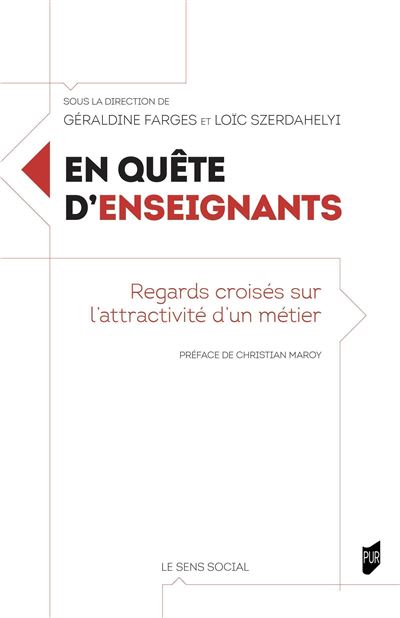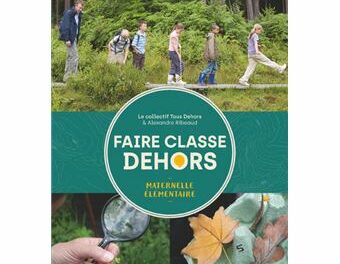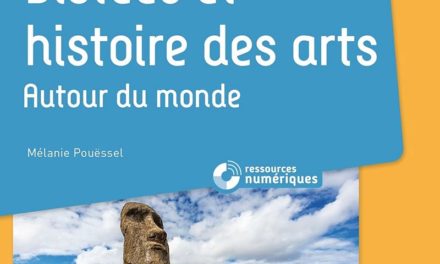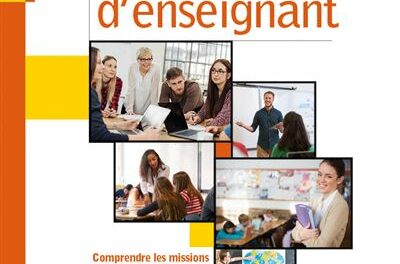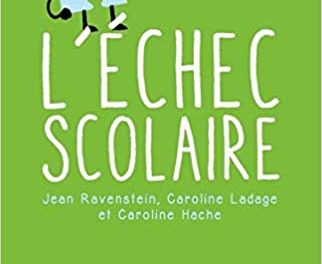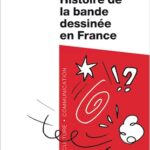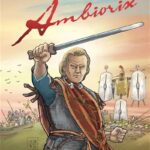Le présent ouvrage correspond à la publication de journées d’étude tenues à Dijon, en juin 2019 et intitulées « penser l’attractivité des métiers de l’enseignement : des agendas politiques aux travaux scientifiques ».
Dans leur propos liminaire intitulé « Du champ politique à l’analyse scientifique. L’attractivité des métiers de l’enseignement comme catégorie d’action publique à déconstruire », Géraldine Farges et Loic Szerdahelyi indiquent vouloir, dans cet ouvrage, « déplacer le regard du champ politique à l’analyse scientifique, en prenant l’attractivité des métiers de l’enseignement pour objet de recherche ». Ils précisent encore que « l’objectif est de mettre à l’épreuve de la critique scientifique l’attractivité en tant que catégorie d’action publique. Ce livre propose ainsi de déconstruire la notion d’attractivité en précisant les conditions dans lesquelles ce terme est mobilisé, en explorant les réticences qui peuvent en freiner l’usage, ou en s’intéressant aux terminologies alternatives. Notre propos se concentre sur l’espace éducatif français et porte sur les enseignants en poste dans les premier et second degrés, mais pas seulement : nous nous intéresserons aussi aux candidatures à l’enseignement, de même qu’à d’autres groupes professionnels éducatifs proches (p.15) ».
Les auteurs rappellent que des baisses significatives des candidatures aux métiers de l’enseignement ont pu être observées depuis le milieu du XXe siècle. La situation, aujourd’hui, concerne tous les degrés de l’enseignement et s’est installée durablement. L’enseignement, écrivent les auteurs, « fait par surcroît face à une autre crise, celle de la qualité de l’emploi et du travail (p.18) ».
Les auteurs définissent également ce qu’est l’« attractivité des métiers de l’enseignement », en mentionnant que cette notion « peut renvoyer à ce qui matériellement ou symboliquement, attire vers ou détourne d’une orientation possible, maintient ou altère l’intérêt premier pour l’un de ces métiers, permet d’envisager des mobilités pour les rejoindre ou a contrario pour les quitter, de façon située dans le temps et dans l’espace ».
L’ouvrage s’articule autour de trois grandes parties : un premier » grand chapitre » est consacré « viviers de recrutement » avec pour grande question « qui devient enseignant ? » ; un « second chapitre » est consacré à « l’attractivité comme notion flottante, se prêtant à des interprétations multiples » ; un « dernier chapitre » se propose « d’aborder l’attractivité sous un angle comparatif ».
Au cœur des viviers de recrutement
La première contribution est celle de Frédéric Charles, Marlaine Cacouault, Serge Katz, Florence Legendre, Pierre-Yves Connan et Angélica Rigaudière, présentée sous le titre « la perte d’attractivité du professorat des écoles en France au début du XXIe siècle. Quelques indicateurs pour objectiver et interpréter une crise structurelle ».
Les auteurs estiment que, parmi les raisons qui expliquent les crises concernant le groupe des professeurs des écoles, on relève l’évolution du nombre des « candidats/prétendants » et celle du taux de sélectivité.
Ils s’interrogent sur le rôle joué par la masterisation dans ce phénomène de crise et sur l’attractivité de la fonction de professeur des écoles auprès de la main-d’œuvre féminine en ce début de XXIe siècle.
Les chercheurs mentionnent que sur les quatre baisses « drastiques » de candidatures observables entre 1961 et 2017, trois sont directement à corréler avec l’élévation du niveau de diplôme demandé pour entrer dans la profession. La masterisation aurait quant à elle « accompagné et accéléré un processus de désaffection déjà enclenché des années auparavant (p.39) », le phénomène de « désaffection » étant observable depuis 2005.
En ce qui concerne les femmes, les auteurs écrivent qu’elles n’ont pas « déserté la profession enseignante » mais qu’ « elles ne représentent plus cette « armée de réserve » qu’elles ont constituée pendant plusieurs décennies (p.50)».
Pierre Perrier, dans sa contribution intitulée « Enseignant, un métier possible ? L’attractivité du professorat du secondaire selon les étudiants et étudiantes de licence », rappelle que la baisse d’attractivité dans le second degré n’est ni nouvelle, ni propre à la France et qu’elle « n’a pas de caractère uniforme selon les périodes ou disciplines (p.56) ».
Son enquête a porté sur la population des étudiants et étudiantes de licence 3 « qui forment le vivier principal des candidates et candidates potentiels » aux concours.
Il en ressort que lorsque le concours d’enseignement est envisagé comme débouché professionnel, quatre étudiants/étudiantes sur cinq lui accordent une forme d’exclusivité.
Le choix du métier repose en grande partie sur un « rapport privilégié, presque exclusif, à la discipline universitaire enseignée (p.61) ».
Les freins à l’attractivité du métier selon les enquêtés sont le niveau de salaire insuffisant, les contraintes des premières affectations, le manque de reconnaissance. D’autres « freins » apparaissent comme les conditions d’exercice du métier au quotidien et l’insuffisance des perspectives de carrière. La « valeur sociale » du métier leur apparaît également très faible.
Frédérique Giraud (« Devenir enseignant mais pas à n’importe quel prix. Les conditions sociales de l’attractivité de l’enseignement chez des ingénieurs et ingénieures en reconversion professionnelle ») s’est intéressée aux raisons ayant motivé quatre anciennes/anciens ingénieurs/ingénieures ayant quitté leur métier pour devenir enseignantes ou enseignants dans le primaire ou le secondaire. La principale motivation repose sur l’usage de « pédagogies alternatives », notamment montessorienne.
La construction sociopolitique d’un problème
Alexandre Munoz-Cazieux et Xavier Pons (« Les contractuels comme remède à la moindre « attractivité » des métiers de l’enseignement ou l’institutionnalisation de l’éphémérité ») s’intéressent au problème de la contractualisation dans l’enseignement sous l’angle de l’action publique. Ils en retracent la genèse et les évolutions. Ils concluent leur propos en indiquant qu’ à aucun moment (…) les personnels enseignants contractuels ne semblent constituer une solution politique véritable pour la grande majorité des actrices et acteurs concernés. Le couplage attractivité-contractualisation est effectué selon des logiques différentes, la politique nationale vise à calquer le plus possible la gestion des personnels contractuels sur celle des titulaires, elle envisage l’emploi contractuel comme temporaire et la gestion effectivement institutionnalisée dans les rectorats s’avère essentiellement supplétive ».
Camille Croizier (« Fabriquer la sortie du métier. Approche critique de « l’abandon de carrière enseignante » au prisme d’internet ») revient sur le phénomène de l’abandon des carrières d’enseignantes et d’enseignants et avance l’idée que « l’espace du Web agit non seulement comme révélateur de l’accroissement des situations « d’abandon de carrière » mais qu’il participe tout autant à les produire sous l’action de contributeurs et contributrices dont le statut et le rôle doivent être examinés (p.103) ».
La thématique de l’abandon de carrière enseignante est portée par différents acteurs à commencer par les premiers concernés mais également par les administrateurs de sites d’information, par les médias, par les acteurs institutionnels, les syndicats, les auteurs d’articles scientifiques ou encore les sites commerciaux. On relève que le terme de « reconversion enseignante » est surreprésenté.
Pierre-Yves Connan, Angélica Rigaudière, Frédéric Charles, Florence Legendre, Serge Katz et Marlaine Cacouault (« Quelles représentations du métier et de son attractivité dans les discours des professeurs des écoles ? Des univers sémantiques en tension ») ont mené une enquête nationale entre 2016 et 2017 avec un questionnaire qui visait à comprendre « l’attrait ou la désaffection » pour le professorat des écoles. Leur contribution prend en compte les seuls commentaires libres rédigés par les professeurs qui se sont exprimés volontairement.
Les professeurs des écoles évoquent ainsi , comme facteurs significatifs de l’absence d’attractivité du métier, la qualité de la formation continue et de l’accompagnement des enseignants, l’aménagement des conditions et de la charge de travail, la reconnaissance de l’investissement dans l’exercice du métier, les possibilités de mobilité professionnelle (p.134).
Aksel Kilic (« La norme vocationnelle ou la profession sublimée. Le sens de la vocation dans la culture professionnelle informelle ») s’intéresse à la « vocation » comme motivation à l’exercice du métier d’enseignant. La « norme vocationnelle », écrit-elle « est un élément incontournable de la culture professionnelle des professeures des écoles. L’évolution historique de leur rôle social ne s’est pas accompagnée de la disparation de la vocation (p.144)». Plus loin, l’auteure précise encore que « l’analyse de la vocation, en posant la focale sur les coulisses professionnelles, révèle aussi que cette norme professionnelle s’articule avec le sentiment des enseignants et enseignantes du primaire que leur engagement dans le travail n’est pas reconnu au sein de la société (ibidem) ».
Vers des approches comparatives
Cécile Roaux offre une contribution sur la direction d’école primaire (« La direction d’école : un métier à « l’image » peu attractive »). Elle relève que la fonction possède une « identité professionnelle mal définie, ne bénéficiant pas comme les chefs d’établissement d’un niveau de qualification reconnu par un concours et une formation (p.147) ». Elle choisit ainsi de s’interroger sur « l’image » de cette fonction comme facteur d’attractivité. Cécile Roaux écrit que « la question du « manque d’attractivité » de la direction d’école primaire en France met en relief les paradoxes du « pouvoir » à l’école entre désillusion des acteurs et illusion du discours néo-managérial. Il met tout autant en évidence les contradictions de la fonction enseignante dans son rapport à l’autorité refusée quand elle s’applique à soi, dans le travail en classe, mais souhaitée quand il s’agit des élèves en difficultés comportementales ou des parents « intrusifs (p.155) ».
Florian Asséré (« Les coordonnateurs et coordonnatrices de la MLDS. Entre attrait pour l’autonomie et rejet de l’institution scolaire ») s’intéresse aux coordonnateurs et coordonnatrices des MLDS. La Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) a été créée en 2013 et cible les jeunes de plus de 16 ans ayant quitté le système scolaire sans obtenir un diplôme de niveau V ou plus. Ces « pôles de remobilisation » sont souvent situés dans des lycées professionnels et ils accueillent un ensemble varié d’élèves.
Les coordonnateurs/trices des MLDS sont « chargés de mettre en place les pôles de remobilisation mais aussi de travailler auprès des équipes éducatives afin de prévenir le décrochage scolaire. Elles et ils bénéficient d’une forte autonomie dans la mise en œuvre des classes MLDS, notamment dans l’emploi du temps. Elles et ils disposent d’une enveloppe budgétaire pour recruter les enseignants ainsi que les intervenants (p.158) ».
Ces coordonnatrices/eurs sont pour un tiers d’entre eux d’anciens enseignants/es ou CPE. L’autonomie du dispositif s’avère extrêmement séduisante à leurs yeux. Ils observent également un rapport critique envers l’institution scolaire et les dispositifs leur permettent de déployer « des idées éducatives critiques par rapport au fonctionnement ordinaire de l’institution scolaire, ce qui peut se faire au prix d’une mise à l’écart des savoirs disciplinaires (p.159) ».
Enfin, Dominique Bret (« Conseiller principal d’éducation, un métier toujours attractif ? »), invite à réfléchir à l’attractivité du métier de CPE. Profession relativement récente (elle date de 1970), elle attire principalement par sa dimension relationnelle. Le métier de CPE séduit encore estime Dominique Bret, contrairement à l’enseignement et les CPE interrogés mettent en avant une fois encore les aspects relationnels de leur fonction et leur utilité sociale.
Un ouvrage dense, aux multiples contributions qui, par la série d’éclairages successifs qu’il comporte, ne pourra qu’enrichir quiconque entend s’intéresser à notre belle profession.