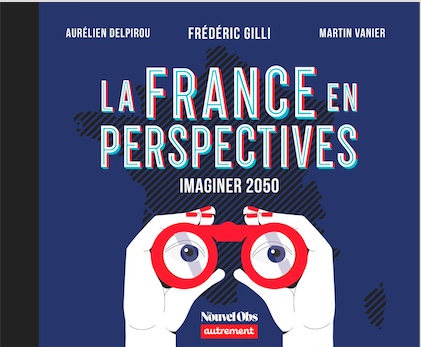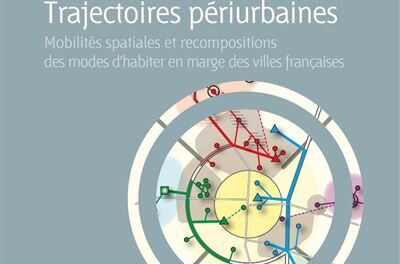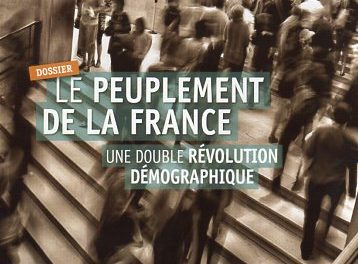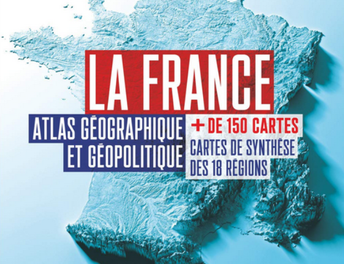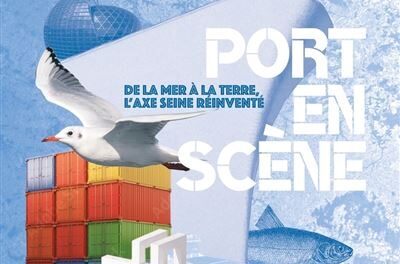Le Nouvel Observateur avait conçu un cycle de conférences et d’évènements appelé « 2049 ». Cela s’est traduit par une quarantaine de rencontres thématiques. Reflet de cette recherche, le livre reproduit les articles parus dans l’hebdomadaire. En 2050, la France représentera 0,7 % de la population mondiale. Si des tendances se dessinent déjà, l’avenir sera aussi ce que nous en ferons.
Le sens de l’ouvrage
Le livre entend mettre en perspective les enjeux structurants et les défis à relever et imaginer 2050 à différentes échelles. Pour imaginer demain, les auteurs rappellent aussi comment le monde était il y a vingt-cinq ans : les tours jumelles étaient debout, Nokia commercialisait son premier téléphone compact sans antenne. C’est dire qu’en vingt-cinq ans beaucoup de choses peuvent se passer. Cet ouvrage se fonde sur la compilation de dizaines de rapports thématiques, une documentation statistique inédite sur les tendances à l’oeuvre. Il met l’accent aussi sur le caractère ouvert des points de vue. Il est organisé en cinq parties avec le texte à gauche et les documents à droite.
Une brève histoire des futurs
En préambule, le livre revient sur la façon d’imaginer le futur dans l’histoire. Un des précurseurs en est Jules Verne. Après 1945, la façon d’imaginer l’avenir connait une double inflexion, marquée par l’idée de tragédies mais aussi de progrès. En cinquante ans, la prospective territoriale est devenue un des piliers des politiques publiques avec la DATAR ou encore les scénari pour la France de 2020. La DATAR propose vingt-huit scénarii et, à partir de là, la prospective devient plurielle, mais la prospective n’est pas la prophétie.
Un choix subjectif de documents du livre
On peut tout d’abord déplorer que malgré le format à l’italienne, certains documents auraient gagné à être disponibles en pleine page. Parmi la foule de documents proposés, on peut signaler les suivants : à la page 57, un graphique avec le taux de divorce suivant la durée du mariage ou encore la part de la population française sur Tinder. A la page 71, une carte s’intitule « une France engagée et mobilisée sous de multiples formes » distingue des niveaux de contestation. On trouve aussi une carte qui montre le déplacement des cultures en lien avec le changement climatique. On peut enfin mentionner une carte plus réjouissante qui s’intéresse aux festivals en France.
Dans quel monde vivons-nous ?
Cette première partie dresse un constat sur les grandes tendances planétaires. Le réchauffement est inégal mais massif. Paris aura le climat d’Istanbul. Les pays occidentaux représentent à peine 10 % de la population mondiale. Le vieillissement est aussi une tendance généralisée. La population sera davantage exposée aux épidémies. En 2050, l’Union européenne aurait besoin de soixante fois plus de lithium et de quinze fois plus de cobalt qu’aujourd’hui. Un document montre l’évolution des PIB des grandes puissances de 1980 à 2075.
Qui serons-nous ?
Des tendances lourdes d’ordre anthropologique sont à prendre en compte. Deux précautions s’imposent : ne pas projeter tels quels les débats du présent sur le futur et se méfier du « demain ce sera moins bien ». En France, en 2050, un tiers de la population aura plus de soixante ans et un cinquième moins de vingt ans. Cela implique aussi que la question « qu’est-ce qu’être vieux » va évoluer : après un quatrième âge, un cinquième apparaitra. Si l’espérance de vie augmente, cela pose aussi la question de la fin de vie. Les moins de trente ans, qui étaient 22 % de l’électorat au début des années 80, ne pèseront que 16 % des voix en 2050. Demain, comme aujourd’hui, il y aura des jeunesses. Un peu moins d’un centimètre et un peu moins d’un kilo par décennie, c’est le gain moyen des mensurations constatées par les professionnels de l’habillement.
Les auteurs insistent aussi sur un nouveau cortège de maladies liées à l’environnement. Des questions sociales et politiques continueront de se développer sur la régulation des usages des technologies. En 2023, 43 % des femmes et 52 % des hommes sont en situation d’immobilité ou descente sociale par rapport à leurs parents. Dans la France de 2050, les athés seront devenus le premier groupe. Malgré les difficultés économiques, un Français sur deux donne aujourd’hui aux associations. Il faut mesurer, qu’en parallèle, l’âge moyen d’un responsable d’association est de 56 ans. Dans trente ans, la France comptera cinq fois plus de centenaires et la population sera pour moitié inactive.
A quoi servirons-nous ?
En 2050, le système économique aura profondément changé. Les services auront été bouleversés par l’Intelligence artificielle et l’industrie aura été recomposée par la décarbonation des processus de fabrication. Au-delà du PIB, de nouveaux repères sont à prendre en considération comme avec le classement pour mesurer le bonheur proposé dans l’ouvrage. Les auteurs insistent ensuite sur la dette qui, de financière, deviendra écologique. Ils passent en revue les opportunités et les fragilités de la réindustrialisation. Il faudra réinventer des modèles d’agriculture. Aux Antilles, le triplement des pluies annoncé se traduira par une baisse des rendements de 20 à 30 % pour la canne à sucre. Il faut se méfier de parfois trop imaginer et le livre envisage un marché du travail pas si neuf que ça d’ici 2050. 10 % des métiers quand même subiront un fort impact avec l’arrivée des nouvelles IA bousculant l’ensemble de leurs tâches quotidiennes.
Où vivrons-nous ?
Il est difficile d’anticiper les dynamiques de peuplement. On peut tout de même parler d’une forte attraction littorale d’un côté, et d’un solde négatif pour certains départements. En 2050, tout le monde ne sera pas devenu hypermobile. L’injonction à la mobilité est de plus en plus perçue comme une contrainte. En 2023, 47 % des entreprises ont déjà intégré une part de travail à distance dans leur fonctionnement. Avec 15 % du commerce de détail, la France est déjà le deuxième marché européen du e-commerce. La ville devra s’adapter aux défis du changement climatique marqué par des canicules et des inondations toujours plus nombreuses. La France est aussi le pays européen qui a le plus de travailleurs transfrontaliers. On peut s’attendre au déclin touristique des stations alpines si elles ne se destinent qu’au ski. Habiter la nature en 2050 supposera de dépasser les divisions de la société et d’inviter le sauvage au cœur de nos représentations sociales et spatiales.
Que pourrons-nous ?
Les auteurs posent cette question en conclusion. Ils relèvent que les valeurs de liberté qui ont inspiré les démocraties européennes restent largement partagées à travers la planète. Le chemin est ardu entre les choix et les contraintes. Cet ouvrage pourra être utilisé lorsque l’on traite de la France en collège ou lycée car l’organisation des textes et des documents sur deux pages peut permettre des études ciblées.