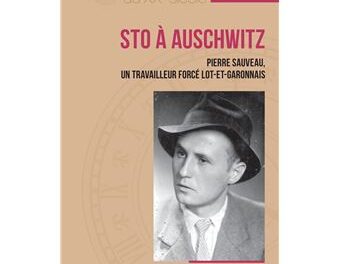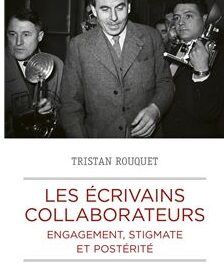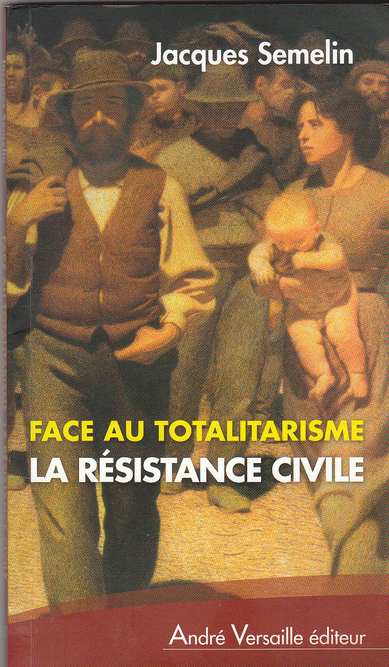
Les éditions André Versaille publient aujourd’hui le texte de son « mémoire d’habilitation à diriger des recherches en sciences politiques » sous la direction de Pierre Hassner à l’IEP de Paris, « court ouvrage qui, en une centaine de pages, montre le fil directeur de quelque quinze années de travaux sur la résistance civile » comme le définit son auteur dans une note liminaire. On aurait pu craindre la lecture difficile d’un ouvrage érudit à usage purement universitaire. On découvre un texte limpide, passionnant et profond, qui fait le point sur la démarche de l’auteur et les circonstances qui le conduisirent à étudier d’abord la résistance civile dans l’Europe nazie puis dans la sphère d’influence soviétique, ainsi que sur les concepts et notions qu’il a été conduit à élaborer, à préciser et à remanier. L’ouvrage propose donc une réflexion comparative sur les notions de « dissidence », de « désobéissance » et de « résistance » face aux deux formes de totalitarisme que sont le nazisme et le stalinisme.
L’itinéraire d’une recherche
A l’origine des travaux de J. Sémelin, on trouve « un questionnement éthique » : par quelles voies l’homme moderne peut-il se dégager de sa propre cruauté ? Interrogation qui le conduisit vers une recherche scientifique : « A travers l’étude de la violence (…) j’ai tenté de faire de la non-violence un sujet de recherches en sciences sociales, sans toutefois la considérer comme une panacée ». Il s’agissait de réfléchir aux moyens de sortir de la violence avec « pour hypothèse de recherche (…) de considérer que ce qu’on appelle « non-violence » rassemble en fait divers mécanismes de contrôle et d’endiguement de la violence ». « Comment des individus, des groupes, des sociétés peuvent-ils parfois résister sans armes face à un pouvoir de nature totalitaire ? »
« Pour répondre à cette question, j’ai d’abord pris le chemin de l’Histoire », chemin qui le conduit à étudier les processus de résistance non armée dans l’Europe nazie. « Ayant ainsi constitué un corpus historique, j’ai pu reprendre le regard du politiste pour mettre au jour diverses variables susceptibles de rendre compte de ces formes de résistance non armée (…) Ma démarche tient entièrement dans cette sorte de va-et-vient permanent entre un questionnement formulé dans le cadre de la science politique et un travail de restitution historique. » La notion de « non-violence » ne lui semblant pas assez pertinente pour rendre compte des actions observées au cours de son étude historique, il opte pour celle de « résistance civile », « en tant que processus spontané de lutte de la société civile par des moyens non armés » ; il s’agit de diverses formes de lutte sans armes : grèves, manifestations, protestations des Eglises, sauvetage des Juifs.
« Puis l’Histoire s’est chargée de me procurer mon nouveau sujet de recherche ! » La mobilisation populaire contre les pouvoirs communistes en place prenait en effet à la fin des années 1980 des formes pacifiques, « proches de ces formes d’opposition non armée que j’avais déjà étudiées dans le cadre de la domination nazie ». Tandis qu’il rédigeait sa thèse, J. Sémelin s’intéressait à l’évolution politique de la Pologne, s’y rendait et y rencontrait Bronislaw Geremek. Les événements de 1989 le conduisirent à étudier « l’importance des médias dans le développement des processus d’opposition qui devaient conduire à la chute des régimes communistes ». En 1990, il est recruté par la section des chercheurs en sciences politiques du CNRS. Il s’engage dans une recherche sur les événements de 1989 dans les démocraties populaires et se pose « des questions plus générales sur les processus d’effondrement de ces systèmes dits totalitaires, que l’ont avait cru irréversibles ». Il tente alors une « approche politique de la notion de résistance civile en intégrant des exemples de luttes non armées qui se sont précisément développées dans les pays de l’Est et du Sud ».
La notion de résistance civile
La définition la plus aboutie de la résistance civile proposée par J. Sémelin en 1995 est la suivante : « La résistance d’acteurs sociaux ou politiques appartenant à la société civile et/ou l’appareil d’Etat, et ce, par des moyens politiques, juridiques, économiques ou culturels. » La « résistance » doit être distinguée de la « dissidence » et de la « désobéissance ». Si « résister, c’est d’abord trouver la force de dire non, sans avoir toujours une idée très claire de ce à quoi on aspire », la résistance « ne devient telle que lorsqu’elle parvient à s’exprimer collectivement ». Il ne suffit pas d’être révolté pour être résistant. La dissidence est un mot d’origine religieuse qui signifie la non adhésion d’un individu à l’ordre politique imposé à tous par la contrainte physique. Dans l’Europe nazie, « chez nombre d’individus, la dissidence va de pair avec l’accommodement et la collaboration avec le régime (…) Cette dissidence est surtout une forme d’émigration intérieure qui permet de durer en dépit de la pression totalitaire, contre elle et avec elle ». Quand il désobéit, l’individu rompt avec une loi perçue comme injuste et entre dans l’illégalité. Mais toute désobéissance n’est pas forcément résistance : le refus de Service du travail obligatoire en France en est un bon exemple. Une partie seulement des réfractaires au STO s’est engagée dans une action de résistance. Le but du général de Gaulle est de passer de la dissidence à la résistance : celle-ci suppose une démarche de communication, la constitution de modes clandestins de liaison, une activité de propagande. J. Sémelin tient à bien distinguer la notion de « résistance civile » de celle de « résistance passive ». Bien des moyens de la résistance civile sont en effet « actifs » : participer à une grève ou à une manifestation c’est agir et c’est prendre un risque énorme. L’adjectif « civil » qualifie certes ce qui n’est pas armé, mais il a l’avantage de renvoyer aussi à la notion de civisme, soulignant qu’il s’agit d’œuvrer dans l’intérêt général, de lutter pour la démocratie.
A partir de la diversité des situations historiques étudiées, J. Sémelin distingue « trois figures fondamentales de la résistance civile » :
– Celle qui résulte d’une mobilisation par le bas, à travers la société civile qui a pour acteurs les syndicats, les Eglises, les organismes professionnels, les mouvements et associations de toutes sortes en tant qu’ils sont l’expression plurielle des groupes d’intérêt et courants d’opinion qui traversent une société donnée.
– Celle qui résulte d’une mobilisation par le haut, à l’initiative de l’État. Il peut s’agir des personnages les plus éminents de l’État (Boris Eltsine contre le coup d’Etat de 1991 à Moscou), de responsables de la haute administration, de tous les membres d’un Corps d’État (refus de la police danoise de coopérer à l’arrestation des Juifs en octobre 1943).
– Celle qui conjugue les deux, par une mobilisation dialectique de la société civile et de l’État. L’État, dans un pays envahi, peut s’engager dans une politique de collaboration avec l’occupant, et la résistance doit alors se battre sur deux fronts : contre l’État collaborateur et contre la puissance occupante. Mais il arrive que les agents de l’État occupé agissent ouvertement ou clandestinement en faveur de la résistance civile. L’histoire de la Perestroïka est ainsi celle d’une dialectique entre la résistance de la société civile et la sphère étatique.
J. Sémelin établit ensuite une distinction entre la force et la violence : la violence est l’expression la plus brutale et la plus radicale de la force, ce n’est pas la seule. La violence est « synonyme de destructivité, de mort de l’autre, physique ou symbolique ». Il observe encore que « l’assujettissement des hommes ne repose pas seulement sur la violence qu’ils subissent mais aussi sur l’obéissance qu’ils consentent. Si la domination physique d’un peuple est un état de fait, sa soumission politique est un état d’esprit. La résistance civile est précisément le moyen d’accroître le fossé entre cet état de fait et cet état d’esprit ». L’espace de résistance peut se construire autour de « deux pôles indissociables et complémentaires » : « un pôle négatif fondé sur le refus de la servitude » (grève, boycottage et désobéissance civile), « un pôle positif fondé sur l’affirmation d’une identité et d’une légitimité différentes de celles de l’adversaire » (résistance culturelle, action politique, manifestations publiques) pour laquelle la communication et les médias jouent un rôle essentiel.
Les travaux sur l’Europe nazie
J. Sémelin distingue deux types de résistance civile. Le premier consiste à recourir à des moyens non armés pour aider le combat armé, par exemple l’aide aux maquis. Le second consiste à recourir à des formes de mobilisation et de non-coopération sociales afin de défendre des objectifs civils. La finalité de cette résistance est alors la défense des libertés, le respect des droits de la personne, des acquis sociaux et politiques. C’est ce second type de résistance civile qui est l’objet des recherches de J. Sémelin. Elle a pris des formes anonymes et clandestines (travail au ralenti, sabotage industriel, lutte contre le STO, protection des personnes persécutées) et des formes publiques (manifestations, grèves, protestations diverses). Les cas les plus importants sont apparus en Europe occidentale et en Scandinavie, mais aussi en Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie, et même en Allemagne (protestations publiques en 1941 de certaines autorités catholiques contre l’euthanasie des malades mentaux, manifestations des femmes aryennes dans les rues de Berlin en 1943 pour la libération de leurs maris juifs).
Pour interpréter la diversité de ces exemples, J. Sémelin fait appel à trois concepts fondamentaux :
– Cohésion sociale. Le degré de sentiment de solidarité entre les membres d’une collectivité est une clé importante pour interpréter sa capacité de résistance civile. Si la résistance civile est plus forte en Europe occidentale et en Scandinavie c’est parce que la stabilité démocratique et la cohésion sociale y sont plus fortes.
– Légitimité du pouvoir. La collaboration d’Etat empêche la pleine expression du potentiel de la société civile (France de Vichy par exemple). En revanche, le choix d’une politique de non-coopération par le gouvernement d’un pays vaincu favorise la résistance civile (Norvège).
– Opinion publique. Une résistance est vouée à l’échec sans une opinion qui la soutient. J. Sémelin propose alors « la théorie des trois cercles » : le premier cercle regroupe les mouvements de résistance organisée, le second cercle plus large est celui de la complicité active, le troisième, beaucoup plus étendu, est celui de la complicité passive : les courants d’opinion favorables à la résistance et qui approuvent leurs actions.
J. Sémelin distingue alors trois modes de développement de la résistance civile : la force des mots et des symboles (tracts, journaux, radio), la « réactivité sociale » (opposition forte des groupes sociaux ou professionnels à certaines mesures par des grèves ou des manifestations), la pratique clandestine de la solidarité (envers les résistants et envers les Juifs).
A propos des activités de sauvetage, il élabore « la théorie des trois écrans » qui repose sur le postulat que tout ce qui a contribué à distancier les persécuteurs de leurs victimes désignées, a augmenté la chance de survie de ces dernières. Premier écran-protecteur : celui des gouvernements collaborateurs ou alliés du Reich dont l’attitude de réserve, voire de refus, vis-à-vis des déportations, était de nature à ralentir l’application de la solution finale dans leur pays. Second écran-protecteur : l’opinion quand elle s’affirme ouvertement par une protestation publique (France en 1942, Bulgarie en 1943). Le troisième type d’écran est essentiel et se situe « sur le terrain même de la bataille », l’organisation de la dissimulation ou de la fuite des Juifs par des réseaux clandestins de sauvetage. J. Sémelin reprend à son compte l’approche de Léon Poliakov (Le Brévaire de la haine, Calmann-Lévy, 1951) confirmés par les travaux de l’historien Ian Kershaw sur l’opinion publique allemande (L’opinion sous le nazisme. Bavière 1933-1945, éditions du CNRS, 1995), qu’il n’y a pas de génocide sans adhésion collective tacite.
Les travaux sur l’Europe soviétisée
En tant que forme d’opposition organisée, la Résistance dans les pays de l’Est est restée un phénomène minoritaire qui ne doit pas être surestimé. J. Sémelin s’est attaché à montrer l’importance du rôle des médias comme moyen de briser l’isolement des populations est-européennes. Le cas polonais a été un exemple révélateur de la manière dont les dissidents et les opposants ont pu se servir des médias occidentaux pour s’adresser à leurs concitoyens et aussi élargir leur influence sur l’opinion. L’étude du cas polonais a ouvert à J. Sémelin la voie d’une « recherche plus ambitieuse : penser les rapports entre communication et résistance dans toute la période de l’Europe soviétisée, depuis les débuts de la guerre froide (…) Le résultat a été un nouvel essai, « La Liberté au bout des ondes », dont le fil conducteur est la conquête de la parole en tant que conquête de la liberté ».
J. Sémelin met en évidence l’importance du phénomène de l’écoute des radios occidentales comme facteur d’ouverture des pays de l’Est. Il s’agissait de capter des informations considérées comme véridiques auprès d’une station de radio extérieure, jugée crédible alors que les médias officiels ne l’étaient pas. Il montre ensuite qu’avec la Perestroïka et la fin du brouillage des radios occidentales, les médias ont joué un rôle de « ponts culturels » entre les deux Europe. A travers le cas polonais, il étudie plus précisément la question de la réception des médias occidentaux puis celle des médias nationaux quand ils deviennent plus libres et donc plus crédibles. Il arrive au constat que « tout dépend de la réceptivité sociale à l’égard des radios étrangères (…) Ce n’est pas le média qui crée l’ouverture de la société, mais l’aspiration à l’ouverture au sein de cette société qui constitue un public potentiel pour le média ». Il propose alors « la théorie des béquilles ». « Tout se passe comme si les radios occidentales avaient été comme des béquilles pour une société polonaise cherchant à se mettre debout. En relayant les voix de l’opposition intérieure, ces radios ont aidé la Pologne à avancer dans une autre direction que celle qui lui était imposée ». A la fin des années 1980, la société polonaise était en mesure de « lâcher ses béquilles » et de s’approprier ses propres médias. La télévision polonaise devint un lieu de débat et l’intérêt pour les médias étrangers diminua fortement.
En Europe orientale la résistance civile fut « ce processus même de conquête de la parole synonyme de conquête de liberté ». Elle se fit en trois étapes : sous Staline, la parole libre ne vient que de l’extérieur du système à travers les radios internationales ; après la mort de Staline, on voit renaître le débat public et même l’action publique protestataire ; dans les années 1970, la dissidence émerge sur la scène internationale, les dissidents utilisent les radios occidentales pour parler à leurs concitoyens. « Un savoir-faire résistant s’est construit, en un peu plus de trois générations : un savoir-faire qui allie une manière de s’opposer à une manière de communiquer ».
Vers des approches comparées et pluridisciplinaires
Malgré de réelles différences entre les deux périodes et les deux types de totalitarisme, J. Sémelin affirme qu’« il serait intéressant de promouvoir aujourd’hui des recherches visant à comparer les manières d’être désobéissant et les procédés effectifs de résistance à l’intérieur des deux systèmes ». Il caractérise « un noyau dur du phénomène résistant au XXe siècle dont les constituants fondamentaux sont :
– la conscience nationale forgée en Europe aux XVIIIe et XIXe siècles, qui s’est opposée aux volontés impériales de Berlin et de Moscou ;
– un humanisme qui, puisant ses valeurs dans le christianisme, le judaïsme ou l’esprit des Lumières, s’est dressé -tant bien que mal- contre le projet totalitaire (nazi ou soviétique) de déshumanisation de l’homme ;
– des technologies de la communication (presse écrite, radio) qui ont permis aux hommes de se regrouper par-delà leurs barrières sociales et les distances géographiques, pour former des mouvements de résistance organisés.
Il souhaite poursuivre la réflexion sur le thème du « courage à désobéir » : dans quelles conditions l’homme parvient-il à dire non à la barbarie ? Ce courage est parfois aussi nécessaire dans les démocraties, dont les gouvernements ou leurs agents peuvent violer les droits de l’homme. « Ce travail sur les rapports entre désobéissance, dictature et démocratie appelle tout autant le regard de l’historien que celui du philosophe. » Il faudrait aussi approfondir la réflexion sur la non-violence, encore trop souvent confondue avec le pacifisme alors qu’elle désigne en réalité divers processus de « contrôle et d’endiguement de la violence », dans une approche pluridisciplinaire (à travers la sociologie, l’anthropologie, le droit, l’histoire, la philosophie, la science politique, l’éthique).
Enfin J. Sémelin souhaite étudier « la place du témoin ou, si l’on veut du public face à la barbarie (…) Á quelles conditions peut-on massacrer en public ? Ou, à l’inverse ; à huis clos ? ». Il espère « apporter une contribution à la compréhension des processus de la violence contemporaine ».