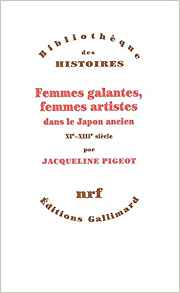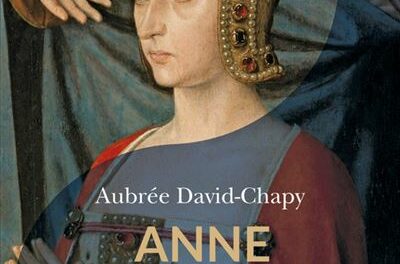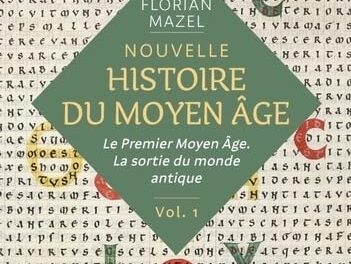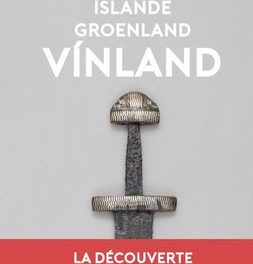Dans la prestigieuse collection de La Bibliothèque des histoires de chez Gallimard, Jacqueline Pigeot propose ici une approche des courtisanes japonaises entre le XIe et le XIIIe siècle. Ces femmes ne sont pas encore des geisha (celles-ci n’apparaissent que vers le XVe siècle et leur sort se fixe au XVIIe). Cette période du XIe-XIIIe siècle est d’abord le moment le plus ancien où une documentation suffisamment importante commence à permettre l’étude de ces femmes ; c’est également la période qui voit une évolution importante de la société japonaise et en particulier de la situation des femmes ; c’est enfin le seul moment de l’histoire du Japon où les courtisanes, notamment les shirabyôshi, ont développé un art spécifiquement féminin du chant et de la danse, tout en assumant leur condition de prostituées. Ces femmes de divertissement sont donc « au carrefour de l’histoire des femmes (mœurs sexuelles, statut social et religieux) et de l’histoire du chant et de la danse ». J.P. propose également une histoire des représentations à travers les nombreux textes littéraires utilisés.
Ces courtisanes, kugutsu ou yûjo vivent en groupe sur des barques, « ce monde flottant » est présent sur le réseau fluvial et la mer intérieure. Chaque groupe est dirigé par des « mères » réelles ou adoptives et semble échapper à tout contrôle ou domination masculine. Sur les bateaux, les courtisanes signalent leur présence aux voyageurs par de larges parasols et attirent leurs clients par leurs chants. Les shirabyôshi ajoutent la danse à leurs compétences artistiques.
Cet art particulier est transmis jalousement par ces femmes à leurs filles, et il est quelquefois enseigné à des hommes, comme c’est le cas pour l’empereur retiré Goshirakawa. Les arts que maîtrisent les courtisanes sont d’abord la poésie et notamment le waka (quintain de trente et une syllabes) et forme poétique par excellence depuis le VIIe siècle. C’est ensuite le chant qui est leur grande spécialité. Enfin au milieu du XIIe siècle s’ajoute la danse, et celle-ci connaît un immense succès.
Les courtisanes fréquentent les élites sans que cela ne soit l’objet d’une réprobation quelconque ; elles ont notamment le privilège de pouvoir aborder directement les hauts personnages. Cela pose d’autant moins de difficultés que le système matrimonial de l’époque dans l’aristocratie japonaise est plus ou moins une polygamie réciproque où la liberté sexuelle existe à partir du moment où l’on respecte les règles de bienséance. Mais tout cela change au cours du XIIe siècle quand la morale guerrière des guerres civiles impose la monogamie et la fidélité conjugale de l’épouse qui est alors contrôlée par la famille du mari.
En dépit de cette évolution, la situation de prostituée dans le Japon médiéval n’est pas stigmatisée et n’est jamais associée à une quelconque culpabilité morale.
La figure de la courtisane est très présente dans la tradition littéraire, et ce, dans des textes très différents en chinois (langue littéraire alors) ou en japonais. Un des plus anciens textes est une présentation très documentée de Gô Igen d’un recueil de poèmes ; on trouve également des textes satiriques présentant des galeries de personnages, des correspondances (réelles ou fictives), des extraits de journaux de voyage, ainsi que des textes consacrés exclusivement aux courtisanes comme le Yûjo ki ; enfin les textes poétiques où la prostituée devient une figure à part entière. Mais au XIIIe siècle, la courtisane qui est révérée dans les poèmes est celle qui abandonne les illusions du monde et entre en religion. De plus dans l’imaginaire du temps, il semble bien que la courtisane entretienne une relation particulière avec le sacré, elle a en charge certains rites propitiatoires, d’une part du bouddhisme ésotérique, mais aussi dans les pratiques shintoïstes traditionnelles, cela est peut être un des éléments qui permettent d’expliquer la position particulière de ces femmes.
L’auteure fait preuve d’une érudition remarquable mais cependant jamais pesante. Tous les textes existants et utilisés sont intégralement cités, et J.P. précise les problèmes de traduction que posent notamment les textes poétiques ; cela permet au lecteur de mieux comprendre le travail de l’historien.
Cet ouvrage contribue à rappeler aux enseignants que les clichés les plus fixés dans notre imaginaire d’occidentaux, comme celui des geishas par exemple, correspond à une période donnée de l’histoire et que le sort des courtisanes au Japon a connu de grandes modifications selon les époques. En dépit de toute la tradition littéraire, J.P. ne cherche pas à dissimuler les difficultés de la vie de ces femmes, mais elle éclaire d’une manière brillante une période fort mal connue en apportant un point de vue original à l’histoire du « gender » et en permettant d’approfondir la réflexion sur la condition féminine. Elle n’occulte pas le danger d’un regard masculin et fait remarquer les différents filtres que les témoignages masculins imposent à nombre de documents. Cependant, la condition de ces femmes a suscité chez les auteurs littéraires japonais une réflexion plus large sur la destinée humaine, et ils abordent le sort de ces courtisanes avec une empathie absente de nos textes médiévaux . Très sensible au regard féminin, l’auteure dépasse le niveau de l’ouvrage féministe militant pour proposer une lecture fine de la condition de ces femmes, emblématiques de la condition humaine, au cœur des rapports entre hommes et femmes mais aussi des questions fondamentales de l’amour, du plaisir, de l’art, de la destinée… à un rare moment de l’histoire où « les femmes ont été prises au sérieux »… Au final, un livre passionnant !