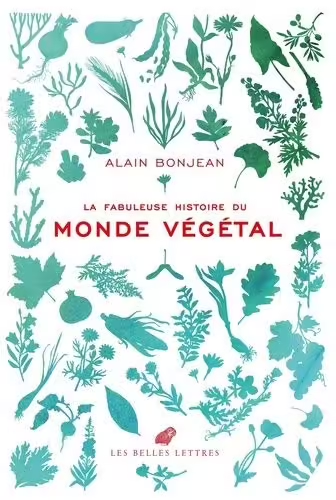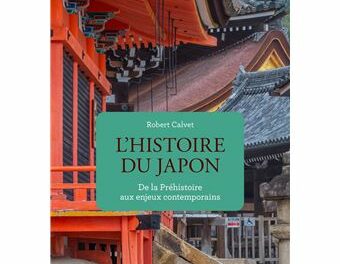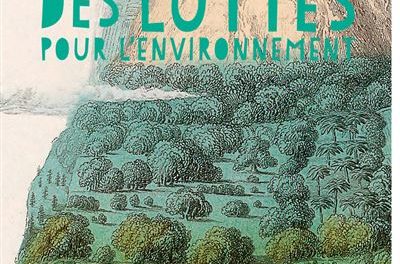La fabuleuse histoire du monde végétal est un livre ambitieux : richement illustré, abondant en données scientifiques, couvrant aussi bien la biologie végétale que l’histoire longue des plantes et leur rôle dans les sociétés humaines. En l’ayant entre les mains on prend tout de suite conscience de la qualité des éditions Les Belles Lettres, du soucis du détails et de la volonté de créer un bel objet.
Alain Bonjean, généticien, ethnobotaniste et ingénieur agronome, propose un vaste panorama : de l’apparition des végétaux aux enjeux contemporains de l’agriculture mondiale, en passant par la domestication, les échanges planétaires, les usages médicinaux ou spirituels, et les nouveaux défis écologiques.
L’ensemble est clair, didactique et dense, et constitue un excellent tour d’horizon de ce que l’on doit connaître aujourd’hui pour comprendre le monde végétal.
Redéfinir ce qu’est un végétal
L’auteur ouvre son livre par une clarification utile : qu’appelle-t-on un végétal ?
Il nous fait circuler entre des termes scientifiques que l’on manipule souvent mal : les végétaux constituent l’un des quatre grands ensembles d’eucaryotes, aux côtés des protistes, des animaux et des champignons. Ils se distinguent d’abord par leur autotrophie, c’est-à-dire leur capacité à produire leur propre matière organique grâce à la photosynthèse, processus rendu possible par la présence de chlorophylle, pigment qui capte principalement les longueurs d’onde bleues et rouges de la lumière. Les plantes transforment ainsi l’énergie solaire, l’eau et les minéraux en nutriments, et portent, depuis 2,8 milliards d’années, un rôle décisif dans l’oxygénation de l’atmosphère. On distingue deux grands groupes : les bryophytes (mousses), dépourvues de vaisseaux conducteurs et dont toute la surface absorbe l’eau, et les plantes vasculaires, qui possèdent un système racinaire et des tissus spécialisés (xylème et phloème).
L’ouvrage propose aussi un renouvellement de la vision que l’on peut avoir du monde végétal. Par exemple, et contrairement à une idée reçue, les plantes ne sont pas immobiles : elles réagissent à leur environnement par divers tropismes (héliotropisme, thigmotropisme, hydrotropisme) et certaines possèdent des mouvements rapides, qu’il s’agisse de la propulsion de spores, des catapultes de graines ou des pièges des plantes carnivores. Leur mobilité se manifeste aussi par la dispersion, parfois sur des milliers de kilomètres, comme l’illustrent les baobabs originaires de Madagascar.
Aujourd’hui, les végétaux occupent presque toute la surface terrestre — y compris l’Antarctique avec deux plantes à fleurs — et structurent les grands biomes, déterminés par le climat, la latitude ou l’altitude. Représentant près de 450 gigatonnes de biomasse.
Un lien quasi-symbiotique entre l’humanité et les plantes
Une des forces de ce livre est de rappeler l’humanité entretient avec le monde végétal une relation de quasi-symbiose – au sens courant et non biologique – qui dépasse largement la simple consommation alimentaire. Les plantes sont d’abord la condition biologique de notre existence : elles produisent près de 98 % de l’oxygène atmosphérique et constituent la base de toute chaîne trophique, fournissant plus de 80 % de notre alimentation. Bien avant l’agriculture, les sociétés humaines utilisaient déjà une extraordinaire diversité de plantes sauvages — plus de 800 espèces identifiées dans l’hémisphère nord — pour se nourrir, se soigner, tanner des peaux, se chauffer ou fabriquer des outils. Les plantes ont aussi accompagné l’humanité dans le domaine du soin : traces d’automédication vieilles de 370 000 ans, pharmacopées préhistoriques et antiques, usage rituel ou thérapeutique des plantes hallucinogènes, pratiques de trépanation nécessitant une maîtrise végétale de la douleur et des infections.
À cette dimension matérielle et médicale s’ajoute un lien symbolique et culturel profond : offrandes végétales dans les sépultures néandertaliennes, plantes protectrices, aphrodisiaques ou magiques, mythologies bâties autour du blé, du ginseng ou de la vigne. Avec le Néolithique, cette interdépendance s’intensifie : l’humanité domestique les plantes, mais c’est aussi grâce aux plantes qu’elle se sédentarise, planifie ses stocks, transforme son rapport au temps et fonde ses premières civilisations. Les végétaux façonnent également les paysages et les mobilités humaines : les biomes, les graminées et les ressources végétales déterminent les zones d’installation, les migrations, les économies et les croyances. Enfin, la coévolution entre plantes et animaux — pollinisation, dispersion des graines, symbioses multiples — implique l’homme lui-même, devenu l’un des agents les plus puissants de la dissémination végétale, volontaire ou non.
Ainsi, loin d’être de simples « ressources », les plantes constituent l’environnement vital, le pharmacien, le coévoluteur et le support culturel de l’humanité.
Comment l’humanité a transformé le monde végétal : de la cueillette au capitalisme agro-industriel
Depuis les sociétés de chasseurs-cueilleurs, l’humanité entretient avec les plantes un rapport fondamental, mais profondément transformé au fil des millénaires. Les premiers groupes humains exploitaient une extraordinaire diversité de végétaux sauvages : plus de 800 espèces identifiées dans l’hémisphère nord, allant des bulbes sibériens aux écorces médicinales du Groenland, en passant par les graminées sauvages ou les fruits des zones boréales. Les humains pratiquaient déjà des formes d’appropriation ingénieuse des ressources, comme les Touaregs prélevant les greniers de fourmis ou les peuples du Kamtchatka échangeant les réserves des souris. Les plantes jouaient aussi un rôle rituel, thérapeutique et symbolique, structurant les pratiques funéraires, les pharmacopées et les systèmes de croyances.
Avec le Néolithique, le rapport se modifie radicalement : l’humanité ne se contente plus d’exploiter les plantes, elle commence à les domestiquer, à les sélectionner, à synchroniser leur maturité, à réduire leur toxicité ou leur dormance. Les graminées — déjà fondamentales pour les chasseurs-cueilleurs — deviennent les piliers des premières agricultures grâce à leur forte valeur énergétique, leur stockage facile et leur polyvalence (pain, bière). Cette domestication entraîne une révolution sociale : sédentarisation, stockage, augmentation de la densité démographique, mais aussi une dégradation de la santé (carences, zoonoses, déformations articulaires) et une dépendance croissante à un nombre limité de plantes.
La période moderne amplifie ce mouvement avec le grand échange biologique post-colombien, qui mondialise les espèces végétales, uniformise les systèmes agricoles et accélère les substitutions écologiques. Aux XIXᵉ et XXᵉ siècles, la sélection généalogique, la Révolution verte, puis les biotechnologies conduisent à un modèle industriel extractiviste fondé sur l’intensification, la réduction drastique des espèces cultivées et la dépendance à la chimie et aux énergies fossiles. Ce système, très productif, s’accompagne cependant de destructions massives : déforestation, fragmentation des écosystèmes, effondrement de la biodiversité, artificialisation des sols et contribution majeure au changement global. Le rapport humain aux plantes passe ainsi d’une relation de dépendance réciproque à une exploitation unilatérale, dont les limites écologiques sont aujourd’hui visibles à l’échelle planétaire.
Des nouveautés et enjeux contemporains …
La seconde moitié du livre se concentre sur les défis actuels que rencontrent nos sociétés face aux écosystèmes et à leurs utilisations/exploitations. La déforestation, l’effondrement de la biodiversité, les boucles de rétroaction avec le changement climatique, la gestion de l’eau, la sécurité alimentaire, la montée des biotechnologies, l’édition génomique ou l’agriculture en enceinte contrôlée (vertical farming) sont des sujets que Alain Bonjean tente de présenter de la manière le plus claire possible, mais malheureusement d’une manière particulièrement prescriptive.
Les enjeux actuels liés au monde végétal révèlent combien notre rapport aux écosystèmes est devenu une question de survie collective. Le changement global – hausse de 1,2 °C depuis 1880, multiplication des sécheresses, raréfaction des pollinisateurs, nouvelles maladies – fragilise déjà les cultures, réduit la biomasse, perturbe les cycles hydriques et accentue la pression sur les ressources. À cela s’ajoutent les destructions directes : déforestation, fragmentation massive des forêts primaires (–88 à –95 % pour la forêt atlantique brésilienne), artificialisation des sols et diffusion d’espèces invasives. La biodiversité végétale subit un effondrement rapide : 8 à 13 % des espèces ont disparu depuis 1500 et 40 % des arbres européens sont désormais menacés. Face à ces tendances lourdes, les biotechnologies sont présentées par l’auteur comme la seule réponse appropriée. Les techniques de marquage génétique, de transgenèse ou d’édition via CRISPR-Cas9 cherchent à produire des plantes plus résistantes à la sécheresse, à la salinisation ou aux virus, ou enrichies en nutriments – comme le riz doré, solution à la carence en vitamine A. Mais ces innovations s’inscrivent dans un modèle où la technique remplace le fonctionnement naturel des écosystèmes plutôt que de s’y adapter. Ainsi, l’agriculture en enceinte contrôlée, présentée comme un modèle d’avenir, libère l’humanité de la contrainte des saisons. De même, la sélection génétique intensive entretient une dépendance aux intrants, homogénéise les variétés cultivées et accroît la vulnérabilité globale.
… présentés dans l’horizon de l’ingénierie
Et finalement, le bât blesse. Ce livre, aussi beau et complet soit-il, propose une vision, un horizon très étroit, celui d’ un ingénieur qui oriente son analyse dans le techno-solutionnisme sans véritablement se pencher sur l’atténuation que nos sociétés pourraient enclencher. Il prend chaque problème et chaque contrainte comme un défi technologique à réaliser tout en ignorant volontairement la tradition critique de l’usage de la technique, notamment le système technicien de Jacques Ellul qui veut que chaque solution technologique engendre un nouveau problème à résoudre par la technique qui, ainsi, s’auto-entretient. Le meilleur exemple reste l’usage de l’agriculture verticale en enceinte contrôlée associant hydroponie et diodes électroluminescentes, substituant au service gratuit de l’énergie solaire une technologie consommatrice d’énergie. Cette volonté constante de s’extraire de l’environnement est symptomatique d’une vision technicienne de problèmes qui, au final, sont le résultat de notre mode de vie capitaliste : tout est vu en parts de marché qui justifient la crainte de l’auteur de voir l’Union européenne freiner à l’adoption de l’AVEC et des OGM, et perdre ainsi sa place de puissance développée.