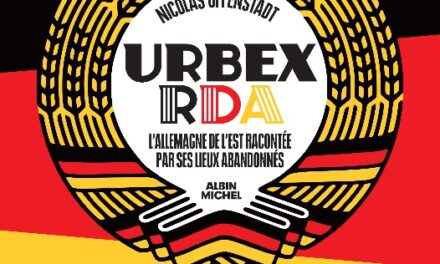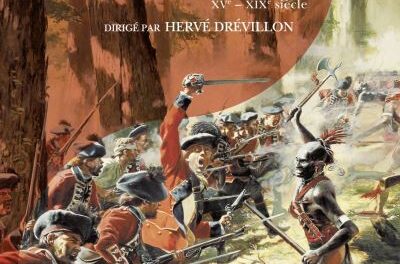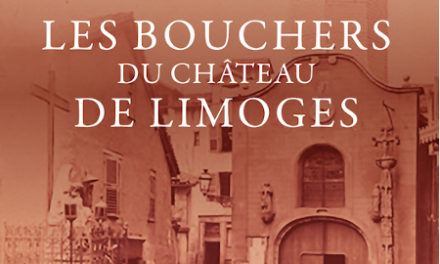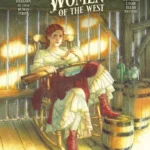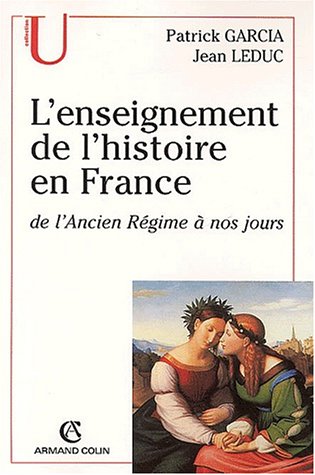
A l’heure où ressurgissent les interrogations sur l’école et ses missions, cette Histoire de l’enseignement de l’Histoire de l’Ancien Régime à nos jours vient à point pour nourrir et mettre en perspective notre réflexion sur la question.
L’ouvrage a été co-écrit par Patrick Garcia et Jean Leduc, tous deux spécialistes d’historiographie et d’épistémologie. Le premier, maître de conférences à l’IUFM de Versailles, est notamment l’auteur de: Les courants historiques en France, XIXe-XXe siècles (Armand Colin, 1999), en collaboration avec Christian Delacroix et François Dosse, du Bicentenaire de la Révolution française. Pratiques sociales d’une commémoration (CNRS-éditions 2000) et d’études sur Michel de Certeau. Le second, ancien professeur d’histoire en classes préparatoires à Toulouse a notamment écrit : L’enracinement de la République (Hachette, 1991), Construire l’histoire avec Violette Marcos-Alvarez et Jacqueline Le Pellec (CRDP Midi-Pyrénées, 1994), et Les Historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritures (Ed. du Seuil, 1999). Tous deux ont également collaboré à la rédaction de manuels scolaires aux éditions Bertrand-Lacoste. Cette étude apparaît en quelque sorte comme le pendant de celle consacrée à la géographie par Isabelle Lefort : La lettre et l’esprit, géographie scolaire et géographie savante 1870-1970 (Presses du CNRS, 1992) et prolonge sous un angle différent le travail de Charles Heimberg : L’Histoire à l’école (ESF éditeur, 2002).
Les auteurs se sont attachés ici à dresser un état de la recherche autour de cinq axes de travail qui orientent leur réflexion tout au long de l’ouvrage organisé cependant chronologiquement.
Pour chaque période, ils évaluent notamment la place et le statut particulier de cette discipline à l’aune des horaires qui lui sont dévolus et du public scolaire qui en bénéficie. Longtemps cantonné, et encore de manière très ponctuelle, aux seuls établissements secondaires, l’enseignement de l’histoire a fini par être reconnu nécessaire en tant que tel et non plus seulement comme auxiliaire des humanités. Aussi est-il rendu obligatoire au cours de la période 1830-1870, d’abord dans le secondaire puis dans le primaire. Généralisation somme toute théorique puisque l’immense majorité des enfants ne dépasse pas encore les classes du primaire. Ce n’est qu’avec l’après guerre que la volonté d’ouverture, portée par la croissance démographique, permettra une réelle démocratisation. Mais l’essentiel est là : confortée par la définition progressive d’un savoir de référence, la discipline s’est institutionnalisée au point de bénéficier d’une réelle légitimité sociale et de se découvrir de nombreux défenseurs lorsqu’elle s’estimera menacée.
Une telle position n’est sans doute pas étrangère à la multiplicité des finalités qui lui sont assignées et dont les auteurs analysent la hiérarchie fluctuante et le caractère nécessairement contradictoire, sinon illusoire. Finalités morales tout d’abord d’un enseignement conçu comme porteur de leçons. Finalités politiques ensuite, dès la Révolution, de légitimation du pouvoir en place, particulièrement prononcées dans le primaire et durablement ancrées. Finalités patriotiques et intégratrices visant à inculquer aux élèves l’idée d’une continuité de la construction de la France comme Nation, de son caractère exemplaire, pour ainsi forger une mémoire collective, fondement de l’unité nationale. Le développement de la géographie au début de la IIIe République est à replacer dans ce contexte. Dénoncée et en contradiction de plus en plus évidente avec les objectifs intellectuels et civiques d’émancipation et de développement de l’esprit critique, cette instrumentalisation reste vivace jusqu’en 1930 avant de lentement s’estomper, malgré la réaffirmation aujourd’hui de finalités patrimoniales à dimension européenne cette fois.
Les contenus d’enseignement font évidemment l’objet d’une attention toute particulière. L’analyse porte notamment sur leur choix, leurs évolutions et leur rapport à l’histoire dite « savante ». En l’absence d’un savoir bien identifié, l’enseignement de l’histoire restera longtemps peu individualisé pour être placé dans le secondaire au service des humanités. L’histoire ancienne, médiévale et moderne est ainsi privilégiée au détriment de l’histoire récente et de l’histoire nationale. D’une grande précision, les programmes encouragent l’érudition que condamnent pourtant fréquemment les instructions officielles. Les auteurs publient d’ailleurs des témoignages intéressants de prestigieux anciens élèves qui disent combien l’apprentissage de l’histoire a pu leur apparaître comme un véritable pensum. Le récit événementiel le plus continu possible à dominante politique, diplomatique, militaire est longtemps resté la norme pour ne laisser que peu de place à l’étude des civilisations, surtout dans le secondaire classique. En bouleversant profondément l’architecture des programmes, la réforme de 1902 a promu l’histoire moderne et surtout contemporaine au détriment de l’histoire ancienne. Les programmes les plus récents innovent en accordant une place plus large à l’étude des civilisations, au récit discontinu, parfois aux études thématiques. Les programmes du primaire obéissent eux à deux constantes. S’étendant jusqu’à nos jours, ils portent essentiellement sur l’histoire locale et nationale, malgré la récente ouverture sur d’autres horizons. Mais quelles que soient les classes, les auteurs soulignent à de multiples reprises que les inflexions historiographiques peinent à se traduire dans les programmes.
Le même constat est dressé pour les méthodes d’enseignement qui tardent elles aussi à s’adapter aux évolutions de la recherche pédagogique puis didactique. Avec l’aval des instructions officielles une démarche de cours centrée sur le discours magistral et la mémorisation s’est rapidement institutionnalisée au secondaire. L’interrogation orale, le cours parlé et le résumé rédigé le plus souvent sans les élèves en sont les fondements, auxquels s’ajoutent ponctuellement la correction du travail personnel et la pratique de la rédaction. En dépit de l’amorce d’une réflexion pédagogique vers 1880 et des appels à encourager la participation et à utiliser davantage et autrement les documents, l’inertie s’impose. La réflexion pédagogique rebondit après 1950 autour de la mise en activité de l’élève et du statut du document. La méthode inductive amenant les élèves à construire un raisonnement et leur savoir s’est imposée d’abord dans le primaire avant de gagner le secondaire. Mais le document reste encore une simple illustration appuyant les propos du professeur et non le point de départ de la construction des savoirs. Il faut attendre les années 1970 pour que se répandent le cours dialogué sollicitant davantage la participation des élèves et les méthodes actives centrées en particulier sur les documents désormais étudiés pour eux-mêmes. Apparus sous la monarchie de Juillet, les manuels, volumineux et peu ou pas illustrés, resteront longtemps utilisés comme livres de lecture pour le prof ou l’élève et non comme outils de travail en classe avant que l’usage plus systématique du document n’impose d’y recourir davantage. Au primaire, si le débat a pu se porter un temps sur les mérites réciproques des méthodes progressive et concentrique, il deviendra plus vif avec l’intrusion à la fin des années 1960 de la pédagogie de l’éveil. Les principales critiques portent alors sur la démarche régressive et l’aspect parcellaire des savoirs, avant que les dernières instructions en date n’invitent là encore à utiliser et questionner davantage les documents.
Le dernier axe concerne les enseignants, particulièrement leur mode de recrutement et de formation. Si les premiers professeurs spécialisés, c’est-à-dire ayant suivi des études d’histoire et réussi un concours de recrutement spécifique pour n’enseigner que cette discipline, sont recrutés dès la Restauration, la spécialisation demeurera longtemps rare et la polyvalence le modèle dominant. L’agrégation créée en 1831, très sélective, et l’Ecole normale ne fournissent que peu de professeurs au secondaire, d’où des accusations répétées de médiocrité et d’ignorance formulées à l’encontre du corps des non spécialistes, qu’une meilleure connaissance de leur part des avancées de la recherche fera peu à peu disparaître. Toujours aussi sélective et éloignée des réalités de l’enseignement secondaire, l’agrégation fait au début des années 1950 une place au CAPES dont les programmes sont identiques. Mais la prégnance du modèle agrégatif maintient la maîtrise d’un savoir comme critère essentiel d’évaluation. De plus en plus nombreux, les professeurs spécialisés ne sont devenus majoritaires qu’au début des années 1990, garantissant une meilleure maîtrise des savoirs à enseigner. Toutefois, la formation initiale des professeurs continue à sanctionner essentiellement les savoirs, les projets de professionnalisation du recrutement ne se concrétisant guère, alors que la formation professionnelle, longtemps réservée aux enseignants du primaire, ne semble pas toujours répondre aux attentes.
Voilà donc une précieuse synthèse qui nourrira avantageusement notre réflexion sur l’école, l’enseignement de nos disciplines et ses finalités. Chacun pourra également replacer ses pratiques dans la longue chaîne pédagogique, y lire leur lente maturation, mieux connaître l’histoire des programmes et des concours de recrutement à laquelle sont consacrées d’utiles chronologies récapitulatives situées en annexe. Certains regretteront pourtant qu’en fin d’ouvrage un certain parti pris se manifeste dans des prises de positions tranchées sur certaines questions vives. L’association traditionnelle et originale de l’histoire et de la géographie scolaires est ainsi dénoncée au regard de l’ampleur du champs de connaissances à maîtriser pour les enseignants sans que soit vraiment rappelé la richesse de cette association. Les auteurs n’ont d’autre part pas de mots assez durs contre la frilosité dont feraient preuve les professeurs d’histoire face aux apports de la recherche didactique, favorisant selon eux, l’inertie des méthodes d’enseignement. Ils s’élèvent d’ailleurs contre les insuffisances de l’enseignement universitaire et de l’épreuve sur dossier du CAPES qui excluent toute réflexion de nature didactique, insuffisances attribuées en partie à la force du modèle agrégatif qui continue à orienter le mode de sélection et de formation des enseignants. A ce compte, d’autres questions tout aussi sensibles auraient pu être abordées, tel l’enseignement du fait religieux. Peut-être inapproprié ici, cet engagement, aussi vigoureux soit-il, n’entame en rien la qualité générale de cette étude.
Copyright Clionautes