Hier est-il un autre aujourd’hui, à moins qu’aujourd’hui ne soit un autre hier ? La solvabilité des états semble un sujet d’incertitude inépuisable. On ne peut manquer, en tout cas, d’établir une étrange résonance avec l’actualité redoutable qui fragilise la monnaie européenne, lorsque l’on ouvre ces pages qui plongent le lecteur dans les secrets d’un outil de dette publique spécifique à l’Ancien Régime : les rentes sur l’Hôtel de Ville de Paris.
La guerre – ou plutôt l’avidité monétaire de la monarchie guerrière – n’est que l’arrière-plan du véritable objet de cette étude, identifié par un sous-titre moins sexy mais plus exact : «la dette publique et les rentiers de l’absolutisme». Comment un Moloch étatique de plus en plus insolvable parvient-il à prolonger son crédit et à mobiliser de nouveaux capitaux au service de sa gloutonnerie budgétaire ? Quelle gestion politique de la dette lui faut-il pratiquer pour maximiser la capacité de prélèvement à crédit du pouvoir royal sans la détruire…. ni la rembourser ? Quels investisseurs attire-t-il, et quels usages économiques et sociaux ceux-ci font-ils de leurs placements dans la rente ? Sur ces enjeux, Katia Béguin, universitaire spécialiste du Grand Siècle, présente un minutieux labeur de recherche, d’une ampleur remarquable, qui étaye un travail approfondi de mise en perspective. La fresque est ardue et exigeante, mais le tableau qui s’en dégage s’avère riche et assez passionnant.
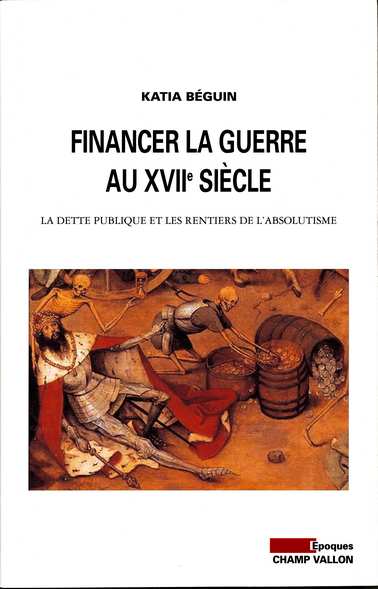
Un État goulu et impécunieux
Les rentes sur l’Hôtel de ville sont le principal outil d’emprunt à long terme de la monarchie française. Créées par la municipalité de Paris à son propre usage en 1522, puis royalisées au cours du XVIIe siècle, elles sont d’une nature complexe et composite. Leur montant gonfle massivement en proportion de la dégradation de leur solvabilité jusqu’à s’apparenter, pour certaines catégories d’émissions, à de véritables « junk bonds » (titres pourris). Le processus d’institutionnalisation et de socialisation de la dette souveraine par ce biais résulte de l’incapacité de l’État royal à assumer ses engagements financiers. Non seulement il se montre impuissant à se désendetter en remboursant les capitaux souscrits, mais la charge de sa dette ne cesse de s’alourdir du fait de son goût pour la guerre.
Or, la rente est un mode de financement qui a l’avantage d’être plus rapide et plus performant que l’impôt mais le défaut d’être basé sur une souscription volontaire, ce qui appelle des conditions de placement attractives. Même si la méthode alourdit le service de la dette, l’outil est donc souple et séduisant. En effet, la rente présente l’agrément -pour l’émetteur comme pour l’investisseur- de n’être liée à aucune échéance de remboursement du capital engagé. Le report indéfini de son amortissement, du fait de l’impécuniosité chronique des caisses publiques, lui confère un caractère perpétuel. L’État est seulement tenu (sans parvenir d’ailleurs à respecter cette contrainte) de régler le service de ses intérêts. Du coup, la rente est aussi employée comme un moyen de conversion commode d’engagements financiers d’abord initiés sous d’autres formes, dont la consolidation s’opère par des jeux d’écriture qui transfèrent la dette d’un poste budgétaire à un autre. En accumulant les émissions et en agrégeant les provenances, le système de la rente publique atteint ainsi le montant vertigineux d’un milliard de livres de capital investi en 1715.
Les pratiques opportunistes du pouvoir royal
Le cadre chronologique étudié par Katia Béguin s’étend de 1594 à 1715 : l’itinéraire de la monarchie en tant qu’emprunteur souverain est balisé, au point de départ comme au point d’arrivée, par l’abdication financière que représente une banqueroute des rentes sur l’Hôtel de ville… Dans l’intervalle, l’État fait montre d’un comportement peu vertueux guidé par les calculs et la nécessité.
L’inventivité des expédients déployés pour appâter les souscripteurs est vaste. Selon les circonstances et la dureté des temps, des techniques variées d’incitation -et parfois de contrainte- sont mises en œuvre : primes d’émission, rachats bonifiés par anticonversion, modulation des montants de souscription et des rendements, manipulation de la valeur des capitaux, emprunts forcés. En sens inverse, lorsque la raréfaction de ses ressources ne lui permet plus de faire face à ses engagements, ou quand les périodes de paix ne rendent plus vital l’appel d’urgence à l’épargne publique, la monarchie s’efforce d’alléger le service de sa dette perpétuelle. Ces situations se traduisent par de multiples formes de défaut, appuyées par un corpus argumentaire justificatif. Suppression ou minoration du versement des quartiers de rente, réduction des taux servis, amortissement différé ou rachat déprécié du capital, extinction autoritaire de certaines émissions, dévaluation des titres, manipulation monétaire ou encore banqueroutes partielles sont les procédés mis tour à tour au service de la régulation des coûts et, de façon velléitaire, de l’effort de désendettement.
L’écosystème nécessaire au fonctionnement de la machine administrative du service de la rente se densifie au fil du temps et de la croissance monumentale des capitaux investis. L’inflation officière qui y est associée en parasite même la solvabilité, les nouveaux offices créés pour administrer les rentes étant gagé sur leur recette, ce qui spolie d’autant le rendement effectif des titres. La complexité de l’ensemble contraste avec les défaillances accrues des mécanismes du contrôle. Le système de garantie existant est en effet lié aux mécanismes de la solidarité urbaine dont la municipalité est la clé de voûte. Or, celle-ci se trouve peu à peu dépossédée de ses pouvoirs d’intervention et de surveillance originels. Rien n’est donc plus en mesure de contrecarrer les tentations abusives du pouvoir monarchique, si ce n’est son propre intérêt à l’autorégulation : de son aptitude ou son inaptitude à maintenir une confiance minimale en sa signature dépend en effet la perspective d’un tarissement de la ressource…
Les stratégies rentières
Comment un instrument aussi peu fiable que la rente publique, régulièrement décriée et émanant d’un pouvoir à la garantie aléatoire, peut-il rester un placement crédible ? Tel est assurément l’angle sous lequel le travail de Katia Béguin présente sa plus forte originalité. Car le paradoxe de la situation est que, malgré les difficultés de placement de certaines émissions, l’évaporation d’une partie des rendements promis et les reniements périodiques de l’État, la dette consolidée parvient pourtant à constituer une forme de placement assez pertinente pour inciter à la patrimonialisation des titres émis.
De facto, le mécanisme de la dette perpétuelle fait des rentiers des « actionnaires de l’absolutisme », pour réinterpréter une judicieuse formule de Robert Descimon. Cela justifie qu’ils déploient des stratégies de contestation et d’influence pour défendre leurs intérêts lésés par les pratiques royales. A titre d’exemple concret, on découvre ainsi avec un intérêt amusé les parades employées pour conjurer le paiement irrégulier ou partiel des quartiers de rente. Le répertoire des pratiques de contournement usitées est riche : traitements de faveur obtenus par des connexions privilégiées (notamment au sein du milieu des traitants et des officiers des finances), recours à des intermédiaires spécialisés, versement de rétrocommissions, sans omettre de subtiles manipulations destinées à mieux positionner, dans l’ordre alphabétique qui gouvernait l’ordre des paiements, les titulaires nominaux des inscriptions de rente…
La diversité des usages sociaux de la rente correspond à des profils de détenteurs bien spécifiés poursuivant des finalités différenciées. Le lieu de paiement des échéances (qui demeure Paris) fait que les rentiers sont fondamentalement parisiens. Seuls sortent de ce déterminisme de proximité quelques héritiers de province et un noyau de banquiers génois choyés par la monarchie. En étudiant la sociologie des prêteurs, Katia Béguin met en évidence la cohabitation d’une double clientèle de spéculateurs et d’épargnants, aux attentes parfois convergentes mais aux arbitrages distincts. Il est vrai que leur inégalité devant le risque -et l’accès à l’information- est palpable. Le noyau des premiers, investisseurs avertis, est animé par une motivation spéculative et, parfois, de dissimulation d’avoirs. La masse des seconds s’inscrit en revanche dans une logique de placement patrimonial beaucoup plus statique. Les deux groupes entrent en relation sur le marché secondaire des titres.
L’attrait principal dont sont investis les titres de rente est leur plasticité, qui justifie des formes d’utilisation multiples. Ils peuvent être employés comme des immeubles fictifs (dont la divisibilité facilité les partages successoraux), une monnaie de substitution ou une garantie hypothécaire dans les transactions, un moyen privilégié de restructuration patrimoniale lors des grandes étapes de la vie, ou encore comme un bien facilement monétisable, dont les mutations sont arbitrées par des intermédiaires parmi lesquels les notaires parisiens occupent une place qui semble déterminante. Après avoir initialement tenté d’interférer avec ces transactions souterraines, dont le flux est difficile à mesurer, l’appareil fisco-administratif de la monarchie s’efforce d’amplifier la transparence et la liquidité du marché secondaire des titres, afin de mieux fluidifier les échanges directs entre les investisseurs. La leçon de ce changement de pied est assez fascinante : faute d’être en mesure d’amortir sa dette, l’État en facilite la circulation entre les particuliers, de manière à maintenir la solvabilité du système de la rente.
Du panorama tracé avec densité par Katia Béguin, on retiendra assurément ce paradoxe : l’intérêt bien compris de l’État ne contrevenait pas nécessairement avec les besoins sociaux de ses prêteurs. En s’appropriant l’outil, les rentiers pouvaient s’accommoder de ses fragilités, ses insuffisances et parfois ses duplicités. Mais, comme chaque nouveau défaut ne manquait pas de le démontrer, l’équilibre de cette architecture était des plus précaires. Charles Ponzi, assurément, s’y serait trouvé fort à son aise…













