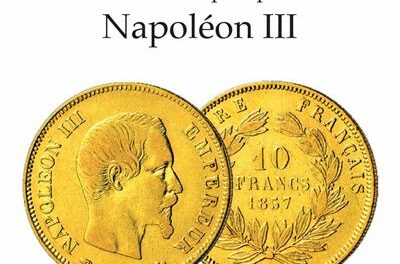Au moment où s’achève le quinquennat de François Hollande, le second président socialiste de la Ve République, les éditions du Nouveau Monde en collaboration avec l’institut François Mitterrand et le ministère de la défense publient le Verbatim d’un colloque qui a réuni en mai 2015 de nombreux participants, spécialistes des questions de défense, historiens, mais aussi témoins et acteurs de ces événements.
Cela suppose que l’on prenne des précautions pour les affirmations qui sont avancées, certaines pouvant apparaître comme une justification a posteriori des politiques qui ont été conduites. C’est évidemment la règle du jeu, et les historiens savent qu’ils doivent croiser les sources pour envisager approcher la vérité sur les ressorts de plusieurs événements qui suscitent encore parfois la controverse, comme le rôle de la France au Rwanda.
Plusieurs thèmes abordés
Ce colloque se décline en plusieurs temps, le déroulé des interventions part de la formation du jeune François Mitterrand, sergent chef de la coloniale pendant son service militaire, juste avant la seconde guerre mondiale, et prisonnier de guerre. François Mitterrand n’a jamais été tenté par le métier des armes, contrairement à son frère, le général Jacques Mitterrand, mais il a baigné dans un milieu très attaché à la place de l’armée dans la nation, ce qui a pu en partie expliquer pourquoi, après son évasion, admirateur de la personne de Philippe Pétain, considéré comme un grand soldat, il a pu rejoindre Vichy après son évasion. Sa rupture avec Vichy intervient en 1942, et il rejoint la résistance, même s’il ne parvient pas forcément à s’entendre avec le général De Gaulle.
Sa longue carrière ministérielle sous la IVe République, la détention de portefeuilles régaliens, comme l’intérieur et la justice, lui ont permis, dans le contexte des guerres coloniales, d’être en relation constante avec l’institution militaire. L’un des généraux putschistes d’Alger en 1961, le général Challe avait des sympathies socialistes qui étaient notoires, tout comme le général Raoul Salan, considéré comme un officier « républicain ».
Dans l’opposition
L’arrivée du général De Gaulle au pouvoir, à partir de 1958, l’écarte durablement du pouvoir, il manifeste des réserves à propos de la force de dissuasion, même si c’est sous la IVe République, sous l’impulsion de Pierre Mendès-France en 1954, mais aussi de Guy Mollet, surtout après la crise de Suez, que les premiers travaux expérimentaux concernant le nucléaire militaire sont entrepris. L’opposition de François Mitterrand à la force de frappe n’a pas été aussi résolue que ce que l’on affirme couramment. Sous l’impulsion de Charles Hernu, mais aussi de Louis Mermaz, on se rend compte que sur ce sujet sa réflexion est ouverte, et qu’il ne cache pas ses réserves à propos d’un pacifisme de principe dont la gauche est porteuse au début des années 70.
Au sein du parti socialiste, dont il s’assure le contrôle à partir de 1971, il contourne les éventuels opposants à une doctrine spécifique en matière de défense, en organisant des discussions au sein des fédérations sous couvert de « la Convention pour l’armée nouvelle », qui n’était pas directement liée au parti, soit par « la nouvelle revue socialiste ». Cela permet, avec différentes personnalités comme Pierre Schweed, François Heibsbourg, sous l’égide de Charles Hernu d’aborder les différentes questions qui se posent, comme la place de la conscription, à laquelle François Mitterrand restera toujours très attaché, les débats sur la force d’action rapide, celui du nucléaire tactique avec les missiles de type Pluton, remplacés ensuite par les missiles Hadès qui ont été déployés sous le septennat de Valéry Giscard d’Estaing. Cet armement nucléaire avait pour fonction, dans le cadre d’une invasion par les forces du pacte de Varsovie, de constituer « l’ultime avertissement », avant l’engagement du nucléaire stratégique.
L’exercice du pouvoir
Lorsque François Mitterrand arrive à l’Élysée, après le 10 mai 1981, il doit faire face à de fortes réserves d’une partie non négligeable de l’institution militaire qui s’inquiète de la présence de communistes au gouvernement, et dont la majorité des cadres ne sont pas véritablement enthousiasmés par l’arrivée de la gauche aux responsabilités.
Nous sommes dans un contexte international qui est celui de la guerre fraîche, de cette montée des tensions qui s’est manifestée par l’invasion soviétique de l’Afghanistan, en décembre 1979, par le déploiement de la marine soviétique de haute mer sur tous les océans, et particulièrement à partir des facilités navales offertes par les nouveaux régimes prosoviétiques, issus de la décolonisation de l’Angola, du Mozambique, de la Guinée Bissau.
Pour ce qui concerne l’Europe, le déploiement par les soviétiques d’un dispositif de missiles sol-sol, les fameux SS20, dont la portée et la précision permette d’imposer une pression sur tout éventuelle concentration des forces de l’OTAN, est à l’origine de ce bras de fer à propos des euromissiles. L’alliance atlantique ayant opposé le processus de la double décision, consistant à opposer à l’arsenal soviétique des dispositifs équivalents, les Pershing II et les missiles de croisière, en nombre équivalent.
La gauche de gouvernement, sous François Mitterrand, mais cela a pu se vérifier également avec François Hollande, qui a été constamment accompagné par Jean-Yves le Drian comme ministre de la défense, le même Jean-Yves le Drian qui participait au cercle de réflexion autour de Charles Hernu, a toujours manifesté son intérêt pour les questions militaires, parfois à contre-courant d’une partie significative des composantes de la gauche.
La continuité
François Mitterrand, dès sa prise de fonction, s’inscrit dans la continuité, en conservant le chef d’état-major des armées, nommée par Valéry Giscard d’Estaing, le général Jeannou Lacaze, et en conservant, autant que possible, les mêmes officiers généraux, dans son état-major particulier. Pendant ses deux mandats, il y aura une continuité, assez remarquable, avec un passage de l’état-major particulier à l’état-major des armées, du général Saulnier, jusqu’à l’amiral Lanxade. Parmi les actions très peu connues entreprises pendant les deux septennats de François Mitterrand, Pierre Joxe, qui fut son ministre de l’intérieur, rappelle la création de la direction du renseignement militaire en 1992, et le lancement du programme de satellites d’observation militaire Hélios, permettant de s’affranchir de la maîtrise des États-Unis dans ce domaine.
Parmi les questions qui ont été également évoquées dans ce colloque, on rappellera les interrogations propos du service national, dont la durée de 12 mois aurait pu être ramenée à six, ce qui était prévu dans le programme du candidat Mitterrand avant 1981, mais qui n’a pas été mis en œuvre. C’est en 1993, que Pierre Joxe, alors ministre de la défense, ramène la durée du service à 10 mois.
Sur la question de la conscription, François Mitterrand a toujours été réservé face à l’armée de métier, sans doute parce que la gauche avait en mémoire la tentative putschiste d’avril 1961 en Algérie, et plus près encore le coup d’état militaire conduit par les forces armées chiliennes en septembre 1973, contre le président socialiste Salvador Allende. La conscription pouvait apparaître comme une sorte de garde-fou contre les tentations putschistes éventuelles.
On se rappellera du contexte particulier de la deuxième moitié des années 1970, notamment dans les casernes, avec la diffusion, essentiellement organisée par la ligue communiste révolutionnaire, ancêtre du NPA, d’une propagande antimilitariste au sein des forces armées, qui avait conduit, dans la ville de garnison de Draguignan, à une manifestation d’appelés, contestant la hiérarchie militaire.
La contestation dans les forces armées
Cet épisode très largement oublié avait inquiété la hiérarchie militaire. Si la suppression des tribunaux militaires et des prisons régimentaires a été actée par la gauche au pouvoir, l’institution militaire a pu maintenir ses règles en matière de discipline, avec l’aval du pouvoir politique.
58 cercueils aux Invalides
L’attentat du drakkar, cet immeuble qui était le cantonnement des soldats français de la force multinationale de sécurité à Beyrouth, pendant la guerre civile libanaise, avec 58 parachutistes français tués, a très probablement constitué un moment extrêmement fort, de la présidence de François Mitterrand, et de ses relations avec les forces armées. Les 58 parachutistes tués n’étaient pas, loin s’en faut, des professionnels, mais bien des appelés, certes volontaires, mais des appelés tout de même, servant dans le premier régiment de chasseurs parachutistes. François Mitterrand s’est rendu sur place, malgré les risques que pouvait représenter le dispositif antiaérien du Hezbollah,–l’avion présidentiel survolant les quartiers chiites de Beyrouth–, et des bombardements de représailles ont été conduits, sans aucun soutien des États-Unis, contre les positions des auteurs présumés de cet attentat, sur la plaine de la Bekaa.
Avec l’arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche, on a pu craindre pendant un temps, toujours dans le contexte de tensions entre les États-Unis et l’Union soviétique, que la France ne soit plus considérée comme une alliée fiable par Washington. Très rapidement, François Mitterrand a su montrer qu’il resterait fidèle en tout état de cause à l’alliance atlantique, et que dans ce que l’on a appelé la querelle des euromissiles, jusqu’au traité de Washington de 1987, qui marque le début de leur démantèlement, la France avait très clairement choisi de ne pas baisser la garde. Qui se souvient aujourd’hui de l’affaire Farewell, le pseudonyme d’un lieutenant-colonel soviétique, responsable du KGB, recruté par les services français en pleine guerre froide ? Ces informations ont été transmises aux services de renseignement des États-Unis, alors que les ministres communistes participaient au gouvernement français. Une charrette de « diplomates » soviétiques a d’ailleurs été expulsée du territoire français.
La fin de la guerre froide
Au moment de l’arrivée au pouvoir de Youri Andropov, en 1983, le successeur de Léonid Brejnev, et alors que les soviétiques déploient les SS20 en Europe, le gouvernement français, et François Mitterrand, soutiennent la fermeté de l’alliance atlantique, l’arsenal nucléaire français restant indépendant de l’OTAN, mais venant toutefois compléter le parapluie nucléaire occidental face à la menace soviétique.
Cette position du gouvernement français était d’ailleurs assez originale dans la gauche européenne, le pacifisme qui s’exprimait avec ce slogan terrible « plutôt rouges que morts », rappelait étrangement les comportements « munichois », de 1938.
En 1983, François Mitterrand se rend au Bundestag pour apporter le soutien de la France au déploiement des missiles de l’OTAN sur le territoire allemand.
L’évolution intérieure de l’Union soviétique, avec l’accession au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev a été suivie avec beaucoup d’attention par François Mitterrand. Ce dernier semblait vouloir accompagner le nouveau dirigeant soviétique dans son effort de réforme, voyant dans la réussite de la perestroïka et de la glasnost une occasion d’en finir avec cette « guerre fraîche », génératrice de tensions qui pouvaient devenir incontrôlables.
Les différents intervenants de ce colloque ont voulu tordre le cou à cette idée qui circule toujours parfois, d’un François Mitterrand qui aurait été surpris, et qui n’aurait pas su prendre la mesure, de l’effondrement du bloc soviétique à partir de 1989. Certaines interventions, comme celle de Édith Cresson soulignent au contraire sa lucidité, voire son anticipation, mais il faudra distinguer sans doute la volonté hagiographique de la réalité historique.
On peut noter d’ailleurs que face au processus d’unification allemande, très rapidement réalisé, François Mitterrand est parfaitement conscient que cela générera un déséquilibre entre la France et la nouvelle Allemagne, et qu’il conviendra d’ancrer cette dernière solidement dans l’Europe, ce qui conduit d’ailleurs au processus de Maastricht, qui constitue à cet égard une forme de compromis dans ce domaine.
On restera tout de même assez étonné de voir que dans le Verbatim de ce colloque la question de l’attitude du président de la république française lors de la tentative de coup d’État, d’Août 1991, contre Gorbatchev, n’est pas été évoquée. Le souvenir que l’on peut en avoir montre tout de même une certaine forme de flottement, à propos de l’attitude que la France pouvait avoir à l’égard de ceux qui ont pu pendant quelques heures, incarner le pouvoir en Union soviétique, avant que la pression de la rue, l’attitude de Boris Eltsine devant la douma, ne signe l’échec de ce coup d’État, et en même temps le début du processus qui conduit à l’implosion de l’URSS en décembre 1991.
La gauche et les opérations extérieures
Les parties les plus intéressantes de cet ouvrage, et certainement les plus éclairantes pour ce qui concerne les périodes actuelles, se trouve dans les chapitres qui sont consacrés aux opérations extérieures des deux quinquennats.
On citera l’attitude extrêmement ferme du gouvernement français à l’égard de la Libye du colonel Kadhafi qui cherchait pendant la période 1983–1984 à déstabiliser le Tchad. La France a très largement engagé ses forces pour défendre l’intégrité territoriale du pays, et on apprend même que tout un ensemble aéronaval avait été déployé dans le plus grand secret pour mener des frappes aériennes sur la Libye.
Ce secret a été particulièrement bien gardé, –cela serait impossible aujourd’hui–, au point que même le préfet maritime de Toulon était dans l’ignorance de ces préparatifs, et qu’aucune information n’a pu filtrer dans la presse.
On citera également l’intervention française pendant l’opération tempête du désert, avec l’opération Daguet. La France a cherché jusqu’au dernier moment à convaincre Saddam Hussein de se retirer du Koweït qu’il avait envahi en août 1990, avant d’engager des forces significatives dans la coalition, en application d’une résolution des Nations unies.
On notera ce propos, et cela n’était pas évident à l’époque, l’exigence du président de la république qui ne souhaitait pas la participation de soldats du contingent à cette opération. Cette décision n’était pas évidente à mettre en œuvre, dans la mesure où une bonne partie de la logistique de l’armée française utilisait cette catégorie de personnel. Pour répondre à la volonté présidentielle, les soldats volontaires ont dû être engagés sous contrat, comme préalable à leur participation.
Enfin, il conviendra d’évoquer, même si le sujet est encore sensible, la question du Rwanda. Contrairement à ce que l’on croit, l’engagement de la France est largement antérieur au génocide de 1994. Dès 1990 des unités de l’armée française apportent leur soutien au gouvernement Hutu mais exercent une pression sur ce dernier qui respecte les droits de la minorité Tutsi dans le pays.
Les questions sur le Rwanda
Paul Kagamé, le leader du front patriotique rwandais, qui agit à partir de l’Ouganda contre le gouvernement du président Habyarimana, cherche à s’appuyer sur cette minorité Tutsi, à l’intérieur du pays, pour s’emparer du pouvoir.
Jusqu’en 1994, sur fond de rivalité entre les États-Unis qui apportent un soutien à l’Ouganda, et la France qui défend l’intégrité territoriale du Rwanda, les forces armées françaises présentes sur le terrain garantissent une certaine forme d’équilibre entre les deux communautés, les Hutus et les Tutsis. La France est partie prenante des accords politiques d’Arusha du 4 août 1993, et retire l’essentiel de ses troupes, quelques mois avant l’attentat contre le président Habyarimana, le 6 avril 1994. Face à l’offensive du front patriotique rwandais, la spirale génocidaire s’enclenche, et c’est dans le cadre de la cohabitation, que Alain Juppé, ministre des affaires étrangères d’ Édouard Balladur et François Mitterrand met en œuvre l’opération turquoise qui permet de sécuriser, autant que possible, le Sud-Ouest du Rwanda en attendant l’arrivée des forces des Nations unies, dont la lenteur de déploiement est toujours un problème récurrent.
On évoquera pour terminer la politique de la France lors de la guerre en Bosnie, le voyage de François Mitterrand à Sarajevo, et encore une fois le fait que les troupes françaises qui ont été engagées sur le terrain, ont pu empêcher que les forces serbes ne se livrent à des massacres encore plus importants que ceux qu’ils ont pu commettre dans d’autres points du pays. Beaucoup de reproches ont pu être faits, et notamment la « serbophilie » dont François Mitterrand a pu faire preuve, en raison de l’histoire commune de la France de la Serbie pendant la première guerre mondiale, mais ces affirmations ne résistent pas à l’examen lucide des faits.
La parution de cet ouvrage présente un intérêt majeur, même s’il est un recueil de témoignages, qui demande encore être examiné à partir de l’étude des archives, qui s’ouvrent peu à peu, même si pour la dimension purement militaire, le fameux « confidentiel défense », reste encore un obstacle.
François Mitterrand, comme ses successeurs, attachait une importance toute particulière au renseignement et à des actions de forces spéciales, une façon plutôt discrète, mais pourtant bien réelle d’agir comme chef des armées, avec le poids particulier que la responsabilité d’être le décideur ultime pour le déclenchement du feu nucléaire, fait peser sur les épaules d’un homme. Dans ce domaine, François Mitterrand, c’est ce qu’il faut retenir de cet ouvrage, a été à la hauteur de cette charge.