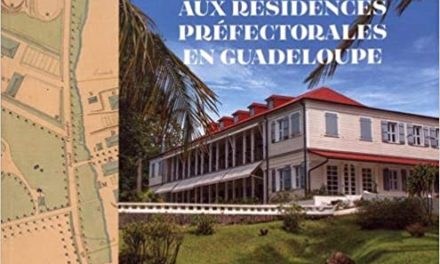Raphaëlle Branche est depuis 20 ans une spécialiste reconnue de la guerre d’Algérie. Sa thèse consacrée à la torture pratiquée par l’armée française a marqué l’historiographie de ce sujet douloureux et politiquement sensible. Cette thèse a contribué à briser la chappe de silence qui pesait sur les “événements d’Algérie” et, au delà de son intérêt historique, elle a eu ainsi pour effet social de libérer la parole de nombreux anciens combattants de cette guerre si particulière.
Son dernier ouvrage, “Papa, qu’as-tu fait en Algérie ?” est, comme l’indique le sous-titre, une enquête sur un silence familial. Cette place du silence sur l’expérience algérienne du père ou du mari au sein des familles, l’historienne l’avait déjà noté à la fin des années 90 au moment où elle enquêtait pour sa thèse et quelque 20 ans plus tard, c’est donc à cette question qu’ elle consacre son livre .
Les mémoires familiales de la guerre
Le postulat de Raphaëlle Branche, c’est que “nombre de familles françaises sont habitées par les traces de cette guerre qui ne fut officiellement reconnue qu’en 1999” et son ambition est de “comprendre ce qui s’est joué dans les familles et comment la guerre a été vécue puis racontée et transmise” [afin d´…] éclairer d’une manière inédite la place de cette guerre dans la société française » (p.8). Place importante s’ il en est, puisqu’ au moins un million et demi de conscrits ont été envoyés en Algérie pendant la guerre, des soldats qui furent aussi des fils, des maris, des frères ou des pères de famille.
Partant du principe que les silences sont des « silences familiaux », l’historienne devait donc baser son travail de recherche sur les familles entières d’anciens combattants afin d’y retrouver les traces laissées par la guerre. Les sources principales qui ont servi à composer cet ouvrage ne se trouvaient pas tellement dans les archives et ont donc été élaborées par l’historienne : au cœur de son enquête, près de 300 questionnaires qui ont été envoyés à 39 familles de divers horizons sociaux et idéologiques, complétés parfois par des entretiens familiaux et par l’analyse de documents privés qu’on lui a confiés (lettres, journaux intimes, photos).
Cette démarche originale mérite d’être soulignée car elle n’est pas sans conséquences sur le fond et la forme de l’ouvrage. Une part importante du travail de recherche repose sur des rencontres, des moments de vie partagés par l’historienne et cela donne un récit empreint d’empathie et de profond respect des personnes interrogées. Historienne retraçant une expérience collective, elle n’oublie cependant jamais la singularité des histoires individuelles : celles-ci sont en quelque sorte comme des fils de toutes les couleurs de ce qui constituent la trame narrative de l’ouvrage ; comme autant de micro-histoires qui maintiennent l’intérêt du lecteur en éveil.
La génération qui a « fait l’Algérie »
L’ouvrage est construit selon un plan chronologique en trois parties. La première est consacrée à la période fondatrice de la guerre vécue par les soldats en Algérie et les modes de transmission de cette expérience aux familles et aux proches. La seconde analyse les conditions parfois délicates du retour dans la métropole, période pendant laquelle ces jeunes hommes libérés du devoir militaire deviennnent de vrais adultes (aux yeux de la société), fondent des familles dans une France en mutations et qui cherche à oublier la guerre d’Algérie. La dernière analyse l’évolution des dernières décennies, celle d’une France qui accepte enfin de donner un nom à cette guerre, qui voit peu à peu la parole se libérer, non seulement dans la société mais aussi au sein des familles, entre des anciens combattants vieillissants et leurs enfants (et parfois petits-enfants!) désireux de savoir : « Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? »
Dans le premier chapitre, l’autrice s’attache à dessiner les contours de la génération des soldats qui ont « fait l’Algérie ». Le terme de génération est souvent employé en histoire ou en sciences sociales parce qu’il est commode, sans qu’on prenne la peine la plupart du temps de définir clairement ce qu’on entend par là. R. Branche y consacre plus de 50 pages, preuve de l’importance accordée à cette notion et son analyse est menée avec brio. Selon l’historienne, ce n’est pas uniquement l’expérience en Algérie qui autorise à parler de génération car d’autres éléments essentiels doivent être pris en compte. Les conscrits envoyés en Algérie – environ un 1,5 million d’hommes – sont nés entre 1930 et 1942, en majorité entre 1936 et 1942, soit pendant l’étiage de la natalité française de l’entre-deux-guerres. Cette génération est née « à l’ombre des guerres mondiales » (p.27), avec des pères ou des grands-pères anciens combattants de 14-18 et/ou de 40 et beaucoup d’entre eux sont donc aussi fils de prisionniers de guerre, privés de la présence du père pendant 5 ans.
Cette expérience est partagée avec les filles, soeurs, fiancées ou futures épouses nées à la même époque. Aussi est-ce une génération marquée par la guerre : les garçons s’inscrivent pour la plupart dans une lignée de citoyens-soldats et grandissent dans une société dans laquelle le service militaire et le devoir militaire bénéficient d’un très large consensus social, un service militaire perçu comme une dimension essentielle de la masculinité, vision acceptée aussi par les soeurs, les fiancées et les épouses. Si l’on suit l’historienne, « dans la France du début des années 50, les ordres du genre et de l’âge semblent intouchés et rattachent ses jeunes aux modèles des générations précédentes » (p.76). La rupture générationnelle s’effectuera avec la génération du Baby Boom, celle qui n’ a pas connu la guerre et qui vit dans une France transformée par les Trente Glorieuses.
Les relations avec la famille en métropole
Les chapitres 2, 3 et 4 sont consacrés à l’analyse des relations entre les soldats partis en Algérie et leurs familles et proches restés en métropole. La correspondance épistolaire joue un rôle essentiel dans le maintien des liens familiaux et c’est aussi pendant cette période que se mettent en place les structures du silence dans les familles. Officiellement, ces soldats ne sont pas « partis à la guerre », mais sont partis faire leur service militaire en Algérie pour y effectuer des « opérations de maintien de l’ordre ». De ce mensonge originel découlent beaucoup de choses : dans ses lettres, « le soldat rassure ses proches, qui le maintiennent dans leur monde en lui donnant des nouvelles de la vie qu’il a laissée en métropole » (p.79). « Le pacte épistolaire » (p. 89), pour tacite qu’il soit, est clair : le soldat s’efforce de ne pas inquiéter ses proches et, en échange, la famille le rassure sur le fait que son retour est attendu avec impatience par tous et qu’il a toujours sa place dans le cocon familial.
Est-ce à dire qu’il ne se dit rien, ou pas grand chose, sur les expériences de guerre, parfois traumatisantes, vécues par les soldats? Raphaëlle Branche qui a étudié ici de multiples correspondances épistolaires s’attache à mettre en lumière la diversité des attitudes et des échanges. Il semble – c’est ma conclusion après lecture du livre – que ceux qui sont partis en Algérie avec des convictions politiques ou spirituelles fortes (les communistes et les catholiques engagés, en particulier) aient été ceux qui ont été le plus aptes à « dire » la guerre, la peur ou la honte, en trouvant un confident ou une confidente : un frère, une soeur, un ami intime, un prêtre… Témoignages qui peuvent parfois connaître une certaine diffusion comme ceux de Stanislas Hutin évoqués à la page 200.
Le retour des mobilisés
La deuxième partie, intitulée »le retour », est composée de 4 chapitres. Raphaëlle Branche analyse les conditions et les difficultés de réintégration plus ou moins grandes de ces jeunes dans la vie civile. Elle met en lumière les caractères particuliers de cette guerre que la société, les proches et parfois les soldats eux-mêmes n’identifient pas comme telle. La reconnaissance des soldats comme ancien combattant sera très progressive et ce statut ne leur sera conféré par l’État qu’en 1974. Cette lente reconnaissance est analysée finement au chapitre 7 car elle est associée à l’émergence d’une conscience collective chez les anciens de la guerre d’Algérie.
Le retour en métropole est une période délicate à gérer pour beaucoup, car elle correspond souvent à l’entrée dans la vie adulte, le moment où l’on choisit une carrière professionnelle, où l’on fonde un foyer. Les soldats démobilisés rentrent dans un univers familial qui souvent considèrent l’expérience en Algérie comme une parenthèse à refermer et c’est ainsi que se mettent en place les silences familiaux : parfois l’on garde le silence car on ne souhaite pas parler mais parfois aussi parce que l’on sait qu’on ne sera pas écouté…
Certains reviennent brisés et traumatisés par l’expérience algérienne. Outre les témoignages recueillies par l’historienne, celle-ci a également consulté les dossiers médicaux d’un certain nombre d’anciens combattants traités dans des hôpitaux psychiatriques. Cette dimension « psychiatrique » est peut être l’aspect le plus original et novateur du livre. Raphaëlle Branche analyse le retard de la psychiatrie française avec pour point de comparaison la prise en charge ses anciens combattants du Viet-Nam aux États-Unis et elle met en lumière les séquelles traumatiques de la guerre d’Algérie.
La transmission
La dernière partie, « L’héritage », analyse comment le temps passant, les anciens vieillissant, la mort se rapprochant, les pères cherchent à transmettre à leurs enfants et petits-enfants un peu de leur héritage algérien. Mais elle analyse aussi comment les enfants et petits-enfants devenus adultes cherchent également à se saisir, à s’approprier cet héritage algérien du père pour l’intégrer à l’histoire familiale. La parole se libère dans les familles et, en historienne, R. Branche replace ce mouvement de réappropriation de la mémoire algérienne dans le contexte d’une société française qui à partir des années 80/90 accepte progressivement de regarder la guerre d’Algérie en face. Car « quand le temps social et le temps familial convergent, alors l’inscription de chacun et de chacune dans un héritage spécifique peut se faire plus simplement. » (p. 468)
On l’aura compris, « Papa, qu’as-tu fait en Algérie ? » est un livre d’une très bonne historienne dont je recommande vivement la lecture et ce, pour au moins trois raisons. Au delà de la question de la mémoire de la guerre d’Algérie, le livre peut et doit être lu aussi comme une analyse des évolutions de la société française des 80 dernières années. Cette inscription de son sujet dans le cadre général de l’histoire de la France contemporaine est une grande réussite. Certains lecteurs de ce livre pourront sans doute se reconnaître parce qu’ils sont eux-mêmes fils, filles ou petits-enfants d’un ancien combattant de la guerre d’Algérie. Les autres, ceux qui n’ont pas de proches ayant « fait l’Algérie » (ce qui est mon cas), y trouveront de quoi alimenter leur réflexion sur ces questions universelles et intimes que l’on se pose tous à un certain moment de sa vie : celle de la transmission au sein de sa propre famille.