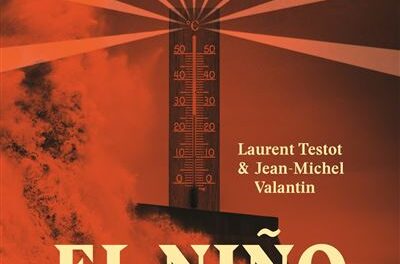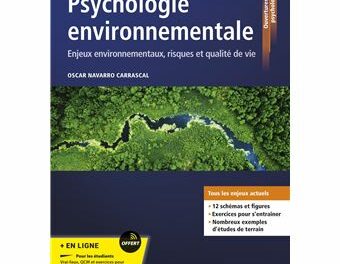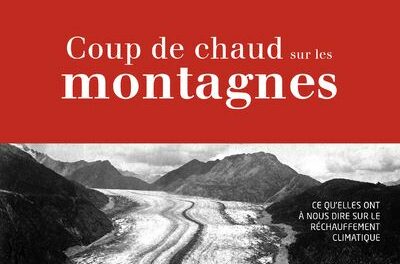Sylvie Brunel repart en guerre !
Dans la lignée de l’ouvrage qu’elle avait codirigé avec Jean-Robert Pitte l’année passée, elle livre ici une apologie de l’action des hommes sur la terre. « Je suis amoureuse du monde. Je le trouve beau, accueillant, hospitalier là où l’homme a imprimé sa marque, façonné les paysages, apprivoisé l’eau, reverdi le désert, créé des jardins. » Elle refuse de se laisser aller au catastrophisme, alimenté par la crainte d’un réchauffement climatique. Elle estime qu’il faut arrêter de dénoncer l’anthropisation de la planète. Elle rappelle que, grâce à l’action des hommes, nous sommes moins nombreux à mourir de faim, de froid, de maladies qu’autrefois. « L’histoire de l’humanité est celle d’une âpre lutte pour la survie, avec, pour compagnes quotidiennes, l’insécurité et la vulnérabilité. »
Elle s’insurge contre les « nouveaux flagellants, qui paraissent trouver une jouissance masochiste dans la mise en accusation d’eux-mêmes – et surtout de leurs concitoyens – et vont partout en appelant le monde à l’expiation collective. » Elle croît en l’action politique (quand elle est menée au nom de l’intérêt général) pour améliorer le sort de l’humanité car elle ne nie pas les problèmes. Elle veut croire en la capacité des Hommes à trouver des solutions durables aux situations que nous vivons. Pour cela, elle appuie son discours sur des exemples copieusement développés : la Camargue, le monde insulaire, les cités-Etats du Golfe, le Nordeste brésilien ou bien encore l’Afrique.
L’ouvrage s’apparente beaucoup à un ouvrage d’ego-géographie (sa fête d’anniversaire, histoire de sa grand-mère en Polynésie, ses missions au Brésil, ses cours à Abu Dhabi à la « Sorbonne des Sables »…). Le plan de l’ouvrage brasse et rebrasse les thèmes chers à Sylvie Brunel : le développement durable, la faim, l’Afrique. L’ensemble est globalement écrit avec une plume alerte, convaincante comme son auteure qui, lors de conférences ou de cours, sait captiver un public (souvent acquis à sa cause). Elle reprend ici le thème de la « disneylandisation » à travers plusieurs exemples. Avec celui de la Camargue, le jeu des acteurs est décortiqué pour mettre en évidence ce qui se cache derrière les conflits d’usage. Elle montre qu’un espace naturel ou classé comme tel n’a rien de naturel. La Camargue est aussi le résultat de l’action des hommes. Elle met en garde contre la patrimonialisation de sites par le biais de l’UNESCO, si cela se fait sans tenir compte des populations locales en tant qu’acteurs à part entière. Elle ose s’attaquer à la thèse de Jared Diamond, qui explique la disparition des Pascuans par une guerre entre clans, responsable de la déforestation. Elle mobilise pour cela les arguments de deux archéologues français : Catherine et Michel Orliac. Ces derniers rendent responsables de cet état de fait une longue sécheresse (au milieu du XVII° siècle) et la traite des esclaves, aux effets aggravés par le développement de l’élevage ovin par les Chiliens au début du XXème siècle. Les chapitres dédiés aux thèmes les plus souvent exploités par l’auteure sont particulièrement éclairants. Celui sur l’Afrique achève de faire réfléchir sur le « syndrome de Tarzan » (l’ingérence écologique conduite par les Occidentaux dans le cadre d’accords signés avec des « démocratures ») et ses méfaits. Elle prend la défense de ceux qui cultivent la terre et qui sont souvent accusés de dégrader l’environnement par l’usage d’engrais ou d’irrigation alors que le productivisme réduit considérablement l’emprise foncière de l’agriculture. Elle démontre que l’idée qui tend à faire croître qu’en consommant moins de viande, il y aura plus de céréales pour nourrir la planète est une baliverne. C’est le meilleur moyen de totalement désorganiser un système qui ne donne pas déjà toute entière satisfaction. Ce qui compte ce sont les trois P : paix, pluie et prix. « (…) aujourd’hui les meilleurs alliés de la nature, les vrais écologistes, ceux qui sont les sentinelles de la terre et qui peuvent aider le monde à s’engager dans ce vœu désormais universel d’un développement durable, ce sont les agriculteurs ! Eux connaissent parfaitement la nature, au lieu d’en concevoir une vision bucolique et désincarnée. Et ils savent qu’elle envahit tout, colonise tout, reprenant ses droits dès que s’affaiblit la main de l’homme ».
Catherine Didier-Fèvre © Les Clionautes