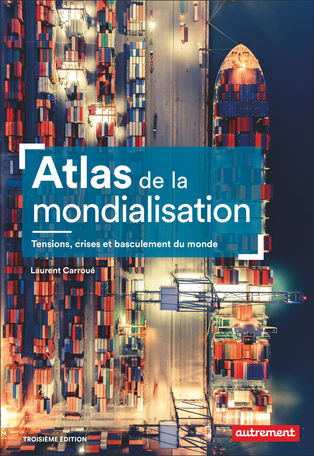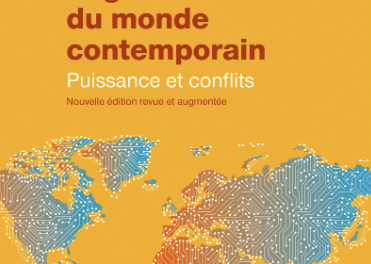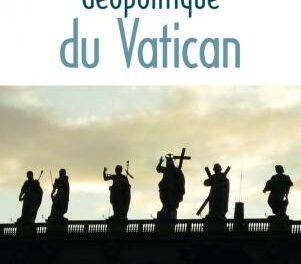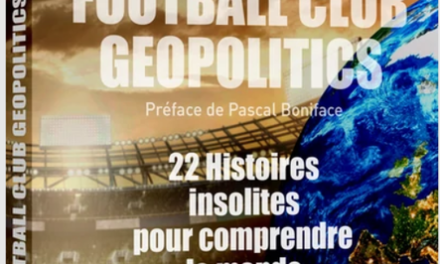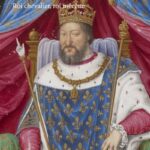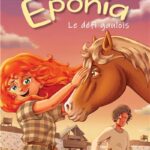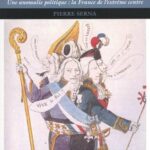Laurent Carroué est géographe, ancien inspecteur général de l’Éducation nationale, spécialiste des dynamiques géoéconomiques mondiales. Il est l’un des grands vulgarisateurs actuels des mécanismes de la mondialisation, qu’il analyse toujours dans une perspective géohistorique, géopolitique et géoéconomique.
Cette 3e édition de l’Atlas de la mondialisation, publiée en 2025, s’inscrit dans la continuité d’un travail de longue haleine entamé en 2008. Elle apporte une mise à jour précieuse à l’heure où le monde connaît de profonds bouleversements : fragmentations géopolitiques, recompositions industrielles, enjeux climatiques, mais aussi remises en cause du libre-échange.
Une structure claire, au service de la compréhension du monde
L’ouvrage s’ouvre sur une introduction dense et pédagogique, qui pose les jalons d’une définition rigoureuse de la mondialisation : un système géohistorique, géoéconomique, géopolitique et géostratégique, en évolution permanente. Laurent Carroué y rappelle que la mondialisation n’est ni linéaire, ni homogène, ni inéluctable : elle est traversée de crises, de ruptures et de recompositions, comme l’illustrent la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine ou la transition énergétique.
L’atlas s’organise ensuite en quatre grandes parties :
1. La mondialisation : un système géohistorique, géoéconomique, géopolitique et géostratégique
Cette partie replace la mondialisation dans la longue durée : des grandes découvertes aux logiques actuelles du capitalisme financier globalisé, en passant par les empires coloniaux. Elle explore les logiques de domination, d’interconnexion, de hiérarchisation du monde.
2. Le nouveau système productif mondial
On y trouve une analyse des réseaux de production, d’échanges et de services, ainsi que des transformations liées au numérique, à l’automatisation, et à la montée des puissances asiatiques. Une attention particulière est portée aux recompositions industrielles post-pandémiques, aux stratégies de “découplage” ou de “relocalisation”, et à la place croissante de la logistique mondiale.
3. Les territoires dans la mondialisation
Cette partie aborde la diversité des situations territoriales à l’échelle mondiale. Elle met en évidence les contrastes entre pôles majeurs, périphéries dynamiques ou marginalisées, villes-mondes, zones franches, corridors logistiques, mais aussi les dynamiques de fragmentation socio-spatiale, les fractures urbaines, les inégalités d’accès à la connectivité.
4. Les enjeux d’avenir en débat
Cette dernière section ouvre une réflexion sur les débats contemporains : transition énergétique, développement durable, migrations, crise climatique, gouvernance mondiale, montée des populismes, démocratie vs autoritarisme… Elle invite à une lecture critique et citoyenne de la mondialisation, à rebours des simplifications médiatiques.
Des documents d’une grande richesse
L’un des points forts de cet atlas est la qualité de son appareil documentaire : plus de 120 cartes, graphiques, infographies et schémas. Ils offrent une lecture claire et structurée, directement exploitable en classe.
Les cartes sont précises, parlantes et pédagogiques, idéales pour illustrer les cours du collège (4ᵉ-3ᵉ) et du lycée, en tronc commun comme en spécialité HGGSP.
Le travail cartographique est mis à jour pour intégrer les données les plus récentes, notamment :
• la guerre en Ukraine et ses conséquences sur les flux énergétiques,
• les reconfigurations industrielles post-Covid,
• les fractures numériques,
• les tensions sino-américaines et leurs implications géostratégiques,
• les nouveaux corridors de transport (Belt and Road Initiative, routes maritimes arctiques).
L’ouvrage se termine par une conclusion ouverte, qui rappelle la nécessité d’un enseignement critique de la mondialisation, pour comprendre la complexité du monde et outiller les jeunes face aux grands défis du XXIe siècle.
Enfin, une bibliographie et une sitographie fournissent des pistes fiables pour approfondir, idéales pour les enseignants en formation, les préparations de cours ou les activités pédagogiques.
En conclusion : un outil indispensable pour les enseignants
Cette 3e édition actualisée de l’Atlas de la mondialisation de Laurent Carroué est une ressource incontournable pour les professeurs d’histoire-géographie. À la fois synthétique, rigoureux, engagé et pédagogique, il permet de nourrir les cours sur les espaces productifs, les dynamiques géographiques, les relations internationales, ou les problématiques environnementales.
Il s’agit d’un outil de référence pour :
• enseigner les grands thèmes du programme (en collège et lycée),
• préparer des études de cas ou des croquis,
• accompagner les élèves vers une lecture structurée et critique de l’actualité,
• enrichir les démarches en HGGSP, en EMC ou en géographie prospective.