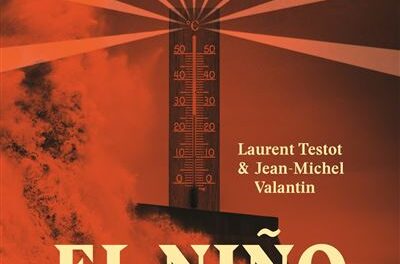La pop culture a introduit le nucléaire dans notre quotidien en le dépeignant comme une technologie exceptionnelle et le paroxysme de la géopolitique. Le mot de nucléaire désigne toutes les technologies utilisant les propriétés de la radioactivité.
Cette dernière est un phénomène naturel mesurable grâce à des instruments. Mais, pour désigner la production d’objets nucléaires comme une production sociale, faite de négociations, de controverses et de frictions entre acteurs, l’historienne et sociologue américaine Gabrielle Hecht propose le concept de “nucléarité”.
C’est autour de ce concept, forcément mouvant et changeant d’une période à l’autre et d’un lieu à l’autre, que Teva Meyer axe sa réflexion. Plus précisément deux questions guident sa réflexion : quels lieux, quelles pratiques, quels artefacts de la chaîne du nucléaire sont l’objets de conflits ? Comment certains acteurs entretiennent l’exceptionnalité du nucléaire pour assouvir des buts géopolitiques ? Pour y répondre, Teva Meyer prend le parti de croiser les filières militaires et civiles du nucléaire et d’organiser sa réflexion autour des différentes étapes de production et d’utilisation.
Teva Meyer est maître de conférence en géographie et géopolitique à l’Université de Haute-Alsace et docteur de l’Institut Français de Géopolitique (Université Paris 8). Chercheur au laboratoire CRESAT et chercheur associé à l’IRIS, il travaille sur les dimensions politiques des relations entre le nucléaire et l’espace.
L’uranium, matière à teneur géopolitique ?
Dans cette première partie, Teva Meyer s’intéresse aux dynamiques géopolitiques pesant sur les approvisionnements en uranium. Il note d’abord que la géopolitique du nucléaire se nourrit d’imaginaires autour de l’atome. En effet, ce dernier serait issu d’une technologie nécessitant des quantités dérisoires de combustibles faciles à transporter. Il s’affranchirait donc de la géographie des ressources et “permettrait à l’Homme de se développer sans contrainte naturelle, de coloniser les derniers espaces résistant à sa présence et de reconfigurer la géographie à sa volonté”.
De plus, le marché de l’uranium est souvent présenté comme immunisé contre les risques stratégiques. En effet, contrairement aux hydrocarbures, les ressources sont présentes dans 53 pays dont 19 membres de l’OCDE (qui totalisent 40% des gisement), donc plus stables et démocratiques. Mais, la géographie de l’aluminium s’est concentrée : seuls 15 pays produisent de l’uranium dont 45% proviennent du seul Kazakhstan. De plus, 10 mines fournissent à elles seules la moitié de la matière quand une quinzaine d’entreprises sont responsables de 95% des extractions (pour beaucoup des entreprises à capitaux publics). Cette concentration s’explique par les dynamiques du marché dirigeant l’intérêt vers des territoires à faible coût et où les règles environnementales sont plus laxistes. Cependant, dans ce contexte, il n’est pas possible à un pays exportateur d’uranium d’utiliser la menace d’une rupture d’approvisionnement comme mesure coercitive. Mais, son commerce peut permettre de renforcer les liens diplomatiques d’un pays (comme l’Australie avec l’Inde, par exemple) ou contribuer au soft power d’un Etat en lui donnant l’image d’une puissance responsable luttant contre la prolifération nucléaire (Australie) ou d’un partenaire fiable capable de gérer une industrie complexe (Kazakhstan). La présence d’uranium peut aussi servir à élaborer des projets nationaux : c’est le cas au Groenland où ce minerai se mêle aux discours sur la souveraineté de l’île. Teva Meyer s’interroge aussi sur la vulnérabilité géopolitiques des mines d’uranium. Hormis au Niger, il la juge limitée de même que l’éventualité d’un vol d’uranium à des fins militaires.
Dans un dernier temps, l’auteur s’interroge sur les stratégies des nations nucléarisées pour s’approvisionner en uranium naturel. En effet, sur les 34 pays exploitant un parc de centrales, 8 seulement (Brésil, Canada, Chine, Inde, Pakistan, Russie, Afrique du Sud et Etats-Unis) produisent de l’uranium. Ainsi, la Chine (3ème consommateur mondial d’uranium avec un déficit commercial de 75%) a institué dans les années 1990 la stratégie des “Trois Tiers”. Son but est d’assurer son approvisionnement grâce à sa production domestique, au contrôle des mines à l’étranger et au recours au marché. Mais, la production domestique chinoise reste limitée. Le gouvernement chinois encourage donc son entreprise publique China National Nuclear Corporation (CNNC) à acquérir des parts dans des mines à l’étranger, surtout en Afrique. De son côté, les ressources de la Russie ne répondent ni aux besoins de son parc de centrale ni aux contrats d’exportation de combustibles nucléaires signés. Théoriquement, les ressources de la Russie sont importantes mais le minerai y est de faible qualité et situés dans des espaces difficiles d’accès aussi bien géographiquement que géologiquement. C’est pourquoi, depuis la chute du mur de Berlin, Moscou poursuit une politique d’expansion minière à l’étranger, vers le Kazakhstan d’abord et de plus en plus vers l’Afrique. Les Etats-Unis ont vu un effondrement de leur puissance uranifère les laissant dépendants du marché international. L’Europe depuis la signature d’Euratom en 1957 s’est dotée d’une agence d’approvisionnement (ESA) qui dispose en théorie du droit exclusif de conclure des contrats de fourniture en uranium des exploitants de centrale nucléaire dans l’UE. Mais, en réalité, les ressources de cette agence ne lui permettent pas de peser sur les négociations ni de rivaliser avec les industriels qui au final répercutent les stratégies nationales et non une stratégie européenne commune. Enfin, Teva Meyer se pose la question de la sécurisation des routes de l’uranium. En effet, une fois extrait des mines, l’uranium est raffiné en “yellowcake” avant d’être transporté sur des milliers de kilomètres pour y subir les transformations suivantes. Contrairement aux hydrocarbures, les routes de l’uranium sont plus difficiles à identifier car les mines ne sont pas proches des ports (maritimes, routiers ou ferroviaires) et les ports autorisés à manipuler des matières nucléaires sont limités. Ainsi, l’uranium n’est pas une ressource dépourvue de tensions géopolitiques ce qui pousse certains Etats (comme l’Inde) à développer de nouvelles technologies de réacteurs, nommés “surgénérateurs”, pouvant fonctionner sans minerai d’uranium en réutilisant des déchets de la production du combustible nucléaire.
Transformer la matière fissile : (in)dépendance géopolitique
Dans cette deuxième partie, Teva Meyer s’intéresse d’abord à la question de l’enrichissement de l’uranium, qui est une technologie duale permettant aussi bien des applications civiles que militaires. Il qualifie cette étape de “noeud gordien” de la géopolitique du nucléaire. L’auteur note dans un premier temps qu’on peut produire de l’énergie dans des centrales utilisant de l’uranium “naturel” non enrichi (c’est le cas au Canada, Roumanie, Inde et Argentine) mais que 90% des centrales en fonction utilisent de l’uranium enrichi. Ce choix résulte d’enjeux économiques et de raisonnements géopolitiques. Pour les centrales ayant choisi l’uranium enrichi, les chemins que le minerai prend depuis la mine sont nombreux et complexes, multipliant les acteurs intermédiaires. En effet, après la production de “yellowcake”, il faut convertir l’uranium dans une forme purifiée, ce qu’est capable de faire seulement 11 usines dans le monde. Dans ce domaine, seuls 5 Etats (France, Chine, Canada, Russie, Etats-Unis) fournissent des services de conversion à l’échelle mondiale. Concernant l’enrichissement, 12 pays font cette opération. Mais, le marché de l’enrichissement est essentiellement tenu par le russe Rosatom, le français Orano, les filiales européenne et américaine d’Urenco. Dans ce marché balançant entre intérêts stratégiques et libéralisme économique, la place grandissante prise par la Russie (36% de l’enrichissement mondial) inquiète. Elle la doit à sa primauté technologique sur l’enrichissement par centrifugation qui consomme 90% moins d’électricité que celui par diffusion gazeuse. Elle en tire donc des faibles coûts d’exploitation. Elle est aussi liée au volontarisme politique de Moscou qui lie la vente de ses réacteurs nucléaires à des contrats d’approvisionnement en combustible. C’’est d’ailleurs le déploiement de la centrifugation qui a facilité la prolifération horizontale, c’est-à-dire l’acquisition d’armement atomique par des pays non dotés. Les 20 usines d’enrichissement dans le monde sont donc des espaces cruciaux de la lutte contre la prolifération : elles sont le centre d’attention des services de renseignement et sont l’objet des négociations internationales pour assurer un droit de regard aux inspecteurs de l’AIEA. Afin d’éviter la prolifération, des projets d’internationalisation de l’uranium enrichi ont été proposés comme l’ouverture d’une usine appartenant entièrement à l’AIEA, la mutualisation régionale des capacités rassemblant plusieurs pays investisseurs (sur le modèle de l’Urenco) ou l’exportation d’usines à centrifugation sous le modèle de la boîte noire (le pays ne contrôle pas l’usine mais récupère l’uranium enrichi).
La dernière étape (assemblage de l’uranium dans des combustibles sous forme de pastilles empilées dans des tubes) peut sembler l’étape la plus a-géopolitique. En effet, elle est la plus déconcentrée avec une trentaine d’usines réparties dans 19 pays. Mais, la situation est plus complexe avec de fortes dépendances technologiques et géopolitiques. Ainsi, changer de fournisseur est compliqué car chaque combustible est spécifiquement conçu pour le réacteur qui va l’utiliser et chaque changement nécessite de faire autoriser le nouveau combustible par des organismes de sûreté nucléaire nationaux ou supranationaux (ce qui veut dire plusieurs années de test…). Sans compter que pour certaines centrales les constructeurs ont signé des contrats de fourniture pour l’ensemble de leur durée de vie. Les craintes de dépendance sont particulièrement fortes sur les réacteurs de technologie russe (les VVER) présents dans des pays de l’ancien bloc communiste mais aussi en Chine, Turquie et Bangladesh. Teva Meyer met aussi en avant que les combustibles nucléaires ont aussi besoin de zirconium et de niobium. Or, dans les deux cas, la production est fortement concentrée : Australie et Afrique du Sud pour le zirconium et Brésil pour le niobium.
L’auteur s’intéresse ensuite au lien qui est fait dans les débats en France entre énergie nucléaire et indépendance (ou sécurité) énergétique. Il met en avant d’abord que le concept d’indépendance énergétique n’a pas de définition géographique ou géopolitique : ce sont des catégories changeantes que les acteurs mobilisent dans les discours pour comparer, confronter ou soutenir des sources d’énergie. En comparant les discours autour du nucléaire et de l’indépendance énergétique en France et en Allemagne, Teva Meyer conclue que l’association des deux termes n’est pas naturelle. Elle est la construction issue de contextes historiques et de représentations spatiales structurant les systèmes énergétiques de chaque pays.
L’auteur termine cette partie en s’intéressant à la question de la géopolitique de la gestion des “déchets” nucléaires, notamment celle des combustibles usés. C’est le cas entre autres du plutonium issu des combustibles usés qui peut servir à la production d’un engin nucléaire. Les débats portent alors sur sa faisabilité mais à l’heure actuelle aucun pays ne s’est nucléarisé militairement en détournant des matières extraites de combustibles commerciaux. Les pays ayant suivi la voie du plutonium pour proliférer l’ont fait en utilisant des réacteurs dédiés, souvent sous couvert de travaux scientifiques, et grâce aux transferts technologiques : c’est le cas en Inde, en Corée du Nord ou en Iran. De plus, seuls 5 pays (France, Japon, Russie, Chine et Inde) poursuivent des politiques de retraitement à vocation commerciale. Mais, le processus d’extraction du plutonium peut se faire à plus petites échelles. C’est pourquoi les réacteurs plutonigènes comme les sites de retraitement sont des points-clés des négociations contre la prolifération. Face au risque de prolifération se pose très tôt la question de l’internationalisation du traitement des déchets. Ainsi, au-delà de trouver des espaces sans souveraineté pour les stocker et se débarrasser de matières politiquement encombrantes, deux modalités de gestion internationalisée sont discutées. La première propose de de centraliser les matières dans un pays équipé d’infrastructures sur la base d’accords bilatéraux. La deuxième solution mise sur la construction ad hoc de sites sous contrôle international. Mais, les nombreuses initiatives ont échoué pour des raisons politiques (sensibilité politique autour de déchets dont la quasi-totalité des pays a interdit l’importation) et géopolitiques (la dépendance à la Russie qui est le seul Etat à soutenir ces solutions). Teva Meyer conclue cette partie en évoquant la situation des frontières qui ont pu être utilisées pour stocker des déchets nucléaires, ce qui n’est pas sans susciter des tensions diplomatiques.
Les centrales nucléaires, de petites ambassades à l’étranger ?
Teva Meyer débute sa 3ème partie en mettant en avant que les centrales nucléaires sont l’exemple parfait du “géo-symbole”, ce lieu qui exprime, au travers de ses représentations et de ses usages, un imaginaire collectif : elles sont l’incarnation physique et allégorique de la puissance et servent d’outil de projection du pouvoir à l’étranger. De ce point de vue, l’utilisation diplomatique des exportations de centrales n’a rien de neuf. Longtemps hérité de la Guerre froide, la géographie industrielle du nucléaire se reconfigure. Même si l’extension spatiale du nucléaire reste timide, le nombre de pays s’intéressant à l’énergie nucléaire augmente et s’étend à des régions peu nucléarisées comme l’Afrique, le Moyen-Orient ou l’Asie du Sud-Est. Ce qui suscite l’appétit économique et géopolitique des exportateurs nucléaires. En effet, à l’instar du marché de l’armement, la vente de réacteurs est un petit marché : les exportations sont donc une question de survie pour un pays disposant de sa propre filière. C’est pourquoi les gouvernements s’impliquent fortement dans les négociations commerciales. Ainsi, la France dispose d’un réseau de conseillers nucléaires présents dans 11 de ses ambassades dont l’objectif est de mettre en action la politique de non-prolifération mais aussi d’apporter un soutien logistique à l’industrie nucléaire française dans la compétition internationale. De plus, ces ventes sont une affaire de prestige qui montre qu’un pays exportateur de technologie nucléaire a atteint un niveau de technicité élevée et une fiabilité. Mais, la force géopolitique des exportations nucléaires réside surtout dans leur temporalité car la dépendance entre un exportateur et le pays d’accueil peut s’étendre sur un siècle. Dans cette optique, la réorganisation du leader mondial de l’industrie électronucléaire Rosatom en 2007 par Vladimir Poutine s’est faite avec la conquête de marchés internationaux en ligne de mire. Son succès à l’étranger repose en grande partie sur la vitalité de son marché intérieur qui lui sert de vitrine, sur sa capacité à reprendre les déchets nucléaires et dans les modes de financement qu’elle offre. De son côté, le secteur électronucléaire chinois est fortement divisé. Pourtant, le gouvernement chinois a fait du nucléaire un des axes principaux de sa diplomatie technologique : il espère profiter de la Belt and Road Initiative pour convaincre une quarantaine de pays d’acheter ses produits en offrant des financements spécifiques. La fin des années 2000 marque une prise de conscience géopolitique des risques que poserait une domination sino-russe sur la filière nucléaire. Ainsi, en France, la réorganisation du secteur lancée par Nicolas Sarkozy aboutit à la division de l’entreprise AREVA entre un groupe dédié au combustible (Orano) et un autre à la construction de centrales (Framatome) dont EDF devient l’actionnaire majoritaire. A noter que la faillite des ingénieristes américains (comme Westinghouse en 2017) ne signifie pas une perte de contrôle totale des Etats-Unis sur le marché nucléaire. En effet, par le système des brevets de propriété intellectuelle, ils continuent à avoir un droit de regard dans le cas où la nationalisation du réacteur est incomplète. C’est le cas par exemple du réacteur que l’entreprise sud-coréenne KEPCO a vendu aux Emirats arabes unis.
Dans un deuxième temps, Teva Meyer s’intéresse aux centrales nucléaires comme objets de conflits et de coopération entre Etats. Il note d’abord qu’une centaine de réacteurs aujourd’hui sont implantés à moins de 100 km d’une frontière internationale car ces dernières offrent des opportunités techniques (les rivières frontalières répondent aux besoins d’eau pour refroidir les centrales), économiques (mise en commun des moyens financiers et possibilité de vendre de l’électricité sur plusieurs marchés) et politiques (rapprochement des pays). Mais, cette implantation frontalière peut être source de contestations en favorisant le rapprochement de mouvements antinucléaires associatifs de différents pays (comme autour de la centrale de Fessenheim). Elle peut aussi aboutir à des conflits entre les Etats comme avec la centrale d’Ostrovets au Bélarus, située à 20 km de la frontière lituanienne. Mais, malgré toutes les mesures diplomatiques, légales et techniques prises par le gouvernement lituanien, celui-ci n’a pas pu empêcher la construction de la centrale car aucun mécanisme légal contraignant permet à un Etat d’empêcher la construction d’une centrale sur le territoire d’un voisin, quelle que soit sa proximité. Cependant, les sites nucléaires constituent aussi des objets fondamentaux dans le déploiement des diplomaties scientifiques, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques par lesquelles un pays assure la défense de ses intérêts grâce au développement et à la promotion de la recherche. Ce maillon essentiel du soft power peut se diviser en trois types de pratique :
- La diplomatie pour la science qui sont les efforts d’un gouvernement pour promouvoir sa communauté de chercheurs à l’international, en s’appuyant sur la signature d’accords de coopération. Elle permet aussi d’assurer le rayonnement de ses laboratoires et d’attirer des chercheurs étrangers. Ces accords sont nombreux dans le nucléaire.
- La science en diplomatie est l’utilisation de l’expertise scientifique afin d’atteindre des buts géopolitiques. C’est un des objets du volet nucléaire du programme de financement de la recherche de l’UE Horizon 2020.
- La science pour la diplomatie est l’utilisation des coopérations scientifiques pour construire ou améliorer des relations entre Etats. C’est le cas de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ayant pour but de construire un accélérateur de particules ou du projet de réacteur de recherche expérimentale à fusion ITER.
L’auteur axe ensuite sa réflexion autour des SMR, ces petits réacteurs modulaires qui seraient un gage du renouveau nucléaire. Il note d’abord que derrière cet acronyme se cache une diversité de modèles et de techniques différentes. De plus, les SMR ne sont pas une nouveauté et n’ont pas fait émerger de nouveaux pays (hormis quelques start-up scandinaves) venant troubler les rapports de force dans le monde du nucléaire. Aujourd’hui, on leur assigne le rôle de conquérir de nouveaux espaces par et pour le nucléaire. Ils apparaissent comme une réponse pour ouvrir de nouveaux territoires au nucléaire, notamment les pays en développement d’Afrique et du Moyen-Orient. Ils ont aussi vocation à ouvrir de nouveaux espaces par le nucléaire comme l’Arctique, la Sibérie ou les régions à fort stress hydrique (en fournissant de la chaleur et de l’énergie pour des usines de désalinisation) mais aussi à plus long terme l’espace. Mais, à plus court terme, c’est au sein des armées que l’utilisation des SMR trouveront une application. Ainsi, les Etats-Unis pourraient rendre opérationnel en 2024 un microréacteur afin d’alimenter leurs bases militaires par le nucléaire.
Teva Meyer conclue cette partie en rappelant que les sites nucléaires en temps de conflit sont des cibles potentielles tant par leur attribut symbolique que matériel. Il note d’abord qu’il existe des textes et de conventions qui interdisent de s’en prendre aux sites nucléaires, mais leur application est limitée par les marges d’interprétation qu’ils introduisent. De plus, certes s’emparer d’une centrale nucléaire est une arme rhétorique alimentant une politique de dissuasion par procuration, mais ce qui fait sa valeur c’est surtout le nœud logistique qu’elle constitue autour d’elle et la possibilité d’avoir la main sur une part de l’électricité du pays et non sa qualité “nucléaire”. Quant aux actes terroristes, 23 attentats contre des centrales ont été recensés quasiment tous avant 1986 et pour la plupart durant la construction desdites centrales. Ils s’inscrivent dans les luttes des mouvements indépendantistes qui voient les centrales comme la matérialisation du pouvoir de l’Etat central ou comme des symboles du capitalisme. Les actions violentes de groupes environnementalistes contre les centrales restent marginales. L’auteur termine en évoquant les risques de cyberattaques : la vulnérabilité des centrales a augmenté à mesure que leur exploitation s’est numérisée. Ces cyberattaques visent parfois un simple vol d’informations, de données personnelles des salariés ou des éléments techniques pour obtenir une rançon de l’exploitant. Elles peuvent aussi servir à l’espionnage industriel. Mais, la principale crainte réside dans des attaques visant à saisir ou endommager les systèmes de contrôle des centrales.
Faire et défaire un armement nucléaire
Teva Meyer note d’abord que 9 pays (Etats-Unis, Russie, Royaume-Uni, France, Chine, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord) ont des armes nucléaires. Le nombre de ces dernières diminue mais cette réduction stagne. Concernant les motivations d’obtenir l’arme nucléaire, il n’y a pas de facteurs explicatifs uniques. Mais, on peut distinguer trois grandes familles d’explications :
- Le modèle sécuritaire : un Etat chercherait à se doter de l’arme nucléaire après avoir fait face à une menace sécuritaire significative en l’absence d’alliance militaire. En cas de disparition de la menace, on peut aller vers une stratégie de dénucléarisation comme l’Afrique du Sud. De cette approche nait la théorie des “dominos” où la nucléarisation d’un pays entrainerait ses voisins dans une course à l’armement régionale.
- Le modèle normatif : un acteur cherche à obtenir la bombe en fonction des valeurs symboliques qu’il lui associe (comme par exemple un statut de puissance).
- Le modèle domestique s’intéresse aux jeux d’acteurs ainsi qu’au rapport de force entre opposants et partisans de la bombe. Le soutien à la bombe peut alors servir des objectifs politiques internes loin des préoccupations sécuritaires. Il met en avant l’influence de certains groupes d’acteurs comme les scientifiques, les bureaucrates ou les industriels du secteur.
Quatre chemins d’appropriation de la bombe s’offrent à un pays proliférant : développer sa technologie entièrement seul, développer sa technologie en collaboration, acquérir des technologies sur le marché ou passer par le marché noir. Tous les pays ont mixé au moins deux de ces chemins. Les recherches montrent que le déploiement du nucléaire civil est rarement un déclencheur du nucléaire militaire. Cependant l’émergence d’un marché libéralisé du nucléaire tend à augmenter le risque de prolifération. Le politiste américain Vipin Narang divise les Etats proliférants en 4 groupes :
- les hedgers ont développé la bombe mais ne l’ont pas encore réalisée (Iran, Japon)
- Les sprinters visent au développement le plus rapide même visible
- Les hiders veulent acquérir la bombe en secret
- Les sheltered profitent de la protection d’une puissance nucléarisée pour acquérir la bombe (Israël, Pakistan)
L’obtention de la bombe pose la question de la dissuasion qui est une stratégie ayant pour but de décourager l’adversaire d’une initiative en lui montrant les conséquences auxquelles il s’expose. Mais, la dissuasion est avant tout un exercice d’équilibre dans l’information diffusée et surtout sur les modalités de son emploi (quel espace protégé ? Quelles cibles potentielles ? Quelles distances d’emploi? …) Quant à la question de l’efficacité de la dissuasion nucléaire, la réponse est difficile car elle dépend toujours de la lecture spatiale que font les analystes des conflits et de leur envergure.
Dans un deuxième temps, Teva Meyer s’intéresse à la lutte contre la prolifération. Il note d’abord que les mesures prises sont de logique géographique. En effet, elles reposent sur 4 piliers intriqués : le Traité de non-prolifération des armes nucléaires (TNP) entré en vigueur en 1970, le travail de surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), la constitution de zones libres d’armes nucléaires à l’échelle régionale et un ensemble d’accords régissant le transfert de matières et de technologies sur le marché global du nucléaire. Ces mesures divisent alors le monde entre pays autorisés à détenir l’arme ou non, contrôlent les flux de matière et de technologie et identifient les les lieux et les sites mis sous surveillance. Cependant le régime de non-prolifération a connu des ratés : il n’a pas empêché la nucléarisation du Pakistan et de la Corée du Nord ni le développement de programmes en Iran, en Syrie et en Irak. Ces ratés s’expliquent par les limites du régime de non-prolifération mais aussi par les failles ouvertes par la mondialisation permettant aux trafics illicites de fructifier.
L’auteur s’intéresse ensuite aux stratégies de modernisation des arsenaux nucléaire. Cette modernisation s’accompagne notamment d’une nouvelle course aux armements autour des armes hypersoniques capables de dépasser le Mach 5. La question aussi des systèmes antimissiles est relancée par les Etats-Unis, la Chine et la Russie avec comme corollaire la militarisation croissante de l’espace. Pour terminer, Teva Meyer analyse les héritages géopolitiques des essais nucléaires. Ces derniers ont toujours été réalisés dans des espaces considérés par l’Etat central comme des marges. Ils nourrissent aujourd’hui les mouvements indépendantistes et les demandes de réparation des populations concernées.
Mon avis
Ce livre met en avant que la géopolitique du nucléaire est d’abord une géopolitique des technologies dont les enjeux sont amplifiés par la libéralisation du marché et la globalisation. Ces éléments rendent le contrôle de la prolifération nucléaire plus compliqué dans un rapport de force aussi bien économique que stratégique. L’originalité de l’approche de Teva Meyer consistant à analyser en même temps le nucléaire civil et le nucléaire militaire rend cet ouvrage particulièrement intéressant.
Le livre est écrit dans un français très accessible et s’appuie sur des exemples précis et récents. De ce point de vue, quelques extraits peuvent être largement exploitables avec des élèves de 1ère et Terminale HGGSP (notamment sur la notion de puissance liée au nucléaire).