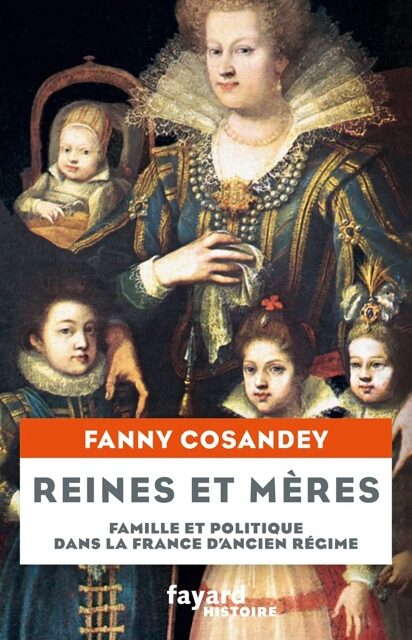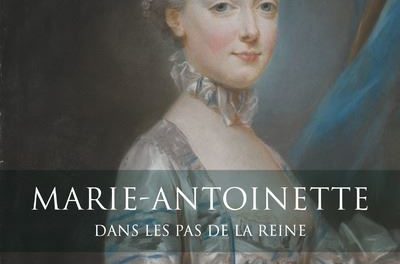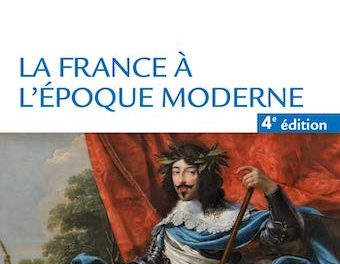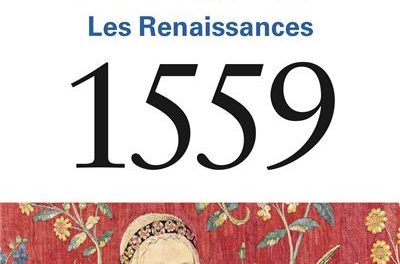Compte rendu réalisé par Léna Lebreton, étudiante en hypokhâgne (année 2024-2025) au Lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Née en 1967, Fanny Cosandey est une historienne spécialiste de la monarchie d’Ancien Régime et enseignante-chercheuse. En 1997, elle obtient un doctorat en histoire avec une thèse intitulée La reine de France, symbole et pouvoir : la place de la reine dans le système monarchique français, XVe siècle – XVIIIe siècle, sous la direction de Robert Descimon. Elle devient maître de conférences en histoire moderne à Nantes Université, puis à l’EHESS où elle est élue directrice d’études en 2018 sur une chaire nommée « Patrimoine et souveraineté. Anthropologie du régime monarchique ». Elle écrit de nombreux articles et livres, dont La reine de France, symbole et pouvoir (Gallimard, 2000) et Le rang. Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime (Gallimard, 2016) qui lui vaut d’obtenir, en 2017, le prix Eugène-Colas de l’Académie Française et le prix Thorlet de l’Académie des sciences morales et politiques.
Fanny Cosandey publie Reines et mères. Famille et politique dans la France d’Ancien Régime en 2022. Dans cet ouvrage, elle met en avant le rôle des femmes, mais surtout des reines dans la France d’Ancien Régime. Outre la pression qu’elles subissent pour perpétuer la dynastie royale, Fanny Cosandey explique les stratégies mises en place autour de leurs mariages, les relations qu’elles ont avec leurs enfants et le rôle central qu’elles jouent dans l’histoire de France. Ainsi, à travers une introduction, trois parties – elles-mêmes divisées en trois chapitres – et une conclusion, Fanny Cosandey offre le portrait de ces femmes dont l’histoire et l’importance sont souvent négligées au profit des hommes. À l’aide d’une riche bibliographie et d’annexes, l’autrice retrace les étapes qui transforment ces princesses en souveraines et mères, plongées au milieu des impératifs étatiques et des enjeux politiques.
Résumé
Fanny Cosandey introduit l’idée que l’histoire de France se rappelle ses femmes comme étant des mères avant tout. Leur notoriété se fait par le lien qu’elles entretiennent avec leurs enfants et par l’amour qu’elles leur portent. Les diverses facettes de la vie des femmes montrent qu’elles sont au service de leur pays, dont elles épousent la cause en même temps que le roi. Le croisement entre famille et État est donc perpétuel, et c’est précisément ce sur quoi Fanny Cosandey met l’accent. Elle rend compte de la complexité du milieu familial dans lequel évoluent ces reines devenues mères. Le cadre, par ailleurs, est à double échelle : il est européen pour ce qui est des alliances, il est français pour ce qui est de la vie quotidienne. Il s’agit donc de comprendre les fondements des mariages dessinant les ambitions monarchiques qui mettent alors en lumière une maternité soumise aux impératifs royaux.
La première partie, intitulée « Avant d’être mère », amorce l’idée que les femmes, dès l’enfance, sont promises au futur souverain. Jeunes, elles le rejoignent à la cour de France et leur vie est principalement consacrée à perpétuer la lignée royale : donner naissance est le point de départ et l’aboutissement du mariage des filles. Le premier chapitre, « Choisir une mère de roi », permet de discerner les stratagèmes mis en place afin d’établir les alliances les plus avantageuses. Il faut marier le roi à une femme de la haute noblesse étrangère, les aînées sont préférées aux cadettes et épouser une catholique est une nécessité. Tous ces critères réduisent drastiquement le choix des princesses pouvant être mariées, si bien que les époux sont, de près ou de loin, de la même famille. C’est le cas notamment de Louis XIV qui, en 1660, est marié à sa cousine Marie-Thérèse d’Autriche. Le mariage est donc avant tout politique : les femmes sont soumises à la décision de ceux qui organisent les alliances selon les meilleurs avantages possibles. Dans le deuxième chapitre, nommé « Marier les princesses », l’autrice montre que ces unions relèvent d’un fonctionnement dont l’objectif est de servir ses propres intérêts. Ainsi, de nombreuses négociations sont effectuées. D’un côté, les alliances permettent d’établir la paix grâce au soutien réciproque auquel elles s’engagent. De l’autre, elles la défont en raison des conflits créés par certaines alliances qui sont privilégiées au détriment des autres. Les mariages sont des paris sur l’avenir, renforcés par des alliances qui permettent de cumuler des droits sur un titre, une couronne et des territoires. Le troisième chapitre, intitulé « Préparer l’avenir », permet de comprendre le protocole mis en place autour du mariage. Le mariage est scellé avant tout par procuration et les promis ne se rencontrent pas avant la cérémonie officielle. Du côté des familles, des pourparlers sont effectués sur le terrain juridique pour régler l’acte de mariage. Ces négociations prennent du temps, comme c’est le cas pour celles des noces de Marie de Médicis et d’Henri IV, qui durent plus d’un an avant de trouver un compromis. Le contrat de mariage contient également, entre autres, la constitution de la suite de l’épouse, son arrivée au royaume et la signature du roi. Dès lors qu’elle quitte son pays natal, elle doit se consacrer tout entière à son nouveau rôle.
Ce rôle est développé dans la deuxième partie du livre, intitulée « Premières années ». La position de reine fait qu’on attend absolument d’elle un héritier. L’arrivée d’un enfant est son heure de gloire mais le chemin est parfois mortel. Les naissances, souvent rapprochées, sont difficiles et la mortalité infantile est élevée. La reine est au premier plan dès qu’il s’agit de produire des héritiers ; elle est au second plan lorsqu’il s’agit de les élever. Le quatrième chapitre, « L’attente d’un héritier », traite de l’arrivée de la future reine à la cour de France. Étant coupée de presque tous les liens qu’elle entretient avec sa famille et son pays natal, la rupture est souvent brusque. Tout ce qui peut rappeler à l’épouse son pays d’origine est éloigné afin de l’accoutumer aux us et coutumes français. À peine mariée, la première mission de la reine est de donner un héritier au roi. Les enfants sont des perspectives d’alliances et les mariages possibles sont réfléchis dès la grossesse annoncée. Le cinquième chapitre, nommé « Accouchements et nourrissons », aborde plus particulièrement les naissances. Beaucoup d’effets secondaires sont liés à la grossesse : fièvre, vomissements, épuisement… Les accouchements sont souvent une épreuve pour les mères. Dès sa naissance, le nourrisson entre dans la sphère politique et est le centre de l’attention. Une nourrice se charge de son alimentation, et la reine n’a déjà presque plus de contacts avec lui, ce qui peut créer des déséquilibres chez le bébé. C’est le cas de Marie-Anne, troisième enfant de Louis XIV et de Marie-Thérèse, qui meurt à trente-neuf jours après avoir connu trois nourrices consécutives. Dans le sixième chapitre, « Une mère distante », est développée la question de l’affection portée par la reine à ses enfants. Si les garçons sont plus attendus que les filles, qui partent très jeunes à l’étranger pour être mariées, ils ne sont pas mieux traités, et la fratrie grandit à l’écart de la cour. À partir du XVIIIe siècle, les enfants restent à Versailles, ce qui permet de favoriser les relations avec les souverains, notamment à une époque où la figure de la famille royale est importante. Malgré la distance, la souveraine s’assure que ses enfants grandissent dans de bonnes conditions. Mais même si elle veille à ce que ses enfants reçoivent une éducation complète, c’est la gouvernante qui fait office de mère.
Dans la dernière partie du livre, intitulée « Au cœur du pouvoir », l’accent est mis sur le rôle de la reine au sein de sa famille, de la cour et de la royauté. Elle intervient peu dans les affaires mais une unique situation le lui permet : lorsque le roi meurt et que le prince est encore trop jeune pour régner, elle devient régente et gouverne le royaume jusqu’à la majorité de son fils. Le septième chapitre, « Exercer la régence », explique cette situation d’exception. Le seul moment où une femme est au pouvoir est durant la période de régence. Les décisions sont prises au nom du roi : la reine agit par et pour son fils. À la majorité royale de ce dernier, la reine s’engage à quitter son poste. Elle conserve cependant une grande influence sur lui, car il a besoin de ses conseils, et souvent elle obtient un rôle important. C’est le cas de la mère de Louis XIII, qui est nommée Chef du Conseil dans cette optique. La régence marque avant tout une inversion de l’ordre traditionnel. Les hommes sont au second plan politique, la reine est proche de ses enfants, et le jeune roi exerce indirectement son pouvoir. Le huitième chapitre du livre, nommé « Vivre en famille », traite du quotidien de la famille royale. Elle est sans cesse au centre de l’attention et ne peut se soustraire à ses devoirs. Tous ses membres ont l’obligation d’apparaître en public, et ce même pour les femmes enceintes. Jusqu’au XVIIIe siècle, une grande retenue est exigée, installant une froideur et une distance entre les individus. Puis les appellations se font plus affectueuses, ce qui permet de resserrer les liens familiaux. Il est également intéressant de noter que les favorites des rois font partie du paysage monarchique en accompagnant le souverain et en éclipsant la reine. Marie de Médicis tente d’écarter les nombreuses maîtresses d’Henri IV en manifestant ouvertement son mécontentement, mais reste desservie par ces dernières qui deviennent ses rivales. Le dernier chapitre, intitulé « Transmettre l’héritage », éclaire ce qui suit la mort des reines. Trois moments décisifs sont distingués dans les déplacements des patrimoines. Le premier est le principe d’association mis en œuvre lors du mariage : le capital de la reine rejoint celui du roi. Le deuxième est que le fils accumule les héritages en récupérant ceux de ses parents. Enfin, le troisième est la transmission des droits successoraux, qui ne font pas l’objet d’un transfert immédiat. Ils sont très convoités et il faut réussir par tous les moyens à les rattacher à la couronne. La structure du pouvoir est construite sur des bases patrimoniales, enrichie grâce aux héritages, et entretenue par les stratégies de mariage pensées à long terme.
Fanny Cosandey conclut en écrivant que le comportement des reines envers leurs enfants est surtout politique. Si elles sont attentives à leur croissance, elles mènent une vie parallèle qui les maintient loin de leur progéniture. Écartée autant que possible du pouvoir, la reine trouve sa puissance dans la maternité, notamment lors des régences. La famille n’existe qu’au service de la couronne et reste indissociablement liée au pouvoir. Filles, épouses ou mères, les reines sont placées sous la tutelle d’hommes qui se réservent la pleine autorité. Le rôle majeur des femmes est de donner naissance et de transmettre des biens et des droits ; c’est la clé de la stabilité souveraine. La Révolution française ouvre certes aux femmes de nouveaux horizons, mais elles restent encore largement mises à l’écart de la vie politique.
Appréciations
Reines et mères. Famille et politique dans la France d’Ancien Régime est une œuvre qui met en lumière le rôle des femmes de l’histoire sans qui, justement, l’histoire n’aurait pu exister. Qui serait Louis XIII sans Marie de Médicis ? Qui serait Louis XV sans Marie-Adélaïde de Savoie ? Ces femmes, éclipsées par ceux qui ne seraient rien sans elles, sont les mères de la nation, celles qui façonnent le futur. Fanny Cosandey l’analyse très bien et son étude permet de comprendre et de mettre en avant leur destin qui, malgré le luxe de leur mode de vie, est plus complexe et difficile qu’il n’en a l’air. Sous la forme d’une dissertation, ce qui est tout à son honneur car ses propos n’en sont que plus clairs, l’autrice éclaire point par point, avec une précision et une justesse appréciées, la vie de ces princesses devenues reines puis mères. Réduites à des instruments de pouvoir et de richesse, perçues comme des moyens de reproduction pour étendre la lignée royale, ou encore prisonnières d’un mode de vie exigeant et superficiel, qui n’a a priori rien à leur apporter, la réalité du quotidien de ces femmes est mise à l’honneur. Fanny Cosandey, dans son œuvre, montre ainsi à quel point les marier devient une affaire d’État au sein de la monarchie. Sous l’emprise des hommes, elles ne cherchent en réalité qu’à s’émanciper. En leur dédiant ce livre, l’autrice leur donne la place centrale qu’elles méritent dans l’histoire. Son travail est minutieux, ses explications sont claires et son œuvre est accessible autant à un amateur d’histoire qu’à un spécialiste. De plus, l’abondance d’exemples et leur variété, qui traitent de l’ensemble de la période définie sans pour autant noyer le lecteur, ajoute à l’analyse une profondeur précieuse. Tant sur le fond que sur la forme, la lecture est agréable et complète, ce qui montre son intérêt historique particulier, ainsi que son utilité. La présence d’arbres généalogiques en annexe constitue un atout appréciable car elle facilite la compréhension de la chronologie et des exemples évoqués. On pourrait toutefois reprocher à l’autrice de souvent se répéter. Mais c’est, d’une manière ou d’une autre, une façon d’appuyer ses propos et d’articuler les parties entre elles, qui séparément sont dénuées de sens, car la vie des reines de l’Ancien Régime tourne sans cesse autour de ces nombreux points indissociables les uns des autres.