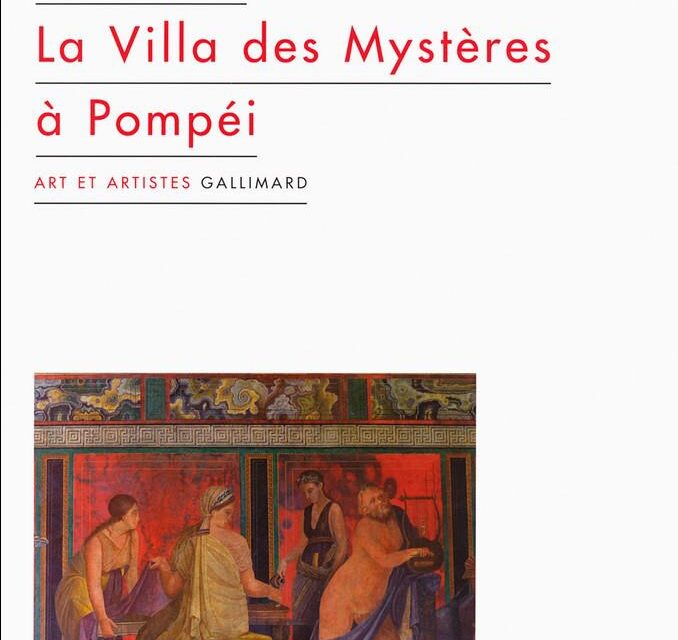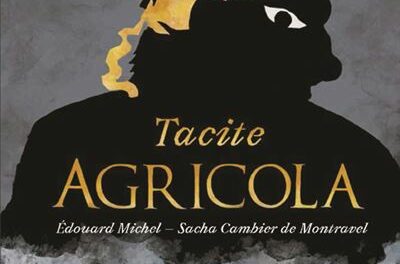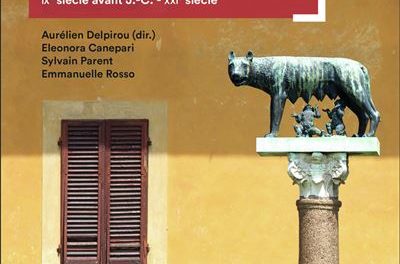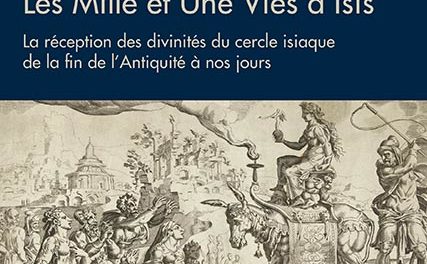Compte-rendu réalisé par Zélie Carreras, étudiante en hypokhâgne (2024-2025) au lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Paul Veyne est un historien, universitaire français spécialiste de la Rome antique, disparu en 2022. Depuis son enfance, il est fasciné par les antiquités grecques et romaines. Ancien élève de l’École normale supérieure, il est professeur honoraire du Collège de France de 1951 à 1955. Après avoir obtenu l’agrégation de grammaire, il devient élève à l’École française de Rome et soutient sa thèse en 1974 sur la pratique du don dans l’Empire romain. Publié en 1976, ce travail paraît sous le titre Le pain et le cirque. Il y reprend les vers du poète romain Juvénal et analyse la place centrale que jouent les dons dans les sociétés antiques. Auteur de nombreux ouvrages où il raconte l’histoire gréco-romaine à sa manière – Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? (1983), La Société romaine (1990) ou encore L’Empire gréco-romain (2005) –, il explique, dans Comment on écrit l’histoire (1971), sa démarche historique et la manière dont il organise son raisonnement.
Également sensible à l’art et à la peinture, il s’intéresse à la Villa des Mystère à Pompéi. Dans cet ouvrage, l’auteur expose son interprétation de la célèbre fresque datant du premier siècle avant notre ère. La plupart des historiens ayant analysé cette œuvre pensent qu’elle représente des mystères mystiques païens. Paul Veyne va à l’encontre de ces théories en exposant sa thèse selon laquelle cette fresque représenterait un jour de mariage profane avec la toilette de la mariée et la nuit de noces. Il expose cette théorie en 1998 dans un ouvrage collectif. Finalement, il publie le texte repris, modifié et définitif en 2016. L’ouvrage s’ouvre sur deux photographies, celle de la fresque de la villa des Mystères. Puis, celle d’un plan réalisé par l’auteur, ainsi que des chiffres romains numérotant les différentes scènes représentées. Dans chacun des chapitres comportant entre 3 à 7 sous-parties, l’auteur décrit en détail chaque scène de la fresque à l’aide d’illustrations d’œuvres artistiques gréco-romaines. Les références bibliographiques et iconographiques terminent l’ouvrage.
Résumé
Longue d’une vingtaine de mètres et haute de deux mètres, cette fresque s’étend sur tous les murs de la salle à manger, la plus grande salle de toute la maison, luxueuse et accueillante, dont le sol est orné de mosaïques. On retrouve sur cette fresque 29 figures de grande taille telles que des dames élégantes, des divinités, des musiciens, des Silènes et des satyres qui composent le cortège de Dionysos. Pas d’homme mortel, uniquement des femmes et un garçonnet qui apprend à lire. Toutes ces figures se partagent en douze occupations diverses et variées. Certaines sont des occupations précises mais d’autres restent plus mystérieuses pour le spectateur que l’auteur va tenter d’éclaircir. La grande question que pose cette fresque est celle de l’évènement qu’elle représente. Paul Veyne annonce que tout devrait s’éclaircir grâce à son rapprochement avec une peinture antique intitulée les Noces aldobrandines, une fresque découverte en 1601 chez le cardinal Aldobrandini à Rome, qui représente également une scène nuptiale avec une vision exclusivement féminine.
Dans le premier chapitre, l’auteur décrit le lieu, la parure de la mariée, le rang social de la famille, puis la mère de la mariée, dont le portrait est également présent. Il remarque tout d’abord que le lieu où se situent les personnages est celui d’un gynécée. Selon Paul Veyne, cette scène représente le matin des noces, scène banale et non-religieuse car aucune des figures représentées ne porte de couronnes. Il décrit ensuite avec précision la mariée, vêtue d’une robe de couleur vieil or et dont la dame d’honneur contrôle la toilette dans le reflet du miroir que le second amour (un petit ange) tient dans ses mains. Par la suite, Paul Veyne se penche sur la culture du rejeton, frère de la mariée, en train de lire, ce qui montre le rang social élevé de la famille. L’éducation du garçonnet montre l’attachement que porte cette famille à la culture et au monde des lettres selon Paul Veyne qui cite un sarcophage romain intitulé Scène de lecture (Ier siècle av J-C) sur lequel nous pouvons voir une gravure racontant la vie du défunt et l’importance de l’éducation et de la lecture au cours de sa vie, avec notamment la présence de deux livres gravés. Il démontre ainsi que cette scène ne possède aucun mysticisme, au contraire, elle démontre avec simplicité une scène d’enseignement des lettres. Dans le second chapitre, l’historien analyse la distribution du sésame durant le mariage, les couronnes de myrtes, le Silène musicien, la danseuse et la cantatrice. En effet, nous pouvons voir une servante tenant dans sa main droite un rameau de myrtes, une fleur représentant l’amour, le désir mais aussi le pouvoir dans la Grèce antique. Elle porte une couronne de myrtes sur la tête en l’honneur d’Aphrodite (déesse de l’amour). Dans sa main gauche, se trouve un plateau de galettes de sésame, toujours présent aux cérémonies nuptiales car elles sont un symbole de fertilité. Plusieurs arts sont représentés sur cette scène, dont le chant et la danse. La danseuse et la chanteuse sont deux figures importantes du cortège de Bacchus. L’un des satyres joue de la flûte de pan pour accompagner la danseuse. Cela prouve encore une fois qu’il s’agit d’un mariage puisqu’à cette époque les noces sont toujours représentées avec des musiciens et des danseuses.
Dans les deux chapitres suivants, Paul Veyne explique le lien qu’il avait déjà opéré auparavant dans l’introduction avec la fresque des Noces aldobrandines. Il commence par décrire la fresque : on y voit une jeune mariée et son époux, deux artistes et une cantatrice. Une vasque remplie d’eau pour le bain nuptial autour duquel plusieurs éléments sont réunis : une maîtresse de maison et la tablette du contrat de mariage. Une partie de cette fresque représente la peur et le désir autour de ce bain nuptial. En effet, sur le lit conjugal se trouve Vénus voulant convaincre la mariée que sa première nuit se passera bien. Dionysos est présent, il est assis à droite de la mariée et patiente. Ainsi, nous comprenons que la nuit de noces débute par une séance de persuasion de la vierge apeurée par l’arrivée de la nuit. Le bain nuptial est également présent sur notre fresque. En effet, trois femmes préparent ce bain nuptial, bain purificateur qui permet de retirer les impuretés dans le corps de la mariée une fois la semence déposée. Enfin, Paul Veyne précise que le bain après l’étreinte est une méthode contraceptive.
Dans les cinquième, sixième et septième chapitres, l’auteur nous éclaire sur la signification des Mystères, sur l’obscénité et sur le rôle de Dionysos dans cette fresque. Tout d’abord, les mystères sont une invention grecque, il s’agit d’une initiation durant laquelle l’initié s’approche d’un dieu, il subit un choc existentiel et accède ainsi à un secret. L’initié doit ensuite garder ce secret lui permettant d’avoir une meilleure vie dans l’au-delà. Sur la fresque, Paul Veyne remarque la présence d’une démone ailée et fouetteuse, présente pour interdire aux regards profanes d’avoir accès au mystère situé sous le van mystique, et nous précise la spiritualité des mystères. L’initiation au mystère transmet une idée de vie éternelle mais, pour autant, il ne s’agit pas de rites religieux. En effet, ces mystères sont inscrits dans le paganisme puisqu’il n’y a aucune angoisse de l’initié vis-à-vis de l’au-delà. Ensuite, il précise que ce van est en réalité l’illustration d’un phallus utilisé contre le mauvais œil. A Pompéi, nous retrouvons de nombreux phallus gravés dans les murs des ruines de la ville car les habitants étaient convaincus qu’ils les protégeraient de la malchance et feraient fuir le mauvais œil afin qu’il ne rentre pas dans leurs maisons. Sur notre fresque, la démone ailée peut aussi représenter le mauvais œil. Apeurée, elle s’enfuit et se détourne du van sous lequel se cache le phallus. D’ailleurs, l’effroi à la vue de ce van est bien visible sur le visage de la nurse, de la chanteuse et à la posture de l’initiée. En effet, la chanteuse pointe un thyrse en direction du van comme pour s’en protéger. Enfin, Veyne fait un bilan sur les mystères présents sur la fresque. Cette scène permet au peintre de souligner la peur de la défloration pour l’initiée. Enfin, la scène du vin et du masque clôt l’étude, sur laquelle nous pouvons voir un silène couronné de lierre. Il tend un bol à un jeune satyre et le second satyre tient un masque effrayant. Le silène qui boit dans le bol fait probablement référence à Dionysos. De plus, à droite de ce silène, Dionysos est présent, allongé sur les jambes de sa bien-aimée, Ariane.
Deux chapitres terminent l’ouvrage. Dans le premier, l’historien fait des généralités sur la représentation des hommes et des femmes dans la fresque. Tout d’abord, il remarque qu’il n’y a pas un seul homme, mis à part le dieu Bacchus, ce qui permet un mariage fondé sur l’amour dans le gynécée, véritable « royaume des femmes ». Elles créent ainsi leur monde de la féminité. Dans le chapitre suivant, Paul Veyne revient sur ce qu’en pensaient les contemporains. Il commence par le malentendu sur le bacchisme. A l’époque, Bacchus a ses fanatiques car il possède une personnalité charismatique : il est le héros d’une imagerie gigantesque, ni culturelle, ni pieuse, et il séduit le peuple qui l’affiche sur les fresques de leur demeure. Durant l’époque hellénistique, il y a une coexistence pacifique entre ceux qui croient et ce qui ne sont pas religieux. Pour les non-croyants, Bacchus était une simple métaphore du plaisir de la vie et pour les croyants, Bacchus existait vraiment. Dans notre fresque, la femme qui a commandé la fresque était croyante car on a retrouvé dans sa villa un petit bronze de Bacchus et de Vénus. Le peintre cache sur la fresque le phallus sous le van pour laisser paraître des images plus convenables. Les dieux vivent pour eux-mêmes tout en voulant du bien aux hommes et les hommes en font autant, tout en devant aux dieux le respect. Les hommes cherchent le bonheur et les dieux le possèdent. Sur notre fresque Bacchus est l’exemple d’une certaine forme de bonheur car les personnages imitent des rites païens lors de ce mariage, et « les hommes n’imitent jamais aussi bien les dieux que lorsqu’ils sont heureux ».
Appréciations
Le Villa des Mystères à Pompéi analyse et interprète de façon claire et détaillée les différentes scènes présentes de la fresque de la Villa des Mystères. Paul Veyne, à travers un raisonnement logique, réussit à expliquer clairement son point de vue en décrivant chaque scène avec des références artistiques variées. Cela est également possible par son écriture concise et facilement compréhensible avec l’utilisation d’un langage accessible à tous. D’ailleurs, l’utilisation d’un « on » collectif inclut davantage le lecteur dans le récit. D’autre part, il utilise de nombreuses illustrations à la fois de la fresque et d’autres œuvres d’art. Ses références artistiques très diversifiées entre sculptures, sarcophages, vases et tableaux nous permettent de visualiser et de comprendre facilement son interprétation. Cela nous donne même envie d’aller à Pompéi pour voir de nos propres yeux la fresque de la Villa des mystères. De plus, les titres de chaque chapitre et de chaque sous-partie sont très explicites et nous aident à suivre le cheminement de sa pensée. Grâce à tous ces éléments, sa thèse est correctement justifiée et sa théorie semble tout à fait plausible, si bien qu’on a l’impression qu’il a entièrement raison et que cette interprétation répond à toutes nos interrogations. Néanmoins, il serait intéressant de se renseigner sur les interprétations faites par d’autres historiens. Enfin, les deux derniers chapitres sont très utiles pour comprendre plus en détail sa vision des hommes sur la religion durant l’Antiquité, notamment la tolérance de chacun envers la religion des autres et des non-croyants. Pour conclure, cette étude historique de Paul Veyne a un apport très important car il est le seul à interpréter cette fresque de cette manière en restant proche des habitudes gréco-romaines et à travers son analyse, il nous éclaire sur la Rome et la Grèce antique d’une manière originale grâce à son approche artistique de l’histoire.