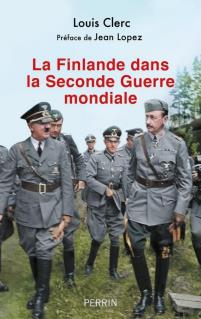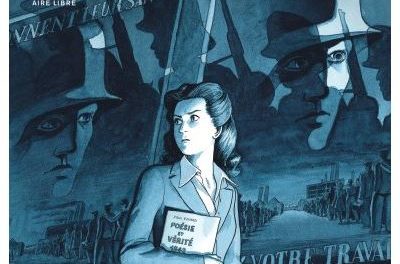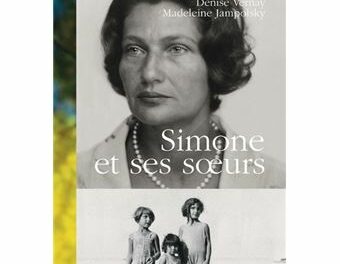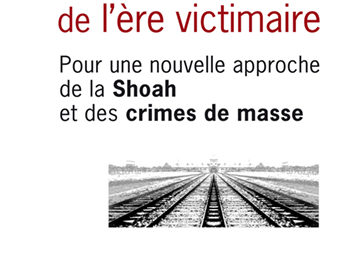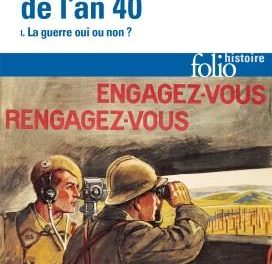Compte rendu réalisé par Salim Ait Aissa, étudiant d’hypokhâgne (2024-2025) au lycée Claude Monet de Paris, dans le cadre d’une initiation à la réflexion et à la recherche en histoire.
Présentation
Né en 1976, Louis Clerc est un historien français, professeur à l’université de Turku (Finlande) depuis 2007. Soutenue la même année à l’Université de Strasbourg, sa thèse s’intitule La Finlande dans la diplomatie française : représentations, forces organisationnelles et intérêt national dans les considérations finlandaises des diplomates et des militaires français (1918-1940). Spécialiste de la Finlande et de l’Europe du nord, il a publié entre autres La Finlande et l’Europe du Nord dans la diplomatie française. Relations bilatérales et intérêt national dans les considérations finlandaises et nordiques des diplomates et militaires français, 1917-1940 (2011). En 2017, il est décoré de l’Ordre des Palmes académiques en tant que chevalier.
La Finlande dans la Seconde Guerre mondiale a commencé à être écrit avant le début de l’agression russe en Ukraine en février 2022 d’après Jean Lopez, historien militaire, dans sa préface qui fait le parallèle entre la guerre que l’Ukraine vit actuellement et les conflits que la Finlande a traversés entre 1939 et 1944, l’ayant opposée à l’URSS. Il s’agit de deux pays relativement petits ayant vécu une histoire proche et douloureuse avec leur voisin russe. Il souligne de nombreux parallélismes entre ces affrontements qui sont aussi des événements inattendus mettant en en difficulté les belligérants. Aujourd’hui, la guerre en Ukraine résonne particulièrement en Finlande qui, compte tenu de son passé douloureux avec la Russie, a rejoint l’Otan en avril 2023, une décision qui met fin à une longue logique de neutralité à l’égard son voisin. Et cette logique qui a forgé la société finlandaise d’après-guerre, sa société, sa vie politique, sa culture ou son économie tient ses origines dans trois conflits que la Finlande a connus : la guerre d’Hiver de 1939 à 1940, la Guerre de Continuation de 1941 à 1943 face à l’URSS, puis la Guerre de Laponie face à l’Allemagne nazie en 1944.
Ce livre écrit par Louis Clerc nous introduit une histoire méconnue en Europe de l’Ouest, elle est expliquée sous l’angle des actions militaires, de la société finlandaise et des actions faites dans les couloirs du pouvoir avec l’intervention d’acteurs politiques et militaires majeurs qui ont su adopter diverses approches, des approches parfois irréalistes, d’autres très pragmatiques pour parvenir à un seul but : préserver l’indépendance et la démocratie du jeune État finlandais. Louis Clerc met en valeur la manière dont cette période est structurante dans l’évolution de l’État-nation Finlandais. Ce livre est enrichi de nombreuses sources historiographiques importantes et peu exploitées en Europe de l’Ouest de tous types, de témoignages d’anciens soldats aux archives nationales et internationales. Il bénéficie aussi d’une qualité d’écriture conséquente qui énonce des faits accompagnés d’exemples percutants et d’une démonstration qui permettent une compréhension très rapide de la situation. Le livre fournit aussi des cartes illustrant les changements territoriaux de la région, ainsi que des citations issues de propos formulés par des acteurs historiques et d’historiens en début de chaque chapitre.
Résumé
Le premier chapitre explore les années d’histoire politique, sociale et culturelle qui ont forgé la Finlande avant son indépendance de l’Empire russe le 17 décembre 1917 et celles qui ont suivi jusqu’au déclenchement de la première guerre par l’URSS le 30 novembre 1939. Elles permettent d’expliquer les actions opérées par les Finlandais durant les conflits qui les opposent avec les Soviétiques. La société finlandaise a, durant la période suédoise, été forgée par le protestantisme et un modèle de société scandinave libéral ouvert au dialogue entre les différentes couches sociales. En 1815, le pays devient un duché autonome russe qui poursuit un modèle étatique propre et peu influencé par la Russie autoritaire. Elle devient indépendante en 1917 mais tombe par la suite en guerre civile qui oppose les conservateurs, dits blancs dirigés notamment par Carl Mannerheim, premier et seul maréchal de Finlande, contre les communistes finlandais. Les conservateurs gagnent et le pays se stabilise très rapidement. Les Finlandais, en raison de leur passé et de leur mode de pensée scandinave, réussissent à dépasser leurs clivages politiques, le pays est dans l’ensemble conservateur avec des valeurs traditionnelles, profondément anticommuniste et aussi très germanophile. Il devient donc rapidement une démocratie, certes imparfaite mais stable avec comme premier président de la République, Kaarlo Juho Ståhlberg, tenant à préserver son indépendance et n’entendant pas se faire obéir par des acteurs extérieurs. Jusqu’en 1933, les rapports étaient décents mais peu chaleureux avec l’URSS, cependant l’arrivée d’Hitler n’ayant pas spécialement provoqué une euphorie particulière en Finlande, provoqua une méfiance de Staline qui craint une utilisation du pays par l’Allemagne pour l’attaquer. En 1938 et 1939, Staline propose des modifications de frontières, notamment celle de l’isthme de Carélie qui est proche de Léningrad, l’installation de bases militaires en Finlande et d’autres garanties sécuritaires. Ces propositions sont inacceptables pour le gouvernement finlandais qui campe sur ses positions, car accepter ces conditions reviendrait à remettre en cause une partie de la souveraineté nationale et surtout le principe de neutralité auquel les Finlandais sont très attachés. Finalement, l’obstination des Finlandais a poussé à bout les Soviétiques qui mettent fin à ces négociations et commencent l’invasion du pays le 30 novembre.
Le deuxième chapitre est une immersion dans la Guerre d’Hiver sur le terrain militaire et politique. Elle commence avec une annonce des attentes soviétiques sur l’issue de la guerre. Ces derniers pensaient opérer une guerre rapide dans laquelle ils atteindraient Helsinki en 2 semaines pour ensuite occuper le pays et changer son système politique. En tout, les hommes de Staline étaient 450 000. Cependant, la détermination des Finlandais à préserver leur indépendance accompagnée de plusieurs évènements succincts ont changé l’issue de cette première guerre. En effet, les Soviétiques comptaient sur une pression militaire suffisamment forte pour diviser politiquement le pays. Bien que modeste, l’armée finlandaise est efficace sur le terrain et défie une armée soviétique extrêmement mal préparée, devant conjuguer avec des températures très froides et une méconnaissance du terrain. Les Finlandais connaissent leur pays, avec des hommes soudés, se déplaçant rapidement, harcelant les soldats rouges, dirigés par des chefs souvent compétents comme le colonel Paavo Talvela et le lieutenant-colonel Aaro Pajari qui ont aidé à freiner une offensive soviétique en Carélie orientale. Les évolutions sur le terrain militaire ne sont pas en faveur de la Finlande mais sont un échec profond pour l’URSS qui peine à avancer sur l’isthme de Carélie et dans les pourtours du lac Ladoga. De plus, l’Armée rouge essuie des pertes terribles face aux proportions plutôt faibles des morts et blessés finlandais. Ce qui a précipité l’issue de cette guerre vers une paix signée est le pragmatisme nouveau des deux camps qui sont sous pression. La Finlande était déjà au bord de la rupture face à une situation militaire difficile et Staline était embarrassé par ce pays qui tient tête et qui met en lumière ses faiblesses. Ainsi, la paix est signée le 13 mars 1940, la Finlande cède les parties orientales de son territoire, doit évacuer 400 000 personnes et demeure frustrée, les envies de revanche surgissent immédiatement.
Le troisième chapitre illustre l’emportement de la Finlande dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l’Axe, une guerre dont elle ne veut pas. Cependant il est faux de dire qu’elle est une alliée des forces de l’Axe. En effet, Helsinki a toujours refusé d’officialiser une alliance claire avec l’Allemagne nazie. De ce fait, le pays, déjà considéré comme une périphérie de l’Europe, est souvent considéré comme un pays qui n’a combattu que contre l’URSS. Cependant, l’Allemagne pousse savamment les Finlandais à devenir dépendant d’elle en signant des accords économiques et sécuritaires. Une rhétorique nationaliste est aussi construite constituant en la création d’une « Grande Finlande » avec notamment la conquête de toute la Carélie, région considérée comme le berceau de la nation finlandaise. Cependant, le pays a gardé sa démocratie, n’a jamais épousé une politique fasciste et ne s’en est jamais pris volontairement aux Juifs pour satisfaire Hitler. En effet, la Finlande cherche à maintenir son indépendance sur le plus d’aspects possibles. D’un autre côté, Hitler ménage les Finlandais car, en plus d’avoir un avis correct sur ce pays et son peuple par rapport à d’autres pays comme la Hongrie ou la Roumanie, il considère qu’il est trop petit et peu stratégique pour le faire basculer dans le fascisme par la force. Finalement, face à une militarisation croissante et à des initiatives allemandes, l’URSS bombarde quelques sites, ce qui la pousse à la déclaration de guerre le 25 juin 1941. Elle envahit rapidement une grande partie de la Carélie soviétique et atteint son apogée territorial aisément.
Le quatrième chapitre explore les dynamiques de la société finlandaise de l’intérieur. Le pays souffre de pénuries et de disettes sans avoir cependant de grandes famines comme en Pologne ou en URSS, les campagnes sont plus épargnées que les villes davantage bombardées. Le pays a aussi fragilisé sa démocratie pour garder son unité en réduisant la liberté d’expression, la liberté des associations et en renforçant le pouvoir exécutif. Les mœurs aussi se libèrent, les soldats en permissions profitant pour vivre en secret les interdits moraux. Les bases d’un État providence sont posées, l’État accompagne les habitants les plus touchés par la guerre, médicalement et financièrement. La Finlande a aussi, à travers des accords de solidarité avec l’Allemagne, accueilli 220 000 de ses soldats essentiellement dans le nord du pays. Cette présence provoque une concurrence économique sur l’appropriation des ressources naturelles et humaines locales. Louis Clerc souligne aussi une face plus sombre de l’histoire finlandaise. Bien que le pays reste une démocratie attachée au règles juridiques et à un certain respect des droits individuels, il construit plusieurs camps d’internement au confort sommaire pour les prisonniers de guerre avec souvent un meilleur traitement pour les soldats d’origine finno-ougrienne. Une vision eugéniste et raciale s’installe avec l’objectif d’intégrer les territoires conquis. Pire encore, bien que sa population juive fût épargnée et combattit même au sein de son armée, la Finlande a cédé aux pressions allemandes pour renvoyer des juifs réfugiés, huit juifs périrent ainsi dans les camps de la mort en Pologne, l’expulsion annoncée par les médias fait l’objet d’un scandale national.
Le cinquième chapitre raconte le processus qui a mis fin à la guerre. Le pays était tiraillé par de nombreux acteurs étrangers, l’Allemagne incitait le pays à rester le plus longtemps possible en guerre contre l’URSS. Cette dernière, bien qu’elle ait renoncé à occuper l’entièreté du pays, fait pression sur lui pour qu’il dépose les armes sans conditions. Les Américains, Britanniques et Suédois poussaient un peu agacés à une solution diplomatique pouvant satisfaire les deux pays aux objectifs opposés mais la Finlande a refusé les multiples offres de paix proposées. Elle cherchait à gagner du temps en espérant que l’URSS soit dans une situation de faiblesse, la stratégie était très dangereuse car le pays était encore au bord de l’implosion face à la pression d’une Armée rouge renforcée. Le pays était divisé politiquement et l’opinion publique était partagée entre l’envie de continuer la guerre et de l’arrêter. L’une des autres variables était aussi la gestion d’une potentielle sortie de guerre ; l’Allemagne approvisionnait en grande partie la Finlande rendant impossible une sortie subite de l’engrenage militaire. Finalement, la raison l’emporte car le pays signe un cessez-le-feu en septembre 1944. Cependant, en contrepartie, il fallait expulser l’armée allemande sur son sol pour montrer à l’URSS encore méfiante qu’Helsinki n’était plus une menace pour elle. Ainsi, cette expulsion se concrétisa par la Guerre de Laponie jusqu’en avril 1945. Des villes comme Salla et Rovaniemi sont incendiées.
Le sixième chapitre raconte la sortie de la guerre et le commencement d’une longue période de paix qui a structuré le pays, ainsi que la pensée nationale et politique entre 1944 et 1948. La fin de la guerre est chaotique, le bilan total des trois guerres est de 96 000 morts et 200 000 blessées pour la Filande. Une paix est signée à Paris puis ratifiée avec l’URSS le 15 septembre 1947 qui a été dictée presque totalement par Moscou. Elle acte la perte de territoires importants comme la Carélie orientale, provoquant une blessure nationale, et l’installation de bases soviétiques sur le territoire national. La Finlande doit aussi payer une indemnité de 300 millions de dollars et accueillir 420 000 réfugiés venant des territoires perdus, réduire l’armée et les organisations à « caractères fascistes » sont dissoutes. En avril 1948 est signé le traité d’amitié finno-soviétique qui pose les bases de la relation entre les deux pays et qui interdit la Finlande de se rapprocher militairement des Occidentaux. Il met en place sa neutralité qu’on a appelé par la suite « finlandisation ». Le pays a mis partiellement en cause son indépendance policière et judiciaire en poursuivant les individus et groupes les plus hostiles à l’URSS. Louis Clerc souligne combien cette paix a marqué une nouvelle ère pour la Finlande. Sa trajectoire politique, sociale et culturelle a été modifiée, le pays agricole et conservateur s’est modernisé en devenant un pays moderne et avancé socialement. Les dettes envers l’URSS ont forcé la création d’un secteur industriel puissant et productiviste ; la Finlande payait le pays avec de nombreux produits manufacturés de bonne qualité et profitait aussi d’un gaz et pétrole soviétiques bon marché. Il était dans l’intérêt de l’URSS d’avoir un voisin stable et neutre qui servirait de tampon entre les mondes communiste et occidental pour maintenir la paix dans la région.
L’ultime chapitre montre les évolutions des mémoires de guerre du pays, jusque dans les années 2000. Au sortir de la guerre, la mémoire de guerre était très nationaliste et ne laissait aucune place à une remise en cause de la posture de la Finlande face à l’URSS. Cependant, pendant la Guerre froide, sous la présidence d’Urho Kekkonen, ayant ménagé son voisin durant ses cinq mandats, les discours se calment et se nuancent ; l’implication des communistes est davantage prise en compte dans l’effort de guerre finlandais. De manière générale, la mémoire de guerre finlandaise se porte sur les hommes ayant participé à la guerre, il y a de nombreux témoignages de soldats, de généraux et de volontaires. Durant les années 80, les travaux historiographiques s’élargissent à de nouveaux champs, de nouveaux sujets arrivent ou sont approfondis comme l’idée de la « Grande Finlande ». Ces mêmes travaux ont bénéficié de l’ouverture d’archives finlandaises et russes inédites. Aujourd’hui, la mémoire est dans l’ensemble patriotique avec un narratif qui érige la Finlande en héroïne en proie à un dangereux ennemi. De plus, malgré les connivences avec l’Allemagne et les quelques actions en sa faveur, les Finlandais se mettent généralement en marge des grands traumatismes et des responsabilités de la Seconde guerre mondiale comme la Shoah, tout en reconnaissant son existence.
Appréciations
L’auteur nous offre une exploration complète de l’histoire de la Finlande durant la Seconde Guerre mondiale, une histoire qui demeure peu connue pour nous en Europe de l’Ouest. En effet, l’habileté de Louis Clerc est de montrer les différents points de vue de cette série de conflits, en plus d’en détailler précisément les subtilités. On peut apprendre qu’il est incorrect de céder aux tentations d’ériger la Finlande en héroïne face à l’ogre soviétique car cela reviendrait à oublier les manœuvres les moins enviables de son histoire. L’un des autres grands enseignements est que la survie du pays fut le fruit d’une série d’actions politiques ambivalentes par différents hommes animés par des convictions très fortes et, dans la plupart des cas, par l’attachement à leur pays. Il n’est pas incorrect d’en déduire aussi que les Finlandais furent très chanceux dans leur sort, ils ont bénéficié d’un pays qui était peu stratégique, plutôt pauvre en ressources avec un climat rigoureux, ainsi ils purent éviter une fin probable de leur État. De plus, on comprend que les Finlandais sont un peuple uni qui dépasse les différents clivages pour parvenir à un seul but : la survie de leur pays et de leur liberté pour le plus longtemps possible. Enfin, l’ouvrage nous permet aussi de comprendre la posture politique que la Finlande tenait depuis la fin de la guerre froide, la neutralité militaire faisait partie de son mode de fonctionnement car elle était le meilleur moyen de survie, jusqu’en 2023 où les Finlandais tournent définitivement le dos à la Russie en rejoignant l’OTAN. Il s’agit de la preuve que même 78 ans après la signature du traité de Paris, les mémoires historiques et populaires restent très fortes et continuent d’influencer les décisions politiques d’aujourd’hui.