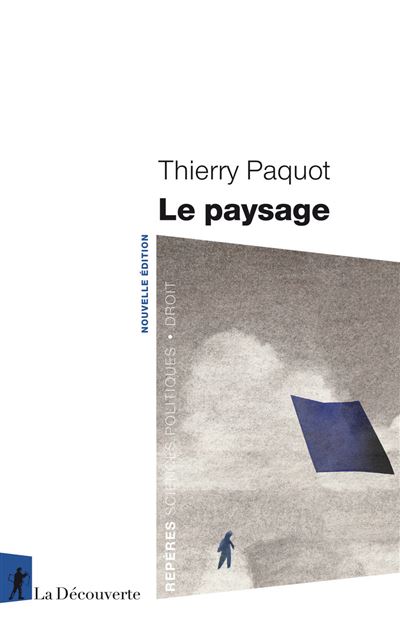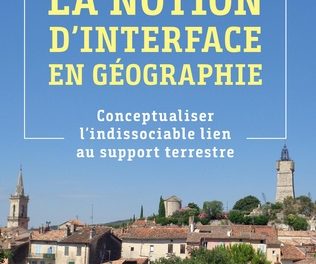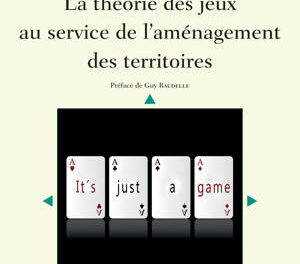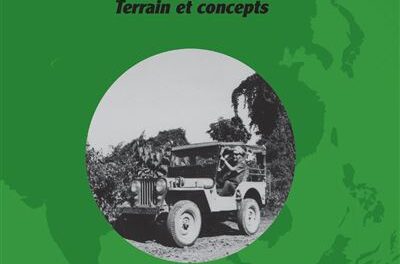Le paysage, dernière parution de Thierry Paquot, est une nouvelle édition augmentée qui fait suite à celle de 2016. Le propos de l’auteur à travers cette collection, « Repères », est justement de donner quelques repères épistémologiques et historiographiques sur la notion de paysage. D’un abord simple, l’ouvrage n’en demeure pas moins, comme il est coutume chez Paquot, extrêmement précis et étayé par de nombreuses références (14 pages de bibliographie, 338 indications, soit 30 de plus que dans la précédente édition). Issu du vocabulaire des peintres au XVIe siècle, le mot « paysage » a progressivement conquis d’autres domaines et acquis d’autres sens selon les disciplines. La notion est aujourd’hui polysensorielle et se place entre « milieu », « environnement » et « nature » quitte à provoquer quelques confusions. L’ouvrage de Thierry Paquot est un véritable état de l’art sur le « paysage ». Le philosophe examine aussi bien les paysages, ruraux comme urbains, et leur patrimonialisation, les transformations du sentiment de nature que ses représentations.
Dans les deux premières parties, Paquot, en fin lexicographe, revient sur le mot et son histoire puis sur la notion au prisme de différents domaines de la pensée (géographie, philosophie, anthropologie etc.). Avec Alain Roger, il revient sur l’esthétisation, l’artialisation, de la nature à travers la représentation paysagère. Il écrit : « les paysages participent à une sorte d’esthétisation de l’environnement […] et, en cela, ils sont polysensoriels et par conséquent subjectifs, d’où une culture paysagère spécifique à chacun et un degré d’attention paysagère différent d’un individu à un autre » (p.9). Il emprunte aux géographes Roger Brunet, Robert Ferras et Hervé Théry la définition qu’ils donnent en 1992 dans Les mots de la géographie : « Le paysage est donc une apparence et une représentation ; un arrangement d’objets visibles perçu par un sujet à travers ses propres filtres, ses propres humeurs, ses propres fins » (p.16). Le paysage est donc un artefact qui convoque trois pratiques, selon Maurice Ronai (1976) : la géoscopie (étude du point de vue), la géographie (discours sur les territoires) et la géosémie (étude des significations d’un paysage). Thierry Paquot met l’accent sur la particularité du « paysage urbain ». Ce dernier ne s’embrasse pas d’un seul coup d’œil comme une vue panoramique, il se traverse, se parcourt, se visite. Le paysage urbain se veut être un réseau et non une vue. C’est un transport et non une image. Un échange et non une icône.
L’écrivain suisse Henri-Frédéric Amiel écrit dans ses notes de voyages en 1852 : « Un paysage quelconque est un état d’âme, et qui lit dans tous deux est émerveillé de retrouver la similitude dans chaque détail. La vraie poésie est plus vraie que la science ». Dans le troisième chapitre, Paquot interroge le lien qui attache nature à paysage et plus particulièrement le sentiment de nature qui s’exprime à travers les représentations paysagères. Le géographe Élisée Reclus constate en 1866 que de plus en plus de voyageurs relatent avec une véritable ferveur leur amour de la nature à partir de l’observation des paysages qu’ils sont amenés à traverser. Il conseille alors d’organiser des classes promenades pour initier les enfants aux sciences naturelles et à la géographie physique afin de leur faire éprouver la nature pour prendre conscience de leurs responsabilités envers elle. Dans Histoire d’un ruisseau (1869) et Histoire d’une montagne (1880), le géographe raconte que le saccage de la nature par l’être humain risque de commencer et qu’il faut tout faire pour maintenir une relation harmonieuse entre les humains et la nature. Cette relation harmonieuse s’exprime dans le paysage, c’est ce que le philosophe-géographe Augustin Berque nomme la « médiance ».
Le chapitre IV montre comment progressivement, par une batterie de lois, le paysage ou les paysages sont patrimonialisés. Dès 1889, le Touring Club de France promeut un inventaire des sites pittoresques afin d’offrir à ses adhérents d’inoubliables promenades en automobile. En 1901, la société de protection des paysages de France est créée. La loi de 1906 assure la protection des monuments et des sites naturels. En 1930, la loi distinguera deux modalités de protection, les « sites classés » et les « sites inscrits ». La loi de 1960 porte sur la création des « parcs nationaux » dont la mission vise la conservation d’écosystèmes fragiles. La « loi Malraux » de 1962 inscrit un bâtiment exceptionnel dans un périmètre sauvegardé qui mérite d’être également protégé. Les lois « Montagne » de 1985, « littoral » de 1986, « Pasqua » de 1995 et « Voynet » de 1999, en sauvegardant certains « milieux » participent à la patrimonialisation des paysages français.
Un dernier chapitre est consacré aux métiers qui se sont créés autour du paysage et, bien entendu, à leur formation de plus en plus pointue et spécialisée. Les travaux de Françoise Dubost (1983) montrent comment la profession de paysagiste s’est progressivement précisée avec l’importante commande publique liée à la multiplication des grands ensembles (1951-1973) et à la création des « villes nouvelles » (à partir de 1965). Paquot nous indique que c’est à cette époque que se séparent les métiers d’horticulteur et de paysagiste. D’un côté, les artisans et de l’autre les artistes !
Si la deuxième version reprend en grande partie les termes de la première, nous avons remarqué trois ajouts importants qui révèlent certaines tendances de l’actualité. Tout d’abord, un long développement traite de la pollution lumineuse (p.33), sujet qui n’est certes pas nouveau puisque dès 1959, nous rappelle l’auteur, la ville de Flagstaff en Arizona avait pris des mesures pour protéger la qualité du ciel nocturne. Cependant, les recommandations des Grenelle de l’environnement remettent le sujet au-devant de la scène. De nombreuses municipalités se préoccupent des « trames noires » qu’elles associent aux « trames bleues » (rivières, lacs) et « vertes » (bois, forêt) et plus rarement « blanches » (le silence). Ensuite, un sous-chapitre est consacré au « droit du ou au paysage » (p.67). La demande vient d’Olivier Gaudin dans Les Cahiers de l’école de Blois : « Observer les innombrables relations qui font vivre un paysage, c’est discerner des rapports de force et de vulnérabilités qui ne relèvent pas en premier du juridique ». Ce droit au paysage implique, comme l’écrit Pierre Donadieu, l’existence d’un « bien commun paysager » qui serait entendu comme le « produit matériel et immatériel d’une gouvernance des paysages impliquant acteurs publics, associatifs et privés sur un territoire ». Enfin, une longue sous-partie tente de redonner aux femmes paysagistes, urbanistes ou architectes une place au milieu d’une foule d’acteurs masculins. Thierry Paquot rappelle ainsi les noms d’Isabelle Auricoste qui fut très active dans le mouvement des grands ensembles pour transformer les « espaces verts » en véritables parcs urbains. Jacqueline Osty ne dissocie pas géographie, écologie et espace public dans sa manière d’appréhender la conception d’un parc. Caroline Stefulesco est celle qui invente l’urbanisme-végétal.
L’ouvrage de Thierry Paquot soulève de nombreuses questions sur le futur de nos paysages. Comme il le souligne dans sa conclusion, dérèglement climatique, montée des eaux, déforestation, artificialisation des sols, méga-feux, bétonisation galopante menacent toujours plus l’environnement. « Tout droit au paysage ne va pas sans devoirs ! »