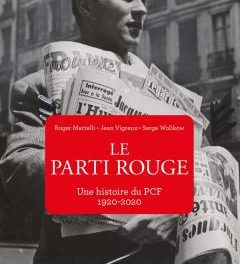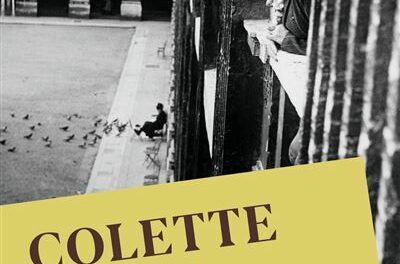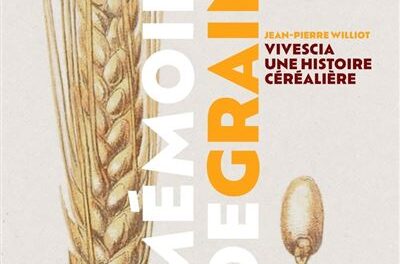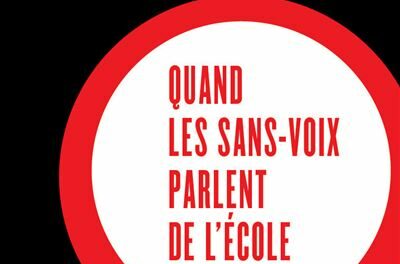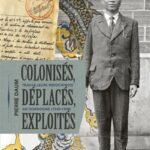Le dernier livre de Mme Vergez-ChaignonSpécialiste de la Seconde Guerre mondiale en France, ainsi qu’en témoignent les livres qu’elle a écrits seule – Vichy en prison. Les épurés à Fresnes après la Libération en 2006 ; Les vichysto-résistants. De 1940 à nos jours en 2008 – ou bien avec d’autres historiens – Les Résistants. L’histoire de ceux qui refusèrent avec Robert Belot en 2003 ; Les Français au quotidien. 1939-1949 avec Éric Alary en 2006 -. Elle a également travaillé pendant dix ans avec Daniel Cordier sur la biographie de Jean Moulin. se propose, en douze chapitres, de restituer une histoire générale de l’épuration avec le rappel, dès l’introduction, de l’origine du mot : épuration date de la Révolution française et a pour sens : « l’exclusion du corps social de ceux qui en sont indignes » (p. 9). 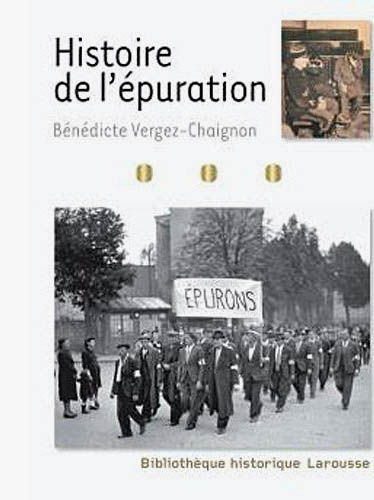
L’épuration, tout à la fois, continue le combat et distribue des châtiments : ces deux buts sont liés. Les exécutions sont nombreuses pendant l’été 1944, concomitantes à l’arrivée des Américains et plus nombreuses dans les zones de force de la Résistance qu’elles légitiment. Cette démonstration de force est un prolongement de la guerre, car le départ des Allemands ne marque pas la fin des combats: l’action d’une cinquième colonne est redoutée, et les hasards des combats provoquent parfois le retour, momentané, des Allemands et des collaborateurs qui se vengent.
Victimes et coupables face à face
Mme Vergez-Chaignon montre bien l’imbrication entre les forces régulières dont l’action pour mener l’épuration est prévue par le GPRF dès 1943 et les FFI/FTP qui contrôlent, arrêtent, jugent, exécutent sans mandat pour le faire. Le gouvernement provisoire, par l’intermédiaire des Commissaires de la République, tente de reprendre les choses en main, mais « la Justice peut-elle condamner des Résistants pour avoir fait justice à sa place ? » (p. 160). Une relance de l’épuration apparaît au printemps 1945, expliquée par l’offensive allemande dans les Ardennes, et surtout par le retour des prisonniers, déportés et travailleurs volontaires en Allemagne qui met en présence physiquement les victimes et les coupables. Particulièrement violente – entre 100 et 150 morts par mois- elle dure jusqu’en mars 1946, moment où la population est lasse et l’épuration jugée ratée. Tout le monde arrête des suspects, et les autorités publient des listes prouvant qu’elles agissent, mais qui constituent la preuve que leurs actions ne sont pas lisibles par la population. Des lynchages ont lieu, des prisons sont attaquées
Tous les types d’épuration – les tontes, les internés, l’épuration économique, professionnelle, politique (il manque cependant l’épuration chez les prisonniers de guerre, menée par l’armée pour les militaires professionnels et par les anciens prisonniers de guerre eux-mêmes pour les mobilisés) sont décrits de manière très précise. Certes des historiens ont consacrés des livres pour chacune de ces épurations, mais d’une part Mme Chevez-Chaignon les a lus, et d’autre part, leur juxtaposition permet des comparaisons tout à fait intéressantes : par exemple l’épuration dans la police a été sévère et rapide ; les intellectuels ont été beaucoup plus condamnés que d’autres collaborateurs ; l’épuration économique a surtout été financière pour soulager l’engorgement de la justice, mais du coup n’est pas visible par la population qui reste sur cette image d’échec de l’épuration alors qu’elle a touchée plusieurs milliers de Français : « 47 000 condamnés des cours de justice, 48 000 indignes nationaux, 160 000 comparutions devant les comités de confiscation des profits illicites, 25 000 fonctionnaires sanctionnés, sanctions professionnelles, inéligibilités. » (p. 572).
Désintérêt des français pour la résistance en 1945 ?
Les différentes instances, judiciaires ou non, sont très clairement expliquées : justices privées, vengeances publiques, cours de justice, chambres civiques, Haute Cour de justice.
Plusieurs aspects sont novateurs car ils fournissent des tableaux précis de données jusque là éparses : une description très précise de l’épuration dans les partis politiques et les syndicats alors qu’il n’existait jusqu’à présent que des livres spécialisés par parti politique; les rapports entre la France et les pays limitrophes – surtout la Suisse et l’Espagne – qui sont apparus comme des asiles à ceux qui cherchaient à fuir l’épuration; le désintérêt des Français pour la Résistance dès le printemps 1945 – les Résistants parlent d’un retour des adversaires de la Résistance car ils craignent de perdre les élections locales alors que seulement 10% des Français veulent un parti de la Résistance (p. 320) ; la volonté par un petit groupe résistant, les Ardents, d’instaurer dans les écoles une nouvelle matière : la révolte ! : « On instituerait un cours spécial sur les soulèvements nationaux pour l’indépendance à travers les siècles » (p. 318)
Ce livre est excessivement riche pour les enseignants de collège et de lycée car il fournit des renseignements sur beaucoup de domaines. Outre évidemment une présentation très précise des épurations, un cours sur la vie quotidienne en France peut être réalisé grâce à de très nombreuses citations de textes – signés, pas anonymes, contrairement à ce qu’on dit souvent – montrant les collaborations de toutes sortes et à tous les niveaux, du petit commerçant à Pétain. Le cours sur la France à la Libération – plus spécifiquement en terminale car plus « pointu » – pourra être enrichi par une image d’extrême violence, de peur de la cinquième colonne, de luttes entre partis politiques (le parti communiste, à la fin de l’année 1944 proteste contre le désarmement des milices patriotiques par de Gaulle en organisant des faux enlèvements, des faux attentats, jouant sur la peur de l’ennemi intérieur). Les mémoires de la guerre en terminale sont abordées. Des arguments supplémentaires sont fournis pour expliquer que les victimes de la Shoah et l’antisémitisme de Vichy n’apparaissent pas dans les procès d’épuration (chapitre X) (y compris le CRIF dont « la ligne majoritaire est de se limiter à établir des dossiers et à fournir des mémoires explicatifs aux juges d’instruction » non à témoigner aux procès (p. 535). Le parcours des collaborateurs (Bousquet, Papon, Darquier de Pellepoix notamment) après leur condamnation est évoqué, de même – et c’est original que celui de leurs enfants-.
Un appareil scientifique – sources, bibliographie, index – complète ce livre, dont la lecture est très agréable et agrémentée par des clins d’œil jamais gratuits : ainsi le titre « Antisémite tu perds ton sang-froid » n’est pas une allusion sans fondement au groupe Trust, mais à la tournée qu’il effectua en 1980 – l’année ou Darquier de Pellepoix meurt en Espagne – où la foule reprit en chœur le titre Darquier : « Vice dans la justice. Qui étaient ses complices ? », qui reprend l’idée largement répandue que l’épuration fut injuste et sans résultats sérieux, idée que ce livre démolit brillamment.