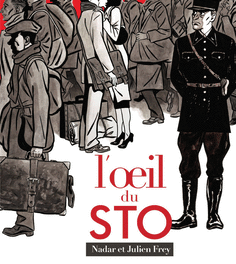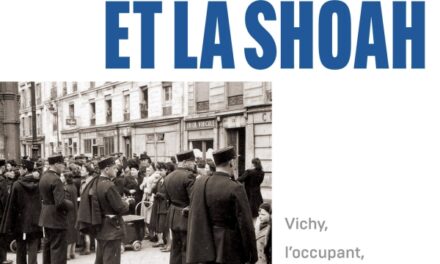Andrej Umanjsky fait le point sur « La conférence de Wannsee. L’heure du crime. »
Heydrich, responsable du RSHA convoque le 20 janvier 1942 quinze hauts fonctionnaires et personnalités importantes du régime nazi pour trouver un accord sur ce qu’ils ont convenu d’appeler la « solution finale de la question juive » en Europe. Ces invités ne sont pas des dirigeants de premier ordre, il s’agit plutôt de conseillers et « d’experts » de la « question juive » venant de divers ministères du Reich. Les conflits de compétences entre les diverses administrations de la bureaucratie nazie imposent une coordination ; Himmler et Heydrich estiment que cette coordination doit être effectuée par le RSHA : un homme a d’ailleurs été spécialement choisi pour cette tâche, Adolf Eichmann.
Quinze jeunes ambitieux bureaucrates se retrouvent donc dans la villa Marlier, au bord du grand lac Wannsee, à Berlin. Construite en 1914 par un homme d’affaires dans ce quartier chic de la capitale, cette vaste demeure était devenue un lieu d’accueil pour les cadres SS de passage à Berlin. Elle est aujourd’hui la maison de la conférence de Wannsee. Il ne s’agit pas d’une réunion politique, les décisions importantes ont été prises bien avant et il s’agit maintenant de les mettre en oeuvre. Le gouvernement général de Pologne est doublement représenté, par son chef, l’administrateur civil du territoire mais aussi par le chef de la Gestapo sur place.
La seule véritable source de la conférence est le fameux « protocole de Wannsee », un compte rendu rédigé par Adolf Eichmann et envoyé aux participants après la réunion. La réunion ne dura qu’une heure et demie : une heure de présentation par Heydrich, puis 30 minutes de discussions. Heydrich insista sur le rôle d’Himmler comme coordinateur et moteur de la « solution finale », il annonça que cette « solution finale » concernait environ 11 millions d’individus puis mentionna pour chacun des pays concernés le nombre de résidents juifs estimés. Afin de concilier les points de vue de ceux qui souhaitaient procéder à une extermination totale dans les territoires occupés et de ceux qui sont d’abord attentifs à la main-d’oeuvre potentielle, un compromis fut trouvé qui consistait à exploiter la main-d’oeuvre jusqu’à la mort par épuisement. L’un des chefs des Einsatzgruppen était présent, ce qui laisse supposer que certaines méthodes d’exécution furent mentionnées, comme l’affirma d’ailleurs Adolf Eichmann.
Ce dernier témoignait du fait qu’Heydrich était exceptionnellement détendu après la conférence : il avait effectivement réussi à imposer ses points de vue et à faire des participants de la conférence des auxiliaires dans la mise en place des plans génocidaires. Deux autres réunions eurent lieu avec des adjoints des participants pour discuter des détails du protocole. L’auteur affirme que, si il y a une quarantaine d’années, les historiens relativisaient l’importance de cette conférence, « les recherches des dernières décennies, affinées par des études régionales sur la Pologne, l’Ukraine et la Biélorussie, montrent que le protocole a repris la logique meurtrière des crimes nazis dans les territoires occupés pour devenir une étape décisive dans l’exécution de la solution finale ».
Xavier Tracol consacre son article au « Doctor Joseph Goebbels. La voix de son maître ».
Troisième enfant d’une fratrie de six, il naît dans une modeste famille catholique de la petite bourgeoisie allemande. À sept ans, il est atteint d’une inflammation de la moelle osseuse et perd l’usage de son pied droit. Une opération échoue en 1907 : il boitera pour le restant de ses jours et devra porter un appareil orthopédique, un handicap qui aura une profonde répercussion sur son enfance : « Je devins un solitaire est un original (…) Mes camarades ne m’aimaient pas. » Réformé contre son gré, il ne peut participer à la Grande guerre. Soutenu par ses parents, il entreprend des études littéraires et obtient en 1921 un doctorat de philosophie. Il tient beaucoup au titre de « docteur » et il insistera toute sa vie pour que ce titre soit apposé devant son patronyme.
Profondément antisémite, il rompt avec le catholicisme. En 1922, il rencontre Élisabeth (« Else »), une institutrice du quartier, qu’il aime mais avec laquelle il rompra en 1926, compte tenu de son ascendance juive. Il se lance dans une activité intense de création littéraire, mais aucun de ses textes ne trouve un éditeur et il en conçoit un fort ressentiment, accusant bien évidemment la « juiverie internationale ». Il s’intéresse au mouvement national-socialiste au début de l’année 1924, au moment du procès d’Adolf Hitler ; il s’engage alors avec passion dans la campagne pour les élections au Reichstag : il rédige des conférences politiques, devient un orateur ambulant du parti et un rédacteur régulier de son hebdomadaire.
Son ascension commence véritablement en 1925, quand Hitler sort de prison et réorganise le parti nazi. Goebbels rencontre Hitler et tombe immédiatement sous le charme. « Il faut dire que les deux hommes ont beaucoup de points communs : une enfance solitaire, un amour fusionnel pour la figure maternelle et un rejet du père, un goût prononcé pour le romantisme allemand, la musique de Wagner, des qualités oratoires peu communes, une vie d’artiste incompris et une vision politique assez proche ». Hitler lui propose la direction du Gau de Berlin ou le parti est mal implanté. Il y réorganise en profondeur le NSDAP et l’impose par des méthodes violentes dans la vie politique locale. En 1928 il est élu député, l’un des douze premiers nazis entrer au Reichstag. En 1930, Hitler le nomme chef national de la propagande du parti nazi ; commence alors une longue concurrence entre Göring et lui pour obtenir les faveurs du Führer. Il prépare intensément les élections présidentielles de mars-avril 1932, puis les législatives de juillet et novembre : « Très imaginatif, il convoque tous les moyens de communication moderne au service de sa propagande. Il fait affréter un avion spécial pour le déplacement d’Hitler sur tout le territoire national (…) Il couvre le pays d’affiches, de tracts, imprime de nouveaux périodiques faisant largement appel à la photographie, fait passer en boucle des spots radio, fait produire des films, coordonne les lignes éditoriales de ses multiples médias, etc. »
Il devient ministre à 35 ans, en mars 1933, et règne dorénavant sur le « Ministère du Reich pour l’éducation populaire et la propagande ». Le 10 mai, il préside à une série d’autodafés de livres « non-allemands ». Une phrase célèbre lui est d’ailleurs fréquemment attribuée : « Quand j’entends le mot culture, je sors mon revolver. » Cette sentence -en fait prononcée par Baldur von Schirach dans un discours de 1939- est une déformation d’une réplique de Schlageter, une pièce de théâtre datant de 1933 de l’auteur nazi Hanns Johst : « Quand j’entends le mot culture… je relâche la sécurité de mon Browning ! ». De 1933 à 1938, les efforts de Goebbels portent principalement vers trois directions : l’établissement d’une censure de l’information, la mise au pas des secteurs culturels et artistiques et la radicalisation du régime à l’égard des juifs.
Grand amateur de cinéma, il opte pour la production de divertissements plutôt que de films de propagande, dans le but de soutenir le moral de la population. Son autre grande réussite est radiophonique : dès 1933, il fait concevoir un poste radio à bas prix et de conception simple. Il s’en vend des millions, et ainsi la propagande du régime entre dans tous les foyers. Surnommés les « museaux de Goebbels » par les auditeurs, ces postes de radio deviennent le principal vecteur de désinformation du régime, et une source de revenu non négligeable pour le ministère de Goebbels. Il orchestre la « Nuit de cristal » en novembre 1938, puis il s’emploie à manipuler la population pour exciter le nationalisme et préparer la volonté de guerre. Journaux et radios inventent ainsi une « terreur tchèque », puis une « terreur polonaise » envers les minorités allemandes de ces deux pays.
À partir de 1943 il s’emploie à mobiliser la population dans une guerre totale, sa dernière grande campagne portera sur les « armes miracle », destiné à sauver le Reich millénaire. Le 22 avril 1945, avec Magda, qu’il a épousée en 1931, et leurs six enfants, il rejoint la chancellerie où il retrouve Hitler et ses derniers fidèles. Le testament d’Hitler fait de lui le nouveau chef du gouvernement et le dernier chancelier du Reich. Il échoue dans une ultime négociation avec les Soviétiques et, après avoir mortellement empoisonné leurs six enfants, Joseph et Magda Goebbels se suicident.
Deux articles sont consacrés à l’entrée des États-Unis dans la guerre : l’un de Vincent Bernard, « L’Amérique glisse vers la guerre. L’exemple de San Francisco et de la mise en alerte de la côte pacifique » ; l’autre d’Alexandre Thers, « La bataille de Los Angeles. Psychose et avions fantômes ».
La ville de San Francisco est, en 1940, l’un des principaux centres nerveux de l’immense État californien, ainsi qu’un important site militaire. L’attaque japonaise intervient comme le terme violent d’une préparation enclenchée depuis de nombreux mois, mais aussi comme déclencheur de phénomènes d’exclusion propre à l’hystérie des sociétés en guerre. En février 1942, sur la foi de rapports alarmistes mais faux remis par le FBI, Roosevelt décide la déportation dans l’Ouest intérieur, en camps d’internement, de toutes les populations « ethniquement japonaises ». 110 000 Japonais connaîtront ce sort humiliant, mais ces mesures ne toucheront pas les populations d’origine allemande ou italienne.
Xavier Tracol signe un article intitulé : « La guerre du champagne. Un vignoble entre réquisition et résistance ».
La région de Champagne est sortie meurtrie de la Première Guerre mondiale. Après 1918, il a fallu reconstruire Reims, relever les domaines dévastés, combattre le phylloxéra et reprendre la production. Les ventes se sont fortement accrues durant l’entre-deux-guerres qui fut finalement une période faste. Quand débute la guerre, les propriétaires de vignoble enmurent une partie de leur production au fin fond des profondes galeries calcaires qui constituent leurs caves. Les vainqueurs volent néanmoins plus de 2 millions de bouteilles en quelques semaines !
Au début de l’Occupation la situation commerciale n’est pas brillante, car les marchés britannique et américain, qui étaientt avant-guerre les principaux débouchés étrangers de Champagne, sont désormais interdits. L’occupant devient le principal client et consommateur ; mais c’est un gros client et un gros consommateur car le champagne devient un produit stratégique qui doit être fourni en abondance à la Wehrmacht. Les autorités d’occupation créent un bureau régional chargé de coordonner les achats allemands et de fixer les prix ; il en va de même en Bourgogne et en Bordelais, l’objectif de Göring étant d’envoyer en Allemagne les meilleurs crus pour, d’une part, les réexporter, d’autre part les consommer.
En juillet 1940 arrive donc en Champagne un Weinführer qui impose des prélèvements autoritaires de 2 millions de bouteilles par mois et qui met sur pied une véritable organisation interprofessionnelle qui manquait en Champagne. Il s’appuie dans cette tâche sur le préfet de la Marne, René Bousquet. À partir de 1943, la Résistance se manifeste. Les 24 km de galeries que compte la cave Moët et Chandon servent ainsi entreposer des millésimes rares ainsi qu’à abriter des armes et des résistants. Le propriétaire, Jean de Vogüé est lui-même résistant ; arrêté par la Gestapo, il est condamné à mort, puis sa peine est commuée en déportation. Pour sa part le propriétaire de Piper-Heidsieck rejoint les Forces aériennes françaises libres en Afrique du Nord. En représailles l’occupant place le domaine sous séquestre et s’empare des stocks. Peu de combats se déroulèrent en Champagne lors de la libération de la France. Avec un vignoble est un matériel à peu près intacts, l’avenir du champagne est donc beaucoup moins sombre qu’au sortir de la Première Guerre mondiale.
Le dossier s’intitule : « Résistance ou Collaboration. Le choix des Français ». Ce titre est bien évidemment réducteur, l’immense majorité de la population ne se rangeant ni dans l’une ni dans l’autre de ces catégories, qu’il ne faut d’ailleurs pas mettre sur le même plan. Il est composé de quatre articles : l’un sur l’industrie automobile française, deux autres sur la Légion des volontaires français contre le bolchevisme et l’un de ses plus éminents membres, l’« historien » Saint-Loup, le quatrième sur la Résistance en France.
Nicolas Anderbegani traite de « L’industrie automobile française sous l’Occupation. Le dilemme de la collaboration ».
L’article montre que l’industrie automobile française a été l’objet d’une réorganisation étatique de la part du gouvernement de Vichy, qu’elle a été victime d’une mainmise allemande particulièrement nette, mais il montre aussi que le comportement des entreprises a été fort différent dans l’attitude à adopter à l’égard de l’occupant.
Renault, dont le directeur général et François Lehideux, neveu par alliance de Louis Renault, ancien cagoulard et responsable vichyste, fait preuve de beaucoup de complaisance à l’égard de l’occupant (quoi qu’en disent ses héritiers qui ont assigné officiellement l’État en justice en décembre 2011, demandant réparation suite à la nationalisation de la firme en 1945). Il en va de même pour l’avionneur Caudron et pour le constructeur lyonnais Berliet, de plus en plus impliqué comme fournisseur des forces armées allemandes.
Tandis que ces firmes collaborent de plein gré, d’autres se montrent plus réticentes, voir résistantes : Peugeot dont les responsables prennent contact avec la Résistance, financent un maquis ou rejoignent la France libre et sont d’ailleurs victimes de la répression allemande ; Hispano-Suiza, constructeur d’automobiles de luxe et de voitures de sport, mais également spécialisé dans les moteurs d’avion, dont le directeur fut déporté, parvint à ne livrer aucun matériel en quatre ans ; Michelin dont deux membres de la famille furent déportés et qui contraria fortement la volonté allemande de constituer un cartel européen du secteur caoutchouc-pneumatique. « L’industrie automobile reflète ainsi l’éventail très large des attitudes qui furent adoptées à l’égard de l’occupant, les institutions de Vichy étant rapidement reléguées à leur fonction d’exécutrices serviles (…) Travailler sous la contrainte n’implique pas forcément d’abandonner toute forme de patriotisme et d’esprit de lutte. Certains choisissent la passivité et l’attentisme (…) D’autres, par des divulgations d’informations, des blocages administratifs voir des sabotages, participent à ces innombrables et anonymes combats de l’ombre. »
Nicolas Chevassus-Louis propose une excellente présentation des débuts de « La Résistance en France. Dix-huit mois après la défaite »
Cet article tient compte de la plus récente historiographie, laquelle apporte un « éclairage nouveau sur cette période fondatrice », s’écoulant de l’armistice au parachutage de Jean Moulin, dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942. L’auteur constate que l’on peut déjà reconnaître, dans les premiers jours de 1942, « les acteurs les plus importants de la Résistance, telle qu’elle se déploiera avec toujours plus de force durant les deux années suivantes ». Des huit grands mouvements qui participeront en 1943 au Conseil national de la résistance, sept sont déjà constitués. Des dizaines de réseaux affiliés à la France libre ou aux services britanniques sont déjà en activité. Enfin le parti communiste, troisième acteur, et lui aussi dans la Résistance. « Il y a cependant une part d’illusion téléologique » a dresser ainsi une liste des organisations de résistance constituées à la fin de l’année 1941, pour deux raisons : la première est que l’on oublie ainsi les organisations qui furent démantelées et qui sont disparues, la seconde est que « les passerelles entre les différentes organisations étaient très fréquentes, et que l’on aurait tort de les voir comme des ensembles clos et hiérarchisés ». L’auteur se réfère alors aux travaux de Julien Blanc sur le réseau du musée de l’Homme et la proto-résistance (dont nous avons rendu compte http://www.clio-cr.clionautes.org/spip.php?article3204) ; il rappelle que ce « réseau », ne disposait pas « d’une structuration formelle » et que son historien parle de « nébuleuse » ou d’« archipel ». L’action de ces premières organisations se limite pour l’essentiel à la propagande antiallemande dans la diffusion de la presse clandestine, et, dans le cas des réseaux, à la collecte de renseignements sur l’occupant qu’il est d’ailleurs difficile de transmettre à Londres.
« Effectifs et structurations internes restent encore embryonnaires (…) Une des grandes avancées de l’historiographie de la dernière décennie est de réviser à la hausse l’ampleur du refus initial de l’occupant là où il était présent. Les historiens, à la suite de Robert Paxton ou de Philippe Burrin, ont beaucoup souligné, depuis les années 1970, l’accommodation de la population française à la présence de l’occupant et son absence d’hostilité initiale. Il est aujourd’hui clair que cette thèse ne peut être tenue pour exacte sur l’ensemble du territoire. » Les recherches historiques montrent que le rejet initial de l’occupant, en zone Nord, s’exprime de multiples manières : actualités allemandes chahutées dans les cinémas, papillons apposés sur les murs, glissés dans les journaux ou abandonnés dans les lieux publics mais surtout, multiplication des manifestations hostiles à l’occupant, ou au gouvernement de Vichy en zone Sud.
L’action directe, hors de toute consigne des organisations de résistance, est apparue très tôt. « Schématiquement, l’hostilité aux Allemands semble avoir été proportionnelle à la densité des troupes d’occupations : faible dans les zones rurales ; plus forte dans les villes et sur le littoral de la zone nord, où étaient cantonnées les principales forces allemandes ; et d’emblée très forte dans les départements de l’Est annexé par le Reich, et du Nord. D’où une spécificité de la Résistance en zone Sud (…) Là encore, l’historiographie a connu ces dernières années une importante évolution, en revoyant à la hausse l’ampleur de soutien au régime de Vichy parmi les pionniers de la Résistance (…) Longtemps minorée, parfois tue dans les témoignages et les mémoires d’après-guerre, cette imprégnation vichyste de nombre de pionniers de la Résistance est aujourd’hui bien établie. » Peut-on pour autant qualifier ces pionniers de « vichysto-résistants » ? Johanna Barasz, auteur de la première thèse sur cette question (De Vichy à la Résistance. Les vichysto-résistants 1940-1944, soutenue en 2010 à l’IEP de Paris sous la direction de Jean-Pierre Azéma), ne le pense pas, préférant réserver ce terme à ceux qui refusent de choisir entre actions antiallemandes et soutien au régime. Les vichysto- résistants sont persuadés que Vichy est secrètement engagé dans une action antiallemande. Une des figures emblématiques est le général Cochet qui refuse d’entrer en dissidence et signe ses appels de son nom de son grade ; les officiers qui camouflent du matériel au sein de la petite armée d’armistice, tout en travaillant au sein des services de renseignement vichystes, en sont également. L’auteur traite ensuite de la question de l’apparition de la lutte armée, et, enfin, des premières relations entre la Résistance intérieure et la France libre à Londres.
Daniel Laurent traite de « La Légion des volontaires français devant Moscou. Ces Français en vert-de-gris ». Il rappelle les conditions de la création par les collaborationnistes parisiens de cette organisation, les réticences des autorités nazies, les modalités de son intégration au sein de la Wehrmacht, la chronologie et la géographie de sa participation à la campagne de Russie. Il souligne l’importance des pertes devant Moscou, le mépris des officiers allemands pour leurs homologues français, et la réalité des crimes de guerre commis par les légionnaires dans le cadre de la lutte contre les partisans soviétiques.
Patrick Rouveirol s’intéresse pour sa part à « Saint Loup. Quand les chemins de traverse conduisent au fond de l’Est ». Il s’agit d’une biographie de Marc Augier, qui fut connu comme écrivain et qui se prétendit historien, obtenant d’ailleurs de beaux succès de librairie par ses publications douteuses dans les années 1970.
A noter encore : un entretien avec Raymond Aubrac, un très court article sur les difficultés financières de la Grèce en 1931, critiquée alors pour sa politique par l’agence d’analyse financière Moody’s Corporation (fondée en 1909), et toutes les rubriques habituelles.