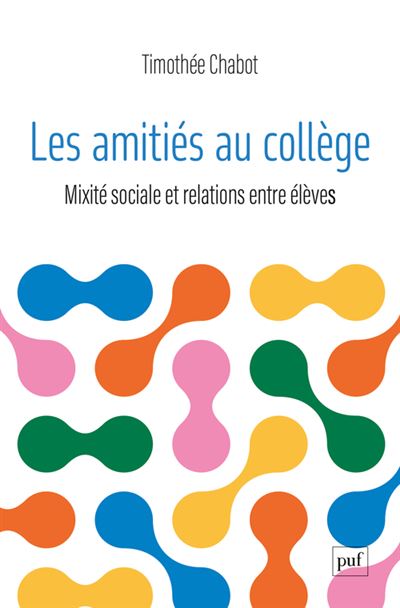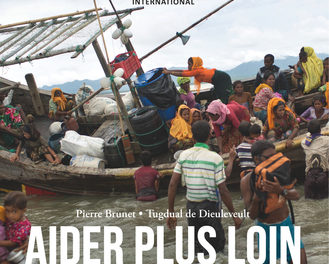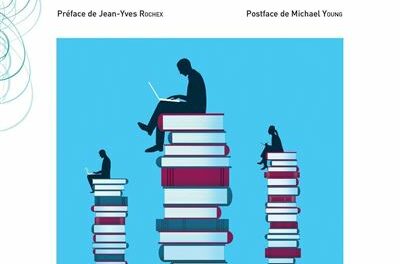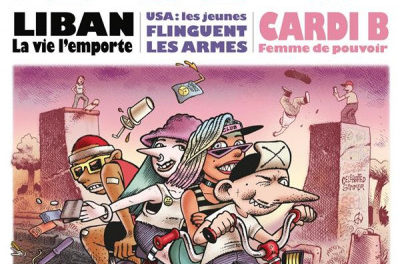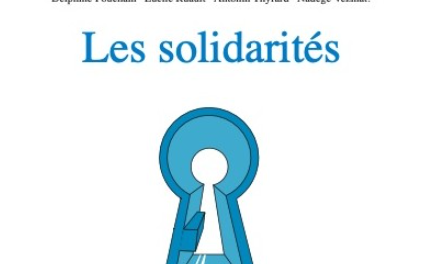Les amitiés qui se construisent au collège peuvent-elles franchir les frontières ?
C’est à cette question que le sociologue Timothée Chabot de l’université de Toulouse s’est proposé de répondre en menant une enquête auprès de quatre collèges français, deux à Paris et deux en Savoie, deux collèges publics, deux collèges privés, deux collèges urbains, deux collèges ruraux.
L’auteur a suivi pendant presque trois ans, dans chacun des établissements, la cohorte d’élèves entrés en 6ème lors de la rentrée 2017. À partir de questionnaires portant sur les goûts, le contexte familial, les loisirs des élèves et d’une cinquantaine d’entretiens, Chabot a mené une enquête en méthodes mixtes, c’est-à-dire combinant sources de données quantitatives et qualitatives. Quatre établissements sont, aux dires de l’auteur, des établissements tout à fait ordinaires. La mixité sociale y est une constante. Un premier examen des réseaux d’amitié montre que les enfants socialisent principalement en groupes et que leur conception de ce qu’est une « amie » diffère en partie de ce qu’on trouve chez les adultes. On le sait l’amitié prend au collège un caractère obligatoire, elle occupe une place centrale dans le quotidien des élèves. Pour les collégiens, un ami n’est pas forcément une personne avec laquelle on partage une forte intimité ; c’est souvent quelqu’un avec qui on aime passer du temps.
À partir d’une analyse statistique, Chabot montre la force de ce qu’il appelle l’homophilie sociale. En effet, pour bon nombre des élèves, leurs réseaux d’amitié se forment entre élèves de même origine sociale. Cette homophilie sociale est aussi importante que l’homophilie des résultats scolaires et d’origine ethno-migratoire. Elle est cependant nettement moins forte que l’homophilie de genre. Dans l’ensemble, la ségrégation sociale des réseaux d’amitié reste modérée, et la plupart des élèves ont au moins quelques amis d’une origine sociale très différente de la leur.
En s’appuyant sur les entretiens menés auprès des élèves, notre auteur a souhaité explorer les mécanismes de formation des amitiés entre les enfants. Ainsi, constate-t-il que les élèves ne font que marginalement preuve d’une conscience de classe dans leurs choix amicaux. Le plus souvent, l’origine sociale corrèle à d’autres caractéristiques qui sont davantage déterminante dans l’amitié.
Chez les élèves, les rapports entre groupes sociaux sont largement pacifiés. Lorsque des situations de tensions entre classes existent, les élèves les résolvent plus par l’évitement que par l’affrontement.
Dans la dernière partie de l’ouvrage, Chabot apporte quelques conseils à partir de questions que tout enseignant, chef d’établissement ou personnel de la vie scolaire sont en droit de se poser. Ainsi conclut-il que le climat scolaire est particulièrement dégradé dans les collèges ségrégués-populaires. L’accroissement de la mixité sociale augmente le bien-être des enfants d’origine supérieure. Le jeu des options et la constitution de classes atypiques réduisent nettement la possibilité de mixité sociale. La configuration urbaine du secteur de recrutement joue un rôle non négligeable : si tous les enfants d’origine populaire du collège habitent le même parc de logements sociaux, ils constitueront un groupe beaucoup plus fermé dans les réseaux d’amitié que si plusieurs quartiers fournissent chacun un petit contingent d’élèves de chaque milieu social.
Même si les conclusions données par l’ouvrage ne sont pas d’une grande évolution, elles ont le mérite de s’appuyer sur une méthodologie extrêmement précise et pertinente ainsi que sur un apport théorique solide.