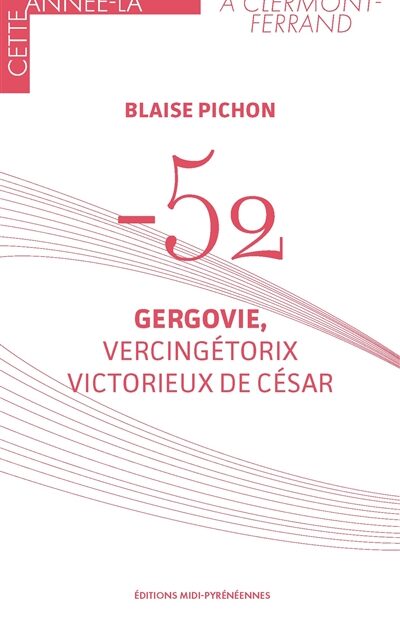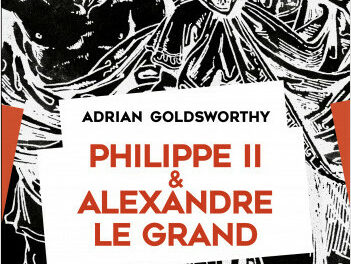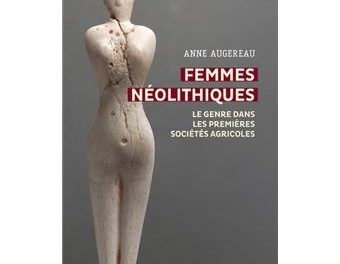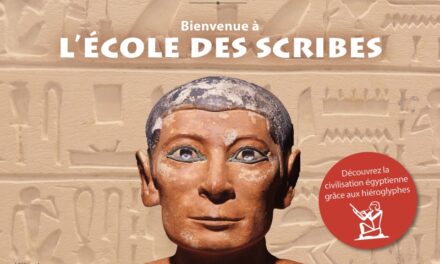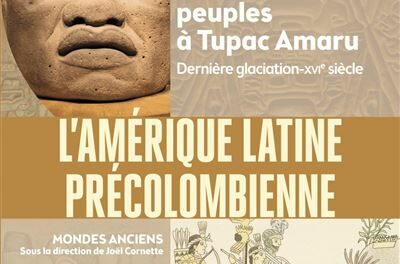Cinquante-deux avant notre ère. Une date qui rappelle au grand public la défaite de Vercingétorix face à César à Alésia. Mais c’est aussi l’année de la victoire du chef arverne face au stratège romain à Gergovie comme le rappelle le titre de l’ ouvrage de Blaise Pichon, maître de conférences en histoire et archéologie romaine à l’université Clermont-Auvergne, objet de cette chronique.
Le propos est articulé autour de trois grands axes, respectivement intitulés « Une bataille au cœur de la révolte gauloise contre Rome », « Gergovie et le pays arverne au temps de Vercingétorix » et « Un événement et un site instrumentalisés ».
Une bataille au cœur de la révolte gauloise contre Rome
La première partie débute sur une contextualisation de la bataille de Gergovie, d’abord géographique puis historique : « la bataille de Gergovie s’inscrit dans le dernier acte de la guerre des Gaules, en 52, alors que César est persuadé que la mainmise romaine sur ces territoires est désormais bien établie » écrit Blaise Pichon (p.5).
Le soulèvement de 52 ne concerne pas l’ensemble des Gaules et il n’est en rien une « insurrection nationale ». Le premier acte de l’insurrection est le massacre de commerçants romains à Orléans ; Vercingétorix, dès le début des événements, a un rôle qui dépasse la seule cité des Arvernes et il reçoit nous dit César, « le commandement suprême ».
C’est à la fin mai ou au début de juin 52 que les contingents romains arrivent près de Gergovie. Si César affirme qu’il est à l’origine de ce déplacement, il est tout à fait possible et surtout plausible que l’initiative du choix de Gergovie soit à mettre au crédit de Vercingétorix.
Blaise Pichon indique que le romains disposent d’environ 40 000 hommes ; en infériorité numérique, ils font face, en sus, à un site puissamment protégé. Vercingétorix a bien assimilé la manière de commander des Romains et il est également à même de mener un siège. Rapidement pris au piège par tout un ensemble de facteurs, César choisit de tenter l’assaut de l’oppidum de Gergovie. En dépit de quelques avancées, les Romains sont repoussés et les pertes sont lourdes.
La bataille est par ailleurs attestée archéologiquement par la mise au jour de nombreux artefacts à caractère militaire.
Gergovie et le pays arverne au temps de Vercingétorix
Les Arvernes contrôlent un territoire vaste et prospère en Gaule centrale. Mentionnée dans les sources antiques, la puissance arverne est mieux comprise aujourd’hui grâce aux progrès de l’archéologie. A partir du IIIe siècle avant notre ère, leur territoire connaît une accélération de son développement économique et une hausse de sa population. Les échanges avec le monde romain sont nombreux dès le milieu du IIe siècle avant notre ère mais la puissance arverne commence à décliner à partir de 121 avant notre ère, en lien avec le contrôle de la Gaule transalpine par Rome.
Le site même de Gergovie, en 52 avant notre ère, est « l’un des trois sites majeurs du territoire des Arvernes, avec Corent et Gondole, deux autres oppida » écrit Blaise Pichon (p.23). L’oppidum a probablement été édifié vers 70 avant notre ère et son système de fortification est des plus impressionnants. L’auteur (p.25) précise que le rempart « combine des éléments architecturaux d’origine grecque (des éperons réalisés en arrière du rempart et disposés perpendiculairement à lui) et des adaptations locales (une muraille formée d’un double parement de pierres sèches de part et d’autre d’une masse de terre).
Sur Vercingétorix lui-même, les éléments précis de connaissance demeurent très lacunaires : pas de portrait physique fiable et pas de date de naissance connue (César emploie toutefois, à son propos, le terme d’adulescens, ce qui signifie qu’il serait né à la fin des années 80 ou dans les années 70. Strabon nous dit en revanche qu’il est né à Gergovie). Venant d’une importante famille aristocratique arverne, son nom peut être traduit comme signifiant « roi des guerriers ». César n’évoque pas Vercingétorix avant 52 et il en offre ensuite un portrait très négatif, dénonçant notamment sa volonté d’accéder à un pouvoir royal, véritable « épouvantail » politique pour un Romain.
Un événement et un site instrumentalisés
Blaise Pichon (p.31) écrit que « dès l’origine, la bataille de Gergovie a été identifiée comme un moment singulier par ses protagonistes et intégrée à la mémoire du peuple romain. Après une longue éclipse, elle est mise à l’honneur dans le récit national français à partir de la période moderne, avec plusieurs phases d’instrumentalisation, dont la dernière est intervenue durant la Deuxième Guerre mondiale ».
Gergovie permet à Vercingétorix d’obtenir des ralliements et également l’imperium (commandement) sur l’ensemble des insurgés. Toutefois, comme le note l’auteur, « Gergovie a été une victoire sans lendemain » avec la défaite d’Alésia et la reddition de Vercingétorix. Gergovie reste cependant un site majeur de la cité arverne dans les années qui suivent la guerre de Gaules.
Le site, après une longue période d’oubli, est redécouvert au milieu du XVIe siècle.
Napoléon III y lance, à partir de 1861, des recherches archéologiques et Eugène Stoffel (qui dirige les fouilles) identifie les camps de César et le fossé qui les relie.
Jusqu’au XIXe siècle, c’est principalement César et ses soldats qui sont mis en avant dans le cadre de la bataille de Gergovie.
La volonté d’ériger un monument dédié à Vercingétorix à Gergovie devient un projet local dès 1836. Clermont-Ferrand accueille une statue représentant le chef arverne en 1903 et Gergovie reçoit, en 1900, la réalisation de l’architecte clermontois Jean Teillard.
Gergovie fait aussi l’objet d’un projet de cénotaphe grandiose en lien avec la Grande Guerre.
Le régime de Pétain utilise également Gergovie. En 1942, le monument de Gergovie est choisi comme lieu de célébration du deuxième anniversaire de la Légion française des combattants. La même année, le monument de 1900 sert de lieu de cérémonie. Une crypte y est aménagée, destinée à recevoir des sachets de terre provenant de France et des colonies. Vercingétorix et Gergovie vont également être invoqués par les résistants. Puis Gergovie cesse d’être un lieu d’expression politique pour devenir ensuite un lieu de mémoire.
En guise de conclusion, Blaise Pichon (p.45) écrit que « Vercingétorix n’est donc ni le premier des Français, ni le glorieux vaincu, ni le porte-étendard d’une résistance gauloise face à l’envahisseur. C’est un grand aristocrate gaulois, un chef de guerre, dont les buts politiques nous échappent, au-delà de la contestation des aristocrates gaulois partisans de l’intégration au monde romain. Quant à la bataille de Gergovie, pas plus que celle d’Alésia, elle ne peut être considérée comme la matrice la nation française ».
Ecrit dans un style alerte et avec une grande cohérence intellectuelle, l’opus de Blaise Pichon nous livre une synthèse d’une grande clarté sur la bataille de Gergovie et, par extension, sur Vercingétorix et le monde arverne lors de la guerre des Gaules.
Tenant compte des derniers acquis de la recherche, le livre est d’une belle érudition et s’adresse autant à un large public qu’aux étudiants et professeurs soucieux d’actualiser leurs connaissances. Un bel ouvrage dont on ne peut que recommander la lecture !

Photographie G.Masson