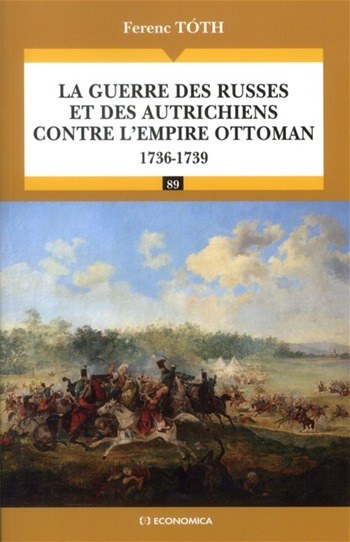
Disciple du moderniste français Jean Bérenger, l’universitaire hongrois Ferenc Tóth est spécialiste de l’histoire moderne de l’Europe centrale et de l’empire ottoman. Consacré comme les précédents à une confrontation militaire en Europe orientale, ce livre est le troisième titre qu’il signe aux éditions Economica. Alors qu’elle avait éveillé un intérêt marqué chez les contemporains, la guerre des confins livrée pendant trois ans, de 1736 à 1739, par une alliance austro-russe présumant de ses forces à une Turquie moins flageolante que prévu, a été oubliée par l’historiographie française récente. En abordant cet épisode délaissé, Ferenc Tóth lui restitue son caractère d’événement charnière dans l’histoire de l’Europe orientale, qu’il envisage selon une triple perspective.
Fidèle à l’esprit de la collection qui l’accueille, sa narration est d’abord d’ordre militaire, et fait la part belle à l’art de la guerre dans l’Orient complexe, à ses avatars et ses évolutions. En parallèle, l’auteur met l’accent sur le lien étroit entre les péripéties apparemment illisibles -vues d’Europe occidentale- d’un choc des civilisations à la fois périphérique et pluriséculaire, et le «grand jeu» diplomatique des affrontements et des équilibres entre les puissances occidentales. Enfin, au croisement des deux précédents, un troisième axe thématique s’impose : celui de la lente recomposition géopolitique de l’Europe orientale entre trois états, l’Autriche, la Russie et la Turquie, mus par des logiques -soit conjoncturelles soit structurelles- d’émergence et de déclin qui devaient trouver leur aboutissement, bien plus tard, dans l’ultime ordalie que fut la Première guerre mondiale.
Un équilibre instable
La documentation employée par l’auteur est assez riche. S’appuyant sur les archives autrichiennes et françaises et les témoignages (restés manuscrits pour certains) de plusieurs protagonistes, ainsi que sur l’historiographie de l’époque, Ferenc Tóth restitue avec précision les péripéties événementielles d’un conflit à la fois touffu et confus dont les racines sont ancestrales. Les guerres du XVIIe siècle ont permis l’émancipation définitive de la Hongrie et la reconquête temporaire de la Serbie en vertu du traité de Passarowitz en 1718. Sur la longue durée, la situation reflète l’effritement militaire des Ottomans, en dépit de leurs succès contre les Vénitiens et malgré le soutien séculaire de la France, d’autant qu’ils vivent aussi un conflit séculaire sur leur flanc oriental contre les Perses, dans une région où commencent à pointer les ambitions de la puissance émergente russe. La séquence de paix qui s’ensuit voit les Turcs, conscients de leur retard sur l’Occident, privilégier l’ouverture au progrès par la voie diplomatique : implantation d’ambassades en Europe, contagion des modes dont la « folie des tulipes » est le symbole à la fois éclatant et futile, établissement de la première imprimerie à Constantinople en 1727. Transfuge des armées impériales converti à l’islam, l’aventurier français Bonneval, fait général et pacha, engage une réforme -inaboutie- de l’armée ottomane en lui inculquant quelques rudiments de la discipline à l’européenne. Mais la Sublime Porte est malmenée par les défaites militaires face à la Perse et les révoltes des Janissaires sur le plan intérieur, et le pouvoir modernisateur y est renversé par un coup d’état en 1730.
Dans le camp d’en face, un pacte de défense austro-russe a été conclu en 1726 dans la perspective d’une éventuelle guerre contre les Britanniques. La crise est finalement résolue de façon pacifique, mais l’alliance ainsi nouée perdure sans objet précis. Depuis la paix de 1718, l’Autriche ne considère plus les Turcs comme une menace et n’a pas d’objectifs territoriaux à leur égard. Elle ne leur prête plus que le rôle d’un éventuel ennemi de revers dans le cadre d’un conflit avec la France ou la Grande-Bretagne. Mais le soutien accordé à Vienne par la Russie lors de la guerre de succession de Pologne en 1733 rend inévitable, par réciprocité, l’appui autrichien aux opérations lancées à l’encontre de la Turquie par les Russes en 1736. Motivation moins avouable, l’Autriche a aussi le souci de l’équilibre des forces qui résulterait d’un éventuel effondrement ottoman : en prenant part au conflit, il s’agit donc pour elle d’éviter que la Russie ne s’arroge seule un tel volume de conquêtes qu’elle en devienne une superpuissance orientale dominatrice. C’est sur ces bases équivoques que Vienne entre avec réticence dans une confrontation qu’elle ne veut pas livrer, et dans laquelle les objectifs et les ambitions de son partenaire lui demeurent largement indéchiffrables.
Des opérations militaires malencrontreuses
Plutôt que d’une seule guerre, il est sans doute mieux approprié d’évoquer deux guerres parallèles, tant les lieux d’action sont éloignés et tant la coordination opérationnelle fait défaut au sein de la coalition. L’attaque russe de 1736 pose un schéma de manoeuvre invariant réitéré au cours des campagnes suivantes, qui articule des opérations destinées à s’assurer la possession de points clés garantissant un accès à la Mer Noire (notamment à Azov) avec des intrusions en Crimée où un ennemi insaisissable (les Tatars) pratique efficacement les méthodes de la petite guerre et de la terre brûlée. De leur côté, les Autrichiens qui entrent à leur tour dans la partie en 1737 adoptent pour colonne vertébrale de leur effort dans les Balkans l’axe naturel du Danube, dont le rôle logistique est tout aussi crucial. Chacun, de son côté, patine après de modestes succès initiaux. Puis la situation s’aggrave sensiblement pour les Autrichiens, contraints à reculer jusqu’en Serbie où les Turcs entament en 1739 le siège du verrou stratégique majeur que constitue la forteresse de Belgrade.
Si les axes d’effort et les théâtres d’opérations des Russes et des Autrichiens ne sont pas les mêmes, en revanche leurs incuries et faiblesses révélés par l’épreuve de la guerre se rejoignent. La réalité du terrain n’est pas glorieuse pour la coalition, accablée par de lourdes et multiples insuffisances. Les deux alliés disposent d’outils militaires rigides, aux méthodes de combat inadaptées et à la logistique structurellement défaillante. Les troupes subissent une sévère attrition due aux ravages épidémiques (notamment ceux de la peste, endémique dans les territoires parcourus par les armées en campagne). Un manque flagrant de connaissance du terrain, dont le caractère compartimenté désavantage l’envahisseur, un piétinement dans la progression coûteux en vies et en ressources, un commandement souvent déficient assuré par des généraux pour la plupart timorés et peu capables, et enfin une absence notoire de coordination opérationnelle rendent les campagnes entreprises peu efficaces et leurs objectifs erratiques.
Face à eux, la Sublime Porte fait plus que bonne figure. Ses armées ont l’avantage du terrain et de la rusticité. Une résistance efficace épuise l’ennemi par la pratique performante de la petite guerre. En bataille rangée, le travail de modernisation inspiré par l’Occident porte ses fruits. Surtout, une claire vision stratégique guide l’action des décideurs ottomans. Négligeant les Russes obnubilés par la Crimée, ils font porter l’essentiel de leur effort contre les Autrichiens en remontant l’axe du Danube.
Sur le plan militaire, cette guerre perdue n’est pourtant pas dépourvue de leçons positives pour les occidentaux. Les campagnes menées en territoire inconnu sont l’occasion de développer un savoir géographique nouveau, et amorcent les prémices de l’orientalisme. Leur principale leçon tactique est l’essor des troupes de cavalerie légère, sur le modèle des hussards hongrois, qui vont essaimer dans toutes les armées européennes. Enfin, il n’est pas anodin que ces événements aient suscité l’intérêt des contemporains : ils constituent bel et bien une césure dans la pensée militaire européenne, et suscitent l’avènement d’une nouvelle génération de théoriciens originaux marqués par ce conflit, auquel beaucoup ont participé activement ou assisté en observateurs dans un camp ou dans l’autre.
Une partie diplomatique complexe
La guerre n’exclut pas la diplomatie – surtout celle des coulisses. En fait, on commence à négocier dès 1737, en indexant le contenu des pourparlers sur les aléas des opérations. Le jeu diplomatique qui se déploie est complexe, et plus étroitement corrélé qu’on ne l’aurait imaginé à l’équilibre des force en Europe occidentale. Car la France s’invite dans le concert en qualité de puissance médiatrice, avec d’autant plus d’insistance qu’elle est, à la fois, soucieuse d’éviter un affaiblissement notable de son partenariat historique avec la Turquie et désireuse de diviser l’alliance austro-russe, dont l’approfondissement pourrait mener à l’exercice d’une hégémonie conjointe sur l’Europe orientale.
Le marquis de Villeneuve, ambassadeur de France à Constantinople, joue donc un rôle décisif de médiateur dans les arcanes de la manoeuvre diplomatique, qui atteint son stade décisif lors de la négociation de la paix de Belgrade en 1739. Menées dans le camp de l’armée ottomane, où les négociateurs ennemis placé sous bulle ne sont pas informés de l’évolution des événements militaires, elles aboutissent à la concession par les Austro-Russes d’une paix désavantageuse au regard de l’amélioration récente -mais fragile- de leur situation tactique. Le résultat est particulièrement calamiteux pour les Autrichiens, qui sont contraints d’abandonner la Serbie et perdent sur le tapis vert la puissante forteresse de Belgrade acquise en 1717, qui résistait toujours avec énergie au siège des forces ottomanes. L’Autriche est donc le principal vaincu de l’aventure : à la défaite stratégique s’ajoute une perte sensible de prestige international, au moment où de nouveaux acteurs d’avenir émergent sur la scène européenne avec la Prusse et la Russie. Moins maltraitée par les conditions de paix, cette dernière conserve un point d’accès à la mer Noire, ambition dont elle rêvait de longue date, mais ce faible bénéfice ne compense pas les lourdes pertes humaines et financières de trois années de lutte hasardeuse. De son côté, la France enregistre sans grands frais une authentique victoire diplomatique en préservant ses privilèges économiques en Orient et son système d’alliance de revers. Enfin, l’issue de la guerre démontre que la fragilité de l’empire ottoman a été largement surestimée par ses agresseurs. Même s’il ne s’agit que d’un coup d’arrêt dans la voie d’un déclin structurel, sa mise à mort prendra encore presque deux siècles…
Conclusion
En moins de 150 pages, Ferenc Tóth formule un tour d’horizon efficace et exhaustif d’un sujet sur lequel manquait une mise au point récente. Le résultat est convaincant, malgré la densité un peu rebutante des prolégomènes préalables au conflit. Le livre bénéficie aussi d’un louable souci d’illustration, qui pèche hélas par défaut de lisibilité (fac-similés sombres, plans peu lisibles et pas légendés, cartes sommaires). Énoncer ces inconvénients secondaires ne diminue pourtant nullement l’intérêt d’une lecture qui confirme le dynamisme des chantiers de l’histoire militaire de la période moderne.













