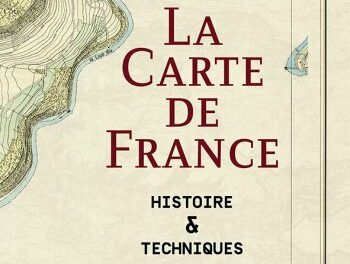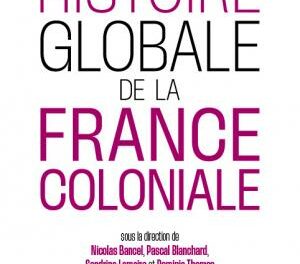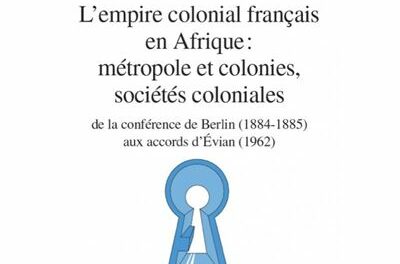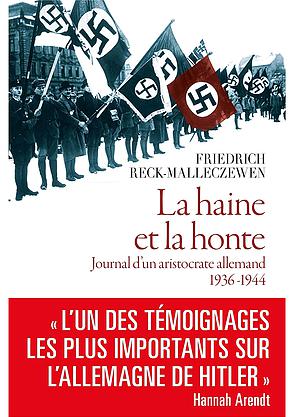
De 1936 à 1944, Friedrich Reck-Malleczewen, aristocrate antinazi allemand exilé de l’intérieur, consigne dans son journal intime, qu’il enterrait dans son parc, sa haine du nazisme et de Hitler, et sa honte de voir ce que les nazis font de l’Allemagne. Publié en 1947 sous le titre Journal d’un homme désespéré, mais passé inaperçu, l’ouvrage connaît le succès et de nombreuses rééditions grâce à Hannah Arendt, qui, dans Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil (1963), dit son admiration pour celui qu’elle considère, comme un opposant de la première heure à Hitler. Publié en 1968 par les Éditions du Seuil, dans une traduction d’Élie Gabey, il est réédité par la Librairie Vuibert, avec une reprise de la traduction et une éclairante préface de Pierre-Emmanuel Dauzat.
Un conservateur antinazi
Friedrich Reck-Malleczewen naît en 1884 en Prusse orientale (nord de la Pologne actuelle), dans le comté de Elk, sur le domaine de Malleczewen près du village de Maleczewo. Son père, député prussien conservateur au Landtag puis au Reichstag, est un Junker protestant membre de la noblesse terrienne. Sa mère, catholique autrichienne, vient d’une famille d’industriels originaires de Linz installés en Posnanie. Après des études de médecine et un mariage avec une jeune Russe, Friedrich Reck-Malleczewen voyage en Europe, en Amérique, en URSS et enfin en Afrique dans les années 1910-1920. Diabétique, il ne participe pas à la Première Guerre mondiale. Il abandonne assez vite la carrière médicale pour devenir chroniqueur littéraire de la Süddeutsche Zeitung à Stuttgart et homme de lettre. On lui doit une trentaine d’ouvrages : des récits de voyages, des romans (Sif, 1926 ; Bomben auf Monte Carlo, 1930, adapté quatre fois au cinéma) et des romans historiques allégoriques au sous-texte antinazi mais qui paraissent sans difficultés dans l’Allemagne nazie : ainsi Bockerlson. Histoire d’une hystérie collective, 1937, sur la terreur instaurée par les anabaptistes menés par Jan Bockelson – Jean de Leyde – à Münster en 1534-1539.
« Travaillant à mon livre sur la république des anabaptistes de Münster, je lis actuellement avec une profonde émotion les documents du Moyen Âge concernant cettre hérésie typiquement allemande qui, en tout point et jusque dans les détails les plus ridicules, annonce celle que nous vivons aujourd’hui. Tout comme l’Allemagne de nos jours, cette cité-État de Münster se sépare complètement, pour des années, du monde civilisé (…) et paraît invincible comme l’Allemagne nazie, pour finalement s’effondrer de façon inopinée (…). Là aussi, tout comme chez nous, le grand prophète est un raté, un bâtard pour ainsi dire conçu dans le ruisseau, comme chez nous toute résistance capitule devant lui à la stupéfaction du reste du monde (…). Ainsi donc, comme chez nous, ce sont des femelles hystériques, des maîtres d’école tarés, des prêtres défroqués, des proxénètes arrivés et le rebut de toutes les professions qui constituent le soutien principal de ce régime. (…) À Münster, exactement comme chez nous, le manteau de l’idéologie dissimule un noyau de luxure, d’avidité, de sadisme et d’histrionisme sans limites (…) » (p. 53)
Au milieu des années 1920, il acquiert un domaine en Bavière, où il s’installe en 1933, après son divorce et sa conversion au catholicisme, par foi et antinazisme : il est baptisé à Munich par le nonce Eugenio Pacelli, futur Pie XII. Il se remarie en 1938 avec Imgard von Borcke. Monarchiste et antinazi, il est surveillé par la Gestapo. En octobre 1944, il est arrêté et emprisonné une semaine pour ne pas s’être présenté à une convocation militaire pour être enrôlé dans un Volkssturm. En décembre, dénoncé par un éditeur de Munich, il est arrêté par la Gestapo pour « insulte à la monnaie allemande » et « dénigrement de l’État ». Transféré à Dachau en janvier, il meurt de maladie au Revier du camp en février 1945.
Entre haine et honte, une réflexion sur la décadence de l’Allemagne
Dans son journal, constitué d’une alternance d’anecdotes, de commentaires et de souvenirs du passé impérial allemand, Friedrich Reck-Malleczewen s’interroge sur le déclin de l’Allemagne, dont il rend responsable la Révolution française (créatrice de l’idée de Nation, du pouvoir de la bourgeoisie et de l’État), les Prussiens (l’unification de 1871 sous la houlette de la Prusse et l’État bismarckien) et les bourgeois, le nationalisme, les « masses abruties » et l’industrialisation qui défigure villes et campagnes :
« L’Allemagne est laide, stupide et l’épicentre de tous les séismes politiques qui se succèdent par cycles de vingt-cinq ans, à partir du moment où (…) par la fondation de l’Empire, œuvre de Bismarck, elle a permis aux territoires colonisés de gouverner et de mettre en tutelle la métropole . Depuis que l’oligarchie, qui elle au moins avait le sens des responsabilités, a disparu, depuis que l’on a commis à Versailles l’incroyable folie de détruire l’Autriche, unique obstacle à ce processus, et de conserver ainsi en vie l’éternel braillard du Nord, depuis ce temps, il a suffi de la rencontre de la voracité prussienne et d’un aventurier politique pour déclencher la grande catastrophe européenne que nous sentions tous venir. La lutte clandestine contre le nazisme menée avec acharnement, surtout en Allemagne du Sud, est en même temps une lutte contre la prussianisation et pour une structure de l’Allemagne conforme à sa nature. « (p. 78)
Il exprime aussi violemment sa haine profonde du nazisme
« Cela va faire cinq ans que je vis dans ce cloaque.
Voilà plus de quarante-deux mois que je me couche avec haine, que je rêve avec haine pour me réveiller avec haine. Je suffoque à l’idée d’être prisonnier d’une horde d’affreux babouins et je me casse la tête sur ce problème lancinant : comment le même peuple qui, il y a quelques années encore, était si jaloux de ses droits, a-t-il pu tomber du jour au lendemain dans cet état de léthargie où non seulement il tolère la domination des portefaix d’hier, mais – comble de la honte – n’est même plus capable de ressentir sa propre ignominie comme une ignominie… » (p. 56-57)
et d’Adolf Hitler, qu’il décrit en avril 1939 :
« Le voilà donc, la casquette profondément enfoncée sur le front, ressemblant assez à un receveur de tramway broché d’argent, les mains sur le ventre comme d’habitude ; voilà le dignitaire suprême. À travers la vitre, j’observe ce visage. Ce n’est qu’un tremblotement de bourrelets de graisse malsaine, tout pendouille, tout est avachi et sans anatomie, gélatineux, scorifié, maladif. Il n’y a pas le rayonnement, l’étincelle, la flamme d’u prophète, mais en revanche les stigmates de l’insuffisance sexuelle, la hargne de la demi-portion qui passe sa rage sur d’autres. Et malgré tout cela, ces ovations acharnées qui à la longue paraissent imbéciles ; tout autour des femmes hystériques, des adolescents en transe, un peuple entier dans l’état de derviches hurleurs. » (p. 116)
Friedrich Reck-Malleczewen crie aussi sa volonté de vengeance, sa conviction d’une punition divine qui remettra le monde en place, et sa honte du comportement du peuple allemand et des nazis :
« Mais qu’est-ce qui est en train de sortir de la tombe où nous pension que dormait la barbarie (…) ? (…) Et H. avec qui j’ai parlé aujourd’hui de la brutalité humaine ? Il revient du front oriental et a assisté au massacre de trente mille Juifs à K.
Un seul jour, en une seule heure, les munitions de mitrailleuses étant insuffisantes, on eut recours à des lance-flammes et de toute la ville les hommes qui n’étaient pas en service affluèrent pour participer à ce spectacle… De jeunes garçons au visage frais, des enfants d’hommes qui eux aussi, il y a dix-neuf ou vingt ans, ont été couchés dans un berceau, poussant des cris de joie en essayant d’atteindre une tache de soleil ! Ô honte, ô vie sans honneur, mince écorce qui nous sépare du noyau secret de la terre où brûlent les sombres flammes de Satan ! » (en octobre 1942, p . 222).
Admirateur de la monarchie bavaroise, Friedrich Reck-Malleczewen s’affirme comme penseur de la décadence allemande, décrite en termes biologiques et médicaux. Dans son exécration absolue, émergent quelques admirations, pour Hans et Sophie Scholl en particulier :
«… ils ont versé leur jeune sang comme des justes, avec une dignité sublime. (…) Que sur leur tombe s’inscrive en lettres de feu cette phrase qui un jour fera rougir ce peuple vivant dans la honte depuis dix ans : Cogi non potest quisquis mori scit… (« Qui sait mourir ne peut être asservi »).
Ne faudra-t-il pas un jour que, honteux, nous allions tous en pélerinage sur leur tombe ?
Voilà ce qu’i en est de ces jeunes gens, les derniers et, si Dieu veut, les premiers Allemands d’un grand mouvement de régénération. » (mars 1943, p. 239-240)
En revanche, au nom de cette régénération qu’il appelle de ses voeux, il dénonce les généraux du putsch (dont il déplore l’échec) de 1944, dans lesquels il voit des « mandataires de cette hérésie prussienne » :
« Ma pensée se meut dans la ligne d’un conservatisme assurément disparu en Allemagne, j’ai été conçu monarchiste, élevé en monarchiste, l’existence de la monarchie est nécessaire à mon bien-être physique. Et je vous hais, non pas en dépit, mais à cause de cela. Catins de toute conjoncture politique à votre avantage, renégats de votre passé, tristes concubins de cette oligarchie industrielle avec la volonté de puissance de laquelle a commencé la désagrégation de nos structures économiques et politiques, pauvres planificateurs de cette expédition avortée de brigandage en Russie, organisée pour le compte de Krupp et consorts et dont la planification constitue un sommet de dilettantisme et d’ignorance géopolitique.
Ignorant toute loi morale, sinistres champions de tout ce qui défie Dieu et l’esprit. Non, plus encore, contempteurs de tout ce qui est beau, de tout ce qui se dérobe à votre plat utilitarisme prussien. » (juillet 1944, p. 256-257)
En lisant ce journal tourmenté, écrit dans le style flamboyant d’un redoutable pamphlétaire, on pense à de grandes plumes contemporaines comme celle d’un André Suarès, autre pourfendeur des dictatures. Ce réquisitoire violent se révèle un document important sur l’Allemagne du premier XXe siècle et sur ceux qui résistèrent, à leur façon et dans le camp moins souvent évoqué des patriotes conservateurs, contre le totalitarisme nazi
« N’est-ce pas le comble d’une situation tragique, d’une honte inconcevable, que justement les meilleurs Allemands survivants qui depuis douze ans sont les prisonniers d’une horde de macaques, doivent espérer, implorer la défaite de leur patrie par amour de celle-ci ? » (octobre 1944, p. 265)