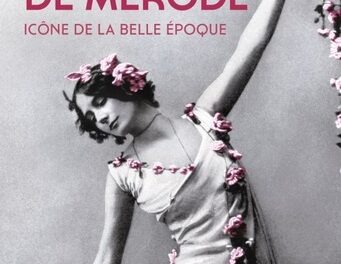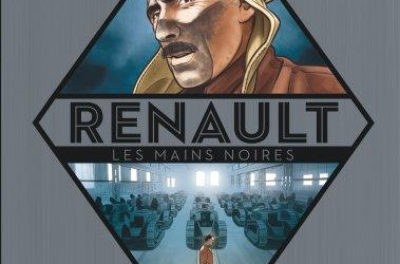Des bases de l’alimentation selon les catégories sociales au phénomène culturel de la cuisine française, Florent Quellier entrâine le lecteur vers un univers cher aux Français, la table.
Faire l’histoire de l’alimentation
L’alimentation est un fait biologique bien sûr. Mais aussi un fait social : Riches et pauvres ne mangent pas les mêmes plats et n’apprécient pas la même cuisine. C’est aussi un fait culturel et historique. Les aliments ont largement circulé au fil des siècles donnant naissance à des recettes dites traditionnelles mais dont l’histoire est relativement récente. Chaque pays, d’autre part, a ses traditions dont certaines s’exportent, tout en changeant, telle la pizza ou le hamburger au XX° siècle. Une histoire de l’alimentation est donc possible et nécessaire et c‘est ce à quoi s’attelle Florent Quellier dans ce livre qui l’étudie du XV° au XIX° siècle.
Une histoire sociale de l’alimentation
Plusieurs chapitres de l’ouvrage portent sur les différences d’alimentation entre les masses populaires qui constituent la majorité de la population et les élites. Les premières doivent, la plupart du temps, se contenter pour l’essentiel de pain, de soupe et d’un peu de lard. Avec des apports régionaux différents cependant : châtaignes, poissons et fruits de mer, maïs plus tardivement, produits laitiers parfois… Leur régime est fortement déséquilibré en tout cas. Les élites, on s’en doute, ont un régime fort différent dans lequel entre en compte la volonté de se distinguer des masses ainsi que celle d’affirmer son rang. D’où un temps des dépenses ostentatoires pour se procurer des épices (clou de girofle, cannelle, poivre, noix de muscade, gingembre…). Puis, à partir de la Renaissance, une nouvelle cuisine française, avec moins d’épices, moins de sucré-salé, un dosage moindre de l’acidité, l’introduction du beurre dans les sauces… Les viandes sont moins cuites et les fruits et légumes plus mis en avant. Par ailleurs, un art de la cuisine et des manières de table s’affirme. Les boissons, elles aussi, divergent et le vin des couches populaires, rare, n’est pas celui des élites qui, à l’époque moderne, sont conquises par les nouveaux produits diffusés depuis l’Amérique en voie de colonisation : sucre, café, chocolat. Même si le café se diffuse peu à peu.
S’alimenter, entre contraintes et opportunités
Manger c’est aussi respecter des rythmes. Celui des saisons bien sûr qui fait de la soudure un temps d’angoisse. Rythme imposé par l’importance des récoltes qui peut déboucher sur un manque criant voire des famines. Mais aussi calendrier religieux qui impose des temps maigres. En effet, l’Église « impose des périodes de privation soit totale de nourriture, le jeûne, soit de certains aliments, l’abstinence ou jour maigre ». Les temps de fêtes (familiales, villageoises ou religieuses) en sont d‘autant plus appréciés avec des festins bienvenus.
D’autres éléments entrent en compte pour comprendre comment s‘alimentaient les Français. Tout d’abord, l’importance du don perdure dans la société d’Ancien Régime. Il peut être lié à l’entraide dans le travail, à la charité, au clientélisme, à l’amitié, à des échanges précédents… Or, une « grande partie des dons, notamment les plus quotidiens, est constituée de nourriture et de boisson ». Par ailleurs, l’autoconsommation joue un rôle significatif et la monarchie essaie d’éviter les pénuries.
Enfin, certains aliments sont jugés malsains ou suscite le dégoût (parfois alimenté par des rumeurs). Ainsi, « la viande chevaline traîne une très mauvaise réputation sanitaire ; elle serait au pire malsaine, au mieux immangeable ».
Et vive le métissage culturel !
La « découverte » de l’Amérique, c’est on le sait accompagnée de massacres et d’une terrible hémorragie des populations. Outre l’argent des mines de Potosi, les Européens ont ramené nombre de plantes de ce continent et ils y en ont acclimaté d’autres. « Sans le Nouveau Monde, nos actuels gratin dauphinois, tartiflette, cassoulet, piperade, poulet à la basquaise et autres ratatouilles n’existeraient pas ou auraient un autre goût, une autre odeur et d’autres couleurs ». La pomme de terre, même si elle a longtemps « mauvaise réputation », se fraie peu à peu un passage en France, plus tardivement cependant que dans d’autres pays. Le Nouveau Monde, par ailleurs, a favorisé « un premier boom sucrier » qui a permis d’adoucir le café que les Européens ont introduit en Amérique et qui s’est diffusé sur le vieux continent.
Se mettre à table
Mais où mangeait-on ? L’auteur nous indique qu’à de rares exceptions (couvents…) il n’existait pas de lieux exclusivement dédiés à la préparation et consommation des repas dans les milieux populaires. Parmi les élites, les lieux de cuisine et de repas sont différenciés mais longtemps il n’y pas de lieu réservé aux repas. Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que « les demeures aristocratiques se pourvoient systématiquement d’une salle à manger et d’une table à pieds fixes ». Horreur cependant !!! Ces élites mangeaient le plus souvent tiède sinon froid du fait de l’éloignement des cuisines de la salle du repas et car le service à la française, qui visait à impressionner les convives, faisait que de nombreux plats étaient déposés en même temps sur la table. Et ce pauvre Louis XIV devait attendre que les plats aient parcouru 400 m avant qu’il puisse y goûter.
Un livre dense, riche qui retiendra l’attention de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de la gastronomie et de l’alimentation, part importante de la vie des femmes et des hommes. De nombreuses citations permettent, par ailleurs, de s’imprégner des façons de voir des Français de l’époque moderne.