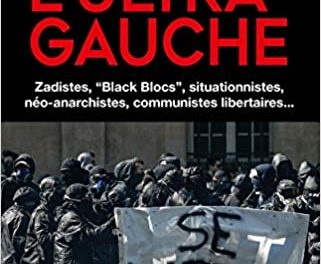L’Amérique latine figure comme la grande absente de l’historiographie de la Première Guerre mondiale. Et cette dernière est laissée de côté par les historiens de l’Amérique latine. Ce sont les deux constats, forts, que dresse Olivier Compagnon, professeur d’histoire contemporaine de l’Amérique latine à l’université de Paris III- Sorbonne nouvelle, au début de son nouvel opus. Auteur de nombreux ouvrages, dont, en 2003, un remarqué «Jacques Maritain et l’Amérique latine. Le modèle malgré lui», l’historien s’insurge contre «l’ostracisme dont la dimension latino-américaine de la Grande Guerre est victime dans l’historiographie» alors qu’on constate «son omniprésence dans les innombrables sources disponibles sur la période». (p.13) Citons par exemple Alceu Amoroso Lima, l’une des figures dominantes du catholicisme brésilien entre les années 1920 et 1970, selon lequel toute notre génération est divisée par la Première Guerre mondiale, qui pour nous continue d’être la guerre (p. 18).
L’ouvrage, qui entend essentiellement analyser l’impact du premier conflit mondial sur les questionnements identitaires caractérisant le premier XXè siècle latino-américain, s’articule autour de trois grands axes.
De la neutralité politique au malaise face à l’embrasement :
Dans un premier temps, qui occupe une bonne moitié du livre, il est question d’étudier la façon dont les deux pays perçoivent le conflit qui éclate en Europe et les positions contrastées qui sont adoptées respectivement par les gouvernements et au sein des élites d’Argentine et du Brésil. La neutralité est décrétée par tous les gouvernements latino-américains dès le début de la guerre, le 4 août par le Brésil, le 5 par l’Argentine. Les raisons économiques de la neutralité sont patentes : «une déclaration de guerre, que ce soit en faveur de l’Entente ou de l’Alliance, conduirait à s’aliéner des partenaires de première importance, fragiliserait la croissance économique et hypothéquerait le processus de modernisation en cours» (p. 49). Compte tenu également du poids de certaines communautés d’origine immigrée, italienne pour l’Argentine, allemande pour le Brésil, on se dit que la neutralité peut aider à préserver l’unité de la nation et à «désamorcer de possibles crispations communautaires». (p. 56) .
L’enlisement rapide du conflit correspond à l’émergence de courants d’opinion qui s’affirment en faveur de l’un et l’autre camp. Peu après le déclenchement du conflit, la majorité des intellectuels argentins et brésiliens se montrent «alliadophiles» , favorables à l’Entente. Globalement, la presse porteña (de Buenos Aires) et celle du Brésil se montrent favorables à l’Entente, notamment en raison du fait que les propriétaires des journaux, membres des élites traditionnelles, n’entendent pas froisser la Grande-Bretagne, premier partenaire commercial et financier, et que les agences de presse internationales qui alimentent les quotidiens latino-américains, Havas et Reuters sont «des relais essentiels de la propagande de l’Entente dès les premiers mois de la guerre» (p. 68). Des revues culturelles, comme Nosotros en Argentine, ou des groupes de pression, comme la LBA (Liga Brasileira pelos Aliados), s’affichent également en faveur des Alliés, et plus particulièrement de la France. De même, 1200 à 1800 Latino-américains, dont au moins 1000 Argentins et Brésiliens, s’engagent effectivement aux côtés de la France. On a pu dire, en revanche, que la mobilisation des nationaux des pays en guerre a été un relatif échec ; Olivier Compagnon souligne justement que de «nombreux facteurs contribuent à expliquer ce que les gouvernements européens perçurent fondamentalement comme un refus de l’impôt du sang. D’une part, certains pays comme l’Italie rencontrèrent d’importantes difficultés pour recenser avec précision les hommes mobilisables, diffuser l’information à l’échelle locale et organiser le transport des futurs soldats. D’autre part, la croyance répandue selon laquelle la guerre serait courte freina les ardeurs de retour à une époque où les temps de voyage en bateau entre Rio, Santos ou Buenos Aires et l’Europe étaient encore de l’ordre de trois à quatre semaines. Et, au fur et à mesure que la guerre s’enlisa, les informations triomphalistes perpétuellement diffusées par la propagande des belligérants, laissant miroiter une victoire imminente, ne contribuèrent pas à motiver les mobilisables.» (pp. 107-108)
Le conflit a des conséquences tangibles sur les économies et le commerce des pays d’Amérique latine : inflation, réduction drastique, voire suppression, des prêts bancaires et des flux d’IDE en provenance d’Europe, les secteurs agro-exportateurs argentins (blé, viande) tirent toutefois leur épingle du jeu au contraire du Brésil (crise du secteur caféier). Par ailleurs, les répercussions sociales sont notables, avec la multiplication des grèves, liées à la hausse des prix alimentaires de base, à la baisse des salaires ou à une contestation d’origine socialiste contre la guerre. Mais ces mouvements sont fortement réprimés par les gouvernements.
En 1917, la guerre sous-marine à outrance décrétée par l’Allemagne et l’entrée en guerre des Etats-Unis contribuent à remettre en cause la neutralité des Etats : c’est vrai pour le Brésil qui entre en guerre en octobre 1917, ça ne l’est pas pour l’Argentine qui se cramponne à sa neutralité, «bienveillante» toutefois pour les Alliés… L’entêtement du président argentin Yrigoyen provoque la fureur des « rupturistas». majoritaires, qui veulent mettre un terme à la neutralité.
L’Europe : une désillusion :
Dans un second temps, l’auteur consacre donc deux chapitres à« une forme de désillusion» (p. 160) qui saisit les élites brésiliennes et argentines dans leur appréhension de l’Europe comme modèle. On prend en effet rapidement conscience des horreurs de la guerre dont la diffusion par la presse ou d’autres medias laisse son empreinte bien après la fin du conflit. Ainsi, par exemple,« en 1932, Carlos Gardel compose [en collaboration] Silencio en la noche en hommage au président de la République française Paul Doumer -assassiné à Paris cette même année-, qui avait perdu quatre de ses cinq fils à la guerre. Entre dénonciation de l’absurdité du carnage et évocation de l’impossible deuil, ce succès populaire qu’on entend encore parfois dans les bars de Buenos Aires ancre profondément la guerre dans les mémoires argentines» (p. 181). Le poète brésilien Mario de Andrade a parfaitement résumé, par un vers de son poème Devastação, l’impression que l’Europe n’est plus, pour beaucoup, un modèle : Ici fut, jadis, la civilisation (cité p. 193).
Bon nombre d’intellectuels pensent donc devoir espérer en la capacité des pays d’Amérique latine d’inventer un nouveau modèle qui s’affranchirait à la fois du modèle européen que la Grande Guerre a, semble-t-il, remisé au rang des articles périmés et du modèle états-unien souvent redouté. Les élites s’interrogent sur la meilleure façon d’insérer la nation dans le monde américain, cette nation qui occupe tant le devant de la scène politique et culturelle des années 1920 et 1930 en Amérique latine : c’est l’objet du troisième temps de la démonstration d’Olivier Compagnon qui souligne combien l’omniprésence de la nation plonge ses racines dans la période de la Grande Guerre.
Les gouvernements argentins, qu’ils soient démocratiques ou issus d’un coup d’Etat (comme c’est le cas en 1930 avec l’accession du général Uriburu à la tête de l’Etat), ou brésiliens, dans le contexte de lente agonie de la République oligarchique née en 1889 ou du régime autoritaire de Getulio Vargas, entendent fortifier la nation, en développant l’éducation physique dans les écoles et en luttant contre tout ce qui serait susceptible de menacer la cohésion nationale : on restreint ainsi l’immigration dans les années 1930, comme une suite logique des politiques qui s’en prenaient à quelques symboles forts du «communautarisme» dans les années 1914-1918 (suppression de l’enseignement de l’italien dans les écoles argentines par le président Yrigoyen en 1917, interdiction la même année de l’usage de l’allemand dans les actes publics au Brésil…). Le catholicisme s’affirme dans le même temps comme l’un des soutiens majeurs des politiques de renforcement des «identités nationales», que ce soit au Brésil, avec le national-catholicisme d’un Jackson de Figueiredo, ou en Argentine.
«L’heure de l’épée» semble également venue, pour reprendre le titre d’un discours de l’argentin Leopoldo Lugones, fondateur, en 1933, du groupe de pression paramilitaire «Guardia argentina». Au Brésil, Olavo Bilac impulse «un vaste mouvement en faveur du service militaire obligatoire et de la promotion d’une éducation civique exaltant l’amour de la patrie censé accoucher d’une conscience nationale rénovée». (p. 264) La Première Guerre mondiale a en effet montré, aux yeux de nombre d’intellectuels appelant de leurs vœux une «révolution identitaire», qu’une nation incapable de se défendre est condamnée à demeurer une nation faible : «Le culte de l’ordre et de l’autorité qui marque de son empreinte l’entre-deux-guerres en Argentine et au Brésil apparaît [donc] comme le corollaire de la vocation renouvelée qu’on attribue aux forces armées à l’issue de la Première Guerre mondiale». (p. 266)
Dans le domaine des arts, le Brésil et l’Argentine émergent comme espaces d’une «culture combative» (p. 280), visant à se distinguer -et s’autonomiser- du champ culturel international. La semaine d’art moderne en 1922, qui fonde le nationalisme culturel brésilien, en fournit par exemple un exemple éloquent. Il ne faut cependant pas surestimer cette volonté d’émancipation culturelle vis-à-vis de l’Europe, dans la mesure où «les principales capitales européennes -Paris au premier chef- demeurent des lieux fondamentaux de légitimation culturelle et des passages obligés pour quiconque entend faire carrière en dehors d’étroites frontières provinciales». (p. 293)
Nationalisme ou roman national :
On assiste enfin dans l’entre-deux-guerres à une redécouverte du passé colonial tant en Argentine qu’au Brésil. Le discours nationaliste fait de l’hispanité «l’origine mythique de la nation argentine» (p. 297) tout en valorisant l’identité «gauchesca» et les apports migratoires du tournant du XXè siècle. En 1917, déjà, le radical Yrigoyen avait fait du 12 octobre (le jour où Colomb posa le pied à Hispaniola) le «dia de la raza», un jour férié… Au Brésil, la redécouverte du passé colonial se fait davantage dans une optique patrimoniale car «la nécessité d’intégrer au nouveau roman national les composantes indiennes et africaines de la population est incompatible avec une héroïsation exclusive des vertus du peuple portugais dans le Nouveau Monde». (p. 298)
On l’aura compris, le livre d’Olivier Compagnon, passionnant, fort bien écrit et étayé par un appareil critique copieux, forme un jalon essentiel dans le processus de réinsertion de la Grande Guerre dans l’historiographie latino-américaniste ainsi que de l’Amérique latine dans l’historiographie de la Grande Guerre. Il est heureux qu’il ait déjà reçu un large écho, positif. L’essai, ambitieux, ne manquera pas d’ouvrir de nouvelles perspectives, tant les pistes de recherche qu’il propose sont nombreuses et très convaincantes, notamment sur la question de savoir si la Première Guerre mondiale peut être envisagée «comme l’une des matrices du renouvellement des débats sur la construction nationale outre-Atlantique» (p. 18). Il offre également à nos collègues, notamment à ceux qui enseignent en DNL espagnol, un excellent point d’appui pour renouveler le cours sur la Grande Guerre.