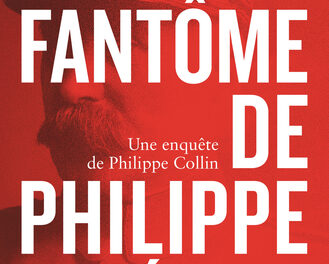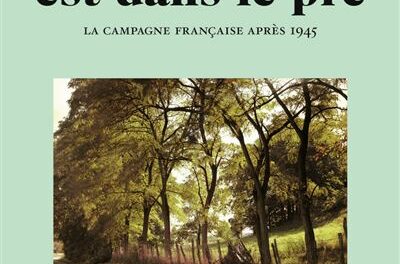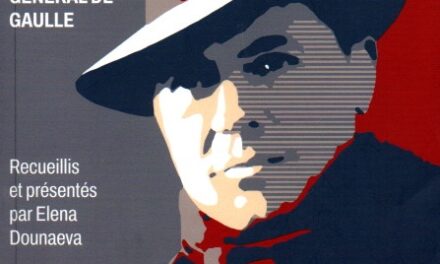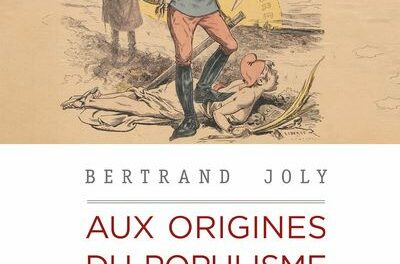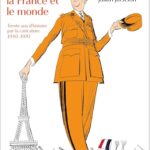Napoléon et ses batailles, voilà un thème classique que remet à l’honneur Jacques Garnier. Ce spécialiste de l’histoire militaire de l’Empire, auteur d’un Austerlitz remarqué par la Fondation Napoléon, nous livre ici une étude des talents militaires de l’Empereur. La mention biographique dans le titre de l’ouvrage renvoie davantage à un plan plutôt chronologique qu’à une quelconque biographie de l’empereur des français. Le but de l’ouvrage est d’éclairer le lecteur sur les fondements des principes militaires napoléoniens depuis les premières campagnes d’Italie jusqu’à Waterloo mais sans faire un récit de toutes les batailles et campagnes.
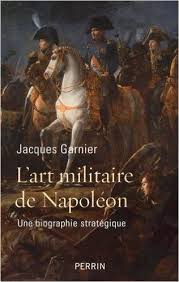
Jacques Garnier a sélectionné celles qui permettent de mieux appréhender les caractéristiques de la guerre selon Napoléon.
De la manœuvre sur position centrale à la marche en bataillon carré
Le grand classique de la manœuvre napoléonienne est ici présenté à travers plusieurs exemples, de la réussite des campagnes d’Italie de 1796-1797 à l’échec de la campagne de 1815. Le principe général reste le même. Face à un adversaire supérieur en nombre mais dont les forces ne sont pas groupées, on mise sur la vitesse pour séparer l’ennemi. On va ainsi surprendre un de ses éléments et acquérir une supériorité locale qui permet de le battre. Une fois la première force défaite et en retraite, Napoléon peut ensuite se retourner contre une autre pour la battre. Il aborde ainsi chaque bataille en position de force alors qu’au niveau stratégique il est plutôt en situation d’infériorité. Cela lui réussit à merveille en 1796-1797. Cela explique les nombreux succès tactiques de 1814 qui ne permettent cependant pas de retourner une situation stratégique trop déséquilibrée. Enfin cela ne marche plus à Waterloo où Wellington et Blücher s’attendent à la manœuvre et c’est plutôt Napoléon qui se prend à son propre jeu persuadé de sa réussite.
La marche en bataillon carré expérimentée lors de la campagne de 1806 contre la Prusse consiste à faire progresser l’armée sur des routes parallèles pour faciliter l’écoulement des forces. Mais à une distance telle que les colonnes peuvent se soutenir mutuellement en moins d’une journée de marche et ainsi éviter toute mauvaise surprise. Ainsi l’armée française peut déboucher rapidement sur la Saale et surprendre les Prussiens obligés de battre en retraite.
Surprendre l’adversaire pour l’obliger à accepter le combat en position difficile est une des constantes des pratiques napoléoniennes dont la meilleure illustration est la manœuvre de 1805 qui provoque la capitulation sans combat du général Mack à Ulm. La manœuvre sur les arrières de l’ennemi, si elle réussit, a des effets immédiats. Si l’ennemi l’ignore comme en 1814, elle ne peut empêcher la défaite stratégique.
La marche en bataillon carré expérimentée lors de la campagne de 1806 contre la Prusse consiste à faire progresser l’armée sur des routes parallèles pour faciliter l’écoulement des forces. Mais à une distance telle que les colonnes peuvent se soutenir mutuellement en moins d’une journée de marche et ainsi éviter toute mauvaise surprise. Ainsi l’armée française peut déboucher rapidement sur la Saale et surprendre les Prussiens obligés de battre en retraite.
Surprendre l’adversaire pour l’obliger à accepter le combat en position difficile est une des constantes des pratiques napoléoniennes dont la meilleure illustration est la manœuvre de 1805 qui provoque la capitulation sans combat du général Mack à Ulm. La manœuvre sur les arrières de l’ennemi, si elle réussit, a des effets immédiats. Si l’ennemi l’ignore comme en 1814, elle ne peut empêcher la défaite stratégique.
De nombreuses innovations
Sur le plan technique, on peut dire que la période impériale apporte peu de changements. Les armées napoléoniennes bénéficient des réflexions engagées par l’armée d’Ancien régime dans la deuxième moitié du 18e siècle. Elles ont permis la mise au point du fusil modèle 1777 et surtout du système d’artillerie Gribeauval. Napoléon, comme les autres officiers français formés sous l’Ancien régime a pu comparer les arguments des partisans de l’ordre profond et de l’ordre mince, et s’en inspirer pour son ordre mixte.
L’innovation est cependant présente dans la manière de combattre. Avant la bataille, la reconnaissance a toute son importance. Les campagnes sont préparées par un travail important de recherche de renseignements sur les forces adverses et le terrain. Les cartes font l’objet de soins particuliers. L’outil militaire napoléonien repose sur le corps d’armée, structure interarmes souple rassemblant plusieurs divisions d’infanterie et un support de cavalerie, et donc capable de ralentir un ennemi. Voire s’il est brillamment commandé de défaire des forces ennemies supérieures comme le fit Davout à Auerstedt. Ces corps peuvent être regroupés en armées. Mais si la Grande Armée commandée par Napoléon est un outil efficace, les armées commandées par ses maréchaux le sont beaucoup moins, faute de talents et minées par les rivalités.
La coordination entre les différentes armes sur le champ de bataille est encouragée tandis que l’emploi de celles-ci évolue. Pour donner plus d’impact à la cavalerie, Napoléon institue des corps de cavalerie de réserve regroupant les unités de cavalerie lourde, destinées à emporter la décision comme à Eylau. Mais qui peuvent être inefficaces s’ils son mal employés comme ce fut le cas à Waterloo. Des assauts souvent préparés par l’artillerie dont les forces françaises firent un emploi massif, pratiquant de plus en plus souvent un regroupement de pièces en grande batterie destinée à pilonner l’ennemi avant l’attaque.
L’innovation est cependant présente dans la manière de combattre. Avant la bataille, la reconnaissance a toute son importance. Les campagnes sont préparées par un travail important de recherche de renseignements sur les forces adverses et le terrain. Les cartes font l’objet de soins particuliers. L’outil militaire napoléonien repose sur le corps d’armée, structure interarmes souple rassemblant plusieurs divisions d’infanterie et un support de cavalerie, et donc capable de ralentir un ennemi. Voire s’il est brillamment commandé de défaire des forces ennemies supérieures comme le fit Davout à Auerstedt. Ces corps peuvent être regroupés en armées. Mais si la Grande Armée commandée par Napoléon est un outil efficace, les armées commandées par ses maréchaux le sont beaucoup moins, faute de talents et minées par les rivalités.
La coordination entre les différentes armes sur le champ de bataille est encouragée tandis que l’emploi de celles-ci évolue. Pour donner plus d’impact à la cavalerie, Napoléon institue des corps de cavalerie de réserve regroupant les unités de cavalerie lourde, destinées à emporter la décision comme à Eylau. Mais qui peuvent être inefficaces s’ils son mal employés comme ce fut le cas à Waterloo. Des assauts souvent préparés par l’artillerie dont les forces françaises firent un emploi massif, pratiquant de plus en plus souvent un regroupement de pièces en grande batterie destinée à pilonner l’ennemi avant l’attaque.
Des faiblesses ?
L’auteur récuse l’idée d’un Napoléon qui ne serait à l’aise que dans la manœuvre opérationnelle ou stratégique et beaucoup moins dans la gestion tactique de la bataille. Pour cela il s’appuie sur la bataille d’Austerlitz, reconnue comme le chef d’œuvre du maître, à laquelle il consacre un chapitre entier.
Il est cependant beaucoup moins convaincant lorsqu’il illustre son propos avec la manière dont les lanciers polonais prirent le col de Somosierra ou celle dont la cavalerie française prit les redoutes de Borodino. Au fur et à mesure que la période avance, les batailles mettent face à face des effectifs de plus en plus nombreux, largement pourvus en artillerie, et deviennent des affrontements frontaux où la décision n’est emportée qu’au prix de lourdes pertes. On s’éloigne de d’un modèle de bataille idéal.
La principale faiblesse du système militaire napoléonien est avant tout sa dépendance à la personne de Napoléon. Lorsqu’il n’est pas là, cela ne fonctionne plus. On le voit en Espagne mais également au début de la campagne de 1809 ou de celle 1813 lorsque Napoléon essaie de diriger à distance son armée par l’intermédiaire d’Eugène de Beauharnais. Or le nombre des adversaires, l’étendue des fronts, ne permet pas à l’Empereur d’être partout. Ses adversaires l’ont compris, on le voit quand en 1813 ils privilégient l’affrontement avec ses maréchaux. Et, jusqu’à Leipzig, refusent au maximum le combat face à l’Empereur. Tandis que la dépendance aux ordres impériaux bride les officiers supérieurs à l’image de Grouchy en 1815. En privilégiant les composantes de l’art militaire napoléonien, l’auteur laisse cependant de côté les travers qui peuvent être liés à la personne de l’empereur.
Il est cependant beaucoup moins convaincant lorsqu’il illustre son propos avec la manière dont les lanciers polonais prirent le col de Somosierra ou celle dont la cavalerie française prit les redoutes de Borodino. Au fur et à mesure que la période avance, les batailles mettent face à face des effectifs de plus en plus nombreux, largement pourvus en artillerie, et deviennent des affrontements frontaux où la décision n’est emportée qu’au prix de lourdes pertes. On s’éloigne de d’un modèle de bataille idéal.
La principale faiblesse du système militaire napoléonien est avant tout sa dépendance à la personne de Napoléon. Lorsqu’il n’est pas là, cela ne fonctionne plus. On le voit en Espagne mais également au début de la campagne de 1809 ou de celle 1813 lorsque Napoléon essaie de diriger à distance son armée par l’intermédiaire d’Eugène de Beauharnais. Or le nombre des adversaires, l’étendue des fronts, ne permet pas à l’Empereur d’être partout. Ses adversaires l’ont compris, on le voit quand en 1813 ils privilégient l’affrontement avec ses maréchaux. Et, jusqu’à Leipzig, refusent au maximum le combat face à l’Empereur. Tandis que la dépendance aux ordres impériaux bride les officiers supérieurs à l’image de Grouchy en 1815. En privilégiant les composantes de l’art militaire napoléonien, l’auteur laisse cependant de côté les travers qui peuvent être liés à la personne de l’empereur.
En conclusion
Une très bonne synthèse qui passe en revue les grandes lignes de force des combats de l’époque. L’étude évite de sombrer dans les détails inutiles et fournit à ceux qui veulent approfondir une bibliographie commentée. Même si celle-ci aurait cependant mérité d’être un peu plus étoffée. Enfin, et c’est très appréciable, l’ouvrage comprend de nombreuses cartes de qualité qui permettent une vraie compréhension des analyses de Jacques Garnier.Compte-rendu de François Trébosc, professeur d’histoire géographie au lycée Jean Vigo, Millau
Une très bonne synthèse qui passe en revue les grandes lignes de force des combats de l’époque. L’étude évite de sombrer dans les détails inutiles et fournit à ceux qui veulent approfondir une bibliographie commentée. Même si celle-ci aurait cependant mérité d’être un peu plus étoffée. Enfin, et c’est très appréciable, l’ouvrage comprend de nombreuses cartes de qualité qui permettent une vraie compréhension des analyses de Jacques Garnier.Compte-rendu de François Trébosc, professeur d’histoire géographie au lycée Jean Vigo, Millau