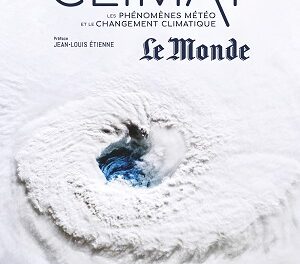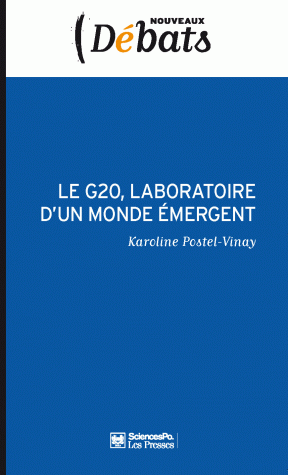
Karoline Postel-Vinay est directrice de recherche au Centre de Recherche et de Recherches Internationales (CERI) de Sciences Po Paris. Elle est spécialisée dans les questions d’intégration régionale, notamment asiatique, et a élargi sa réflexion aux questions de représentations du monde. Elle se pose dans cet ouvrage la question de savoir à quoi sert le G20. En effet, la crise qui sévit depuis 2008 pose un éclairage cru sur la gouvernance mondiale, et dans ce cadre Karoline Postel-Vinay s’interroge sur les ambitions et l’action de cette organisation. Cette crise a en effet donné une visibilité accrue au G20, transformant une organisation informelle en « sommet d’Etats », posant les questions de légitimité, de compétence et d’efficacité de tels sommets. Au-delà des aspects formels, Karoline Postel-Vinay expose comment les « G » s’imposent et remettent en question nos perceptions des relations internationales et de la gouvernance mondiale.
Un groupe à géographie variable
Dans la densification croissante de l’architecture institutionnelle des relations internationales, la détermination de ce « G » ne va pas de soi. Le premier mérite de Karoline Postel-Vinay est de nous introduire à la « constellation des G », d’en proposer une généalogie éclairante sur les hésitation et le très fort empirisme qui est au coeur de la construction des groupe d’Etats. Pour ce qui est du G20, c’est un groupe parmi d’autres qui repose initialement sur des rencontres régulières de 14, puis 22, puis 33 ministres des finances et gouverneurs de banques centrales. Ces rencontres sont issues du groupe de Manille qui essayait à l’initiative des Etats-Unis entre 1997 (G22) et 1999 (G33) de faire face aux conséquences de la crise asiatique. Karoline Postel-Vinay propose une cartographie bien commode de ces différents groupes qui, associée à une chronologie et une solide bibliographie, ne manquera pas de rendre de grands services et d’alimenter le débat. On est loin des organisations intergouvernementales (ONU, OMC) ou régionales (Union européenne) dont la négociation d’un statut juridique précède la mise en oeuvre. L’hésitation même qui préside à la définition de sa « structure » en « sommet » ou en « réseau » [p. 44] témoigne bien du problème au départ formel mais dont les conséquences géopolitiques et géoéconomiques sont indéniables.
L’indétermination numérique du G20 souligne le caractère très plastique voire « improvisé » de l’organisation de la puissance économique dont le maître-mot semble être devenue « l’émergence » : la liste des membres du groupes évolue en fonction du poids relatif accordé à un Etat dans l’économie mondiale, tenant compte de son PNB mais également du critère discutable de sa « représentativité régionale » [p. 11] ou de leur importance « sur le plan systémique » [p. 31].
Sa composition n’est pas totalement arbitraire, mais elle reprend essentiellement les pays que les investisseurs internationaux ont mis en avant comme économies émergentes : les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine), VISTA (Vietnam, Indonésie, Afrique du Sud, Turquie et Argentine), CIVETS (on ajoute la Colombie et on retranche l’Argentine de la liste) ou MIST (Mexique, Indonésie, Corée du Sud et Turquie). Ces listes qui varient elles-mêmes sont validées par les ministres des Finances du G8 qui adressent les invitations Au final le G20 se compose des Etats-Unis, du Canada, du Mexique du Brésil et de l’Argentine en Amérique ; de l’UE, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni en Europe (et la Turquie), de l’Afrique du Sud, de l’Arabie Saoudite ; pour l’Asie de l’Inde, la Chine, l’Indonésie, le Japon et la Corée du Sud ; la Russie ; l’Australie enfin. On peut donc signaler la plus ou moins forte représentation des différentes régions du monde (l’Afrique du Sud est le seul Etat africain) et remarquer que l’UE est la seule organisation régionale admise dans ce cadre., arbitraire relativement masqué par la revendication d’une importance « systémique » qu’on est bien en peine de définir [p. 118]. Cela permet de dépasser l’opposition entre G8 et G77 en invitant de nouveaux pays à la table des puissants, mais pose tout de même un sérieux problème de légitimité de ces rencontres. Il est intéressant comme le fait Karoline Postel-Vinay de comparer les caractères du G20 par rapport au G8 : on passe de la moitié aux trois-quarts du PIB mondial, de la moitié aux deux tiers de la quote part du FMI et d’un peu plus de 10 à plus de 60 % de la population mondiale, on agrège d’importants bénéficiaires de l’Aide Publique au Développement à ses principaux donateurs. Le changement semble radical mais il permet surtout de souligner la concentration croissante du développement et le renforcement des inégalités mondiale si l’on compare les pays membres du G20 au G172 (ou 174) des autres qui n’en sont pas. La question de la fracture Nord-Sud se trouve dans les faits déplacée vers la problématique des inégalités globales dans le cadre de la mondialisation.
Ainsi le G20 a-t-il « simplifié » la carte économique du monde en retranchant la Côte d’Ivoire de sa liste (ce qui peut encore se concevoir si l’objectif est de tenir compte du poids économique relatif), mais également Singapour ou Hong-Kong, découplant la puissance économique de l’influence géoéconomique (par exemple en comparaison de l’Afrique du Sud ou de l’Argentine). Les pays européens exclus (Belgique, Espagne) obtiennent un lot de consolation : le siège de l’UE. On retrouve cette « géographie variable » dans les déclarations finales du G20 qui en 2007 à Toronto par exemple associe le Canada aux rédacteurs mais écarte la Corée du Sud ou l’Arabie Saoudite. Depuis 2000 on assiste à la tentative des membres du G8 d’intégrer des acteurs émergents, par exemple le Japon pour le sommet d’Okinawa ou la France pour le sommet d’Evian de 2003 [p. 24]. Ces choix ne vont pas de soi : Singapour réagit à sa marginalisation par la fondation du « 3G » en 2008 pour regrouper les membres de l’ONU qui ne font pas partie du G20.
Pour donner plus de poids à cette « coopération informelle » [p. 12], les sommets du G20 s’appuient sur les chefs d’Etat, remplaçant des organes plus démocratiques numériquement (ONU, OMC où les négociations s’appuient sur le vote des représentants) par la reconnaissance d’une importance des émergents qui déplace la question de la pauvreté vers celle des inégalités à toutes les échelles. Reprenant une idée de Pierre Rosanvallon, Karoline Postel-Vinay relève que la légitimité ici défendue n’est pas celle d’un intérêt général dégagé de manière purement arithmétique, et elle souligne qu’il est le fruit d’une interprétation politique consensuelle des normes collectives à un moment donné. La coopération entre « Nord » et « Sud » que le G20, la constitution évolutive du groupe sont les fondements de sa légitimation. L’organisation doit beaucoup de son crédit à la volonté des émergents d’entrer dans « l’architecture financière globale » [p. 23] et à l’instar du président sud-africain Thabo Mbeki qui soutient un processus par lequel l’Afrique du Sud est valorisée car associée à ce G8 élargi – ce qui n’est pas si évident selon Karoline Postel-Vinay car être associé ne veut pas dire décider.
Un groupement en quête de légitimité
Le G20 fait surtout partie des organisations plus ou moins formalisées qui tentent de donner du sens – dans tous les sens du terme – au fonctionnement du monde issu de la guerre froide. La crise de 2008 lui donne un nouveau poids dans les relations intergouvernementales, car on est alors à la recherche d’un moyen de coordonner les efforts pour lutter contre sa propagation. Le problème qui se pose très concrètement est alors celui de la réactivité des puissances économiques, du besoin de trouver un forum de discussion suffisamment large pour accueillir les pays « qui comptent » mais suffisamment restreint pour être en mesure de coordonner des actions efficaces. A cela il faut ajouter l’importance de rencontres qui s’organisent comme autant de face à face, auréolés du sentiment que ce mode de rencontre est synonyme d’efficacité. Il ne s’agit clairement pas de remplacer les organisations internationales, mais d’en contourner le caractère bureaucratique, synonyme de lourdeur et d’inefficacité en temps de crise lorsque concertation rime avec réactivité.
Règne alors un certain désordre dans les relations internationales avec la multiplication du nombres d’acteurs de nature et de légitimité très différentes, étatiques et non gouvernementaux. Ils correspondent à une démocratisation de l’espace international [p. 50] où la logique en réseau s’impose tant elle permet de mettre en oeuvre une expertise dont les organisations internationales ne disposent pas. En même temps le G20 remet en oeuvre le partage de la souveraineté tel que le Congrès de Vienne de 1815 l’avait posé, où les grandes puissances sont seules à décider pour le monde. Cet argument est le pivot de la position des anti-G20 que l’on retrouve aussi bien du côté des pays développés (notamment les pays scandinaves) que des pays en développement (Malaisie ou Chine). Les partisans du G20 voient au contraire dans la capacité d’entraînement de ce groupe un moyen de renforcer les institutions internationales qui ont besoin de cette réactivité pour contrebalancer la lourdeur du FMI.
Le débat mérite d’être lancé tant il est évident que l’installation du G20 dans le paysage international questionne également le travail de l’ONU et l’articulation entre représentations des grandes puissances et forum des 193 Etats du monde dans le travail de mise en forme de l’intérêt général. Karoline Postel-Vinay tempère en rappelant que si l’ONU a vocation à donner une représentation à chaque Etat, elle génère par les multiples groupes qu’elle abrite une déjà bien grande pluralité d’intérêts communs. D’autre part, l’ONU n’est pas parvenue par exemple à empêcher la naissance du G77, tant les pays en développement percevaient qu’ils leur fallait une représentation autonome et un forum spécifique au sein de cette tribune qu’est l’ONU [p. 79]. Le succès du G77 qui compte aujourd’hui 130 membres en témoigne. Ensuite, l’ONU en validant tous ces groupements concoure à la définition d’une universalité sur la forme (le rapport de force), plus que sur le fond ; le G20 n’en est qu’une incarnation parmi d’autres. En somme le G20 est légitime car il n’y a pas de G1 des Nations Unies. Enfin, l’importance G20 du fait de sa constitution et des questions qu’il aborde a entraîné une coopération accrue avec les agences de l’ONU [p. 84]. Il n’y a donc pas obligatoirement opposition entre les deux, ou en tout cas celle-ci mérite d’être mesurée à l’aune des mécanismes coopératifs qu’elle entraîne.
L’efficacité est le problème principal du G20. Si l’on prend la question des paradis fiscaux abordée en 2009, que reste-t-il ? La terminologie des « zones grises » s’est trouvée transformée en liste des pays « coopératifs » et « non coopératifs » dans la transparence financière, mais faute d’une réelle volonté commune, on ne peut pas considérer que le changement soit significatif. Pourtant l’efficacité, comme la légitimité, ne sont pas des notions quantifiables ou qui peuvent être déterminées a priori. Seule l’action de la société internationale leur donne chair et sens à un moment donné. Même les « G20-sceptiques » [p. 71] convenaient du succès des rencontres de 2008 pour juguler la crise économique, sans que cet épisode ne trouve de prolongement sur la question des paradis fiscaux. L’efficacité des sommets est au final relative aux enjeux variés qui intéressent les participants : les pays émergents en 2008 souhaitaient tirer les conséquences de la crise pour repenser la question de la répartition des richesses, dépassant largement l’objectif immédiat de stabilisation financière. Leur échec n’est que celui d’une volonté insuffisante et trop mal organisée.
« The West and the Rest ? »
Car contrairement à l’image qu’en donnent un peu facilement les médias, Karoline Postel-Vinay réfute l’idée que le G20 soit une forme de directoire de l’ordre mondial. Elle y voit plutôt un lieu d’observation et d’analyse des tendances de l’évolution des rapports économiques et politiques du monde, éventuellement un lieu de concertation, en tout cas de confrontation des visions et des intérêts des Etats qui y participent. Ces propos invitent à nuancer la portée des sommets du G20 qui se succèdent depuis la fin des années 1990 et pour lesquels bien souvent, « la montagne accouche d’une souris ». En réalité selon Karoline Postel-Vinay, le G20 est essentiellement un observatoire qui s’appuie sur les travaux de l’OCDE, de l’OIT ou de la FAO.
Le point central de l’argumentation de Karoline Postel-Vinay repose sur la prise en compte d’une transformation géopolitique inscrite en creux dans la montée en puissance du G20. La fin de la Guerre froide conduit à repenser la représentativité dans le cadre des transformations des équilibres mondiaux ; le G8 est un forum de pays riches et développés, de pôles de la triade dont les intérêts président à l’organisation du monde. L’affirmation du G20 marque une inflexion saillante puisque il fait entrer dans cette gouvernance mondiale des pays jusque-là maintenus dans une forme de minorité. Reste à déterminer ce que deviennent les pays non-membres du G20 : si le G20 veut qu’ils acceptent cette gouvernance, encore faut-il qu’ils puissent également s’exprimer. Cette tendance s’exprime dans la communication plus grande du G20 avec l’ONU ainsi que des invitations régulières adressées aux organisations régionales (APEC, ASEAN, NEPAD).
Il ne faut pas négliger l’asymétrie de la relation qui unit les membres du G20. D’un côté on trouve des puissances « invitantes » : les membres du G8, Etats pivots dans le cadre du FMI, alimentent un débat que l’on retrouve dans le cadre des relations internationales sur le Conseil de Sécurité de l’ONU. G8 qui par ailleurs se cherche une légitimité propre en face de celle du G20. Son soutien aux « printemps arabes » lui a redonné du lustre puisqu’il a confirmé son rôle éminemment politique en face des questions économiques qui sont de plus en plus l’affaire du G20. Alors que les BRICS s’opposent à l’intervention occidentale en Libye, le G8 se donne l’image d’un directoire des nations démocratiques et des libertés publiques. Leur défense y semble moins problématique qu’au G20, quitte à minorer les tensions avec les puissances chinoise et russe2, comme un prolongement ou un retour aux grandes heures de la Charte de l’Atlantique.
Le vrai changement tient donc à ce que le G20 ne soit pas exclusivement composé de pays réputés « du Nord » ou « du Sud » ; la richesse n’en est pas « une donnée déterminante » [p. 96]. La Corée du Sud ou le Mexique en ont assuré la présidence, interrogeant la « gouvernance asymétrique » qui règne dans les instances internationale. Le G20 est la confirmation institutionnelle de l’hétérogénéité des nords et des suds dont Karoline Postel-Vinay présente quelques éléments saillants associés à autant de situations (la Corée du Sud) et d’acronymes (les BEM, BRIC et autres MIST) [p. 88]. Une rapide histoire des BRICS suffit à convaincre de cette hétérogénéité et des désaccords dont le groupe est le théâtre. Par exemple les BRICS ne parviennent à convenir d’une stratégie pour peser sur le FMI, au point que la présidence leur échappe en juin 2011, ou lorsque les relations avec le continent africain sont l’objet de telles rivalités qu’elles conduisent à l’émergence de l’IBSA (Inde-Brésil-Afrique du Sud) pour contrer la montée de la « Chinafrique ».
A travers cet ouvrage, nous entrons dans le grand débat sur la redistribution des rôles dans les relations internationales à l’aube du XXIe siècle. Il n’y a pas remise en cause les codes et les normes juridiques ou économiques, et on ne peut parler de désoccidentalisation du monde, mais plutôt une « provincialisation » de l’Occident [p. 115]. Il n’y a pas plus d’occidentalisme aujourd’hui qu’il n’y avait par le passé d’orientalisme ; les deux termes fonctionnent en miroir, mais en miroir déformant.