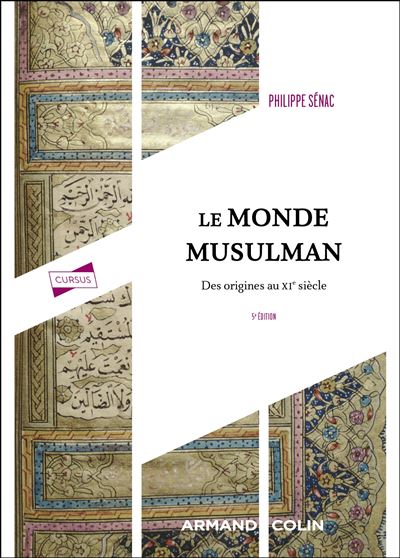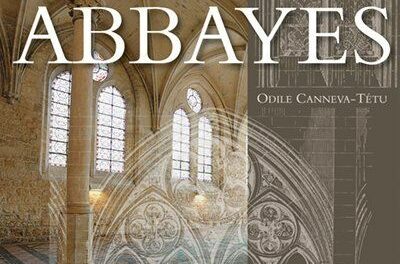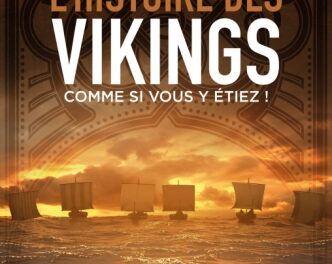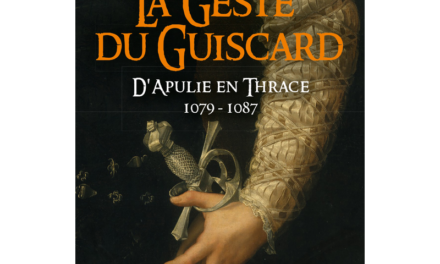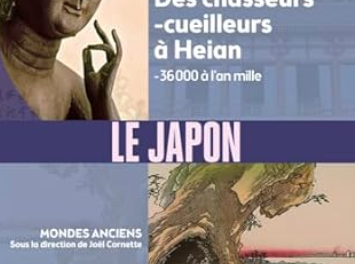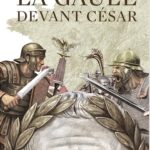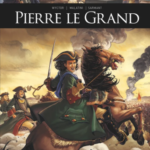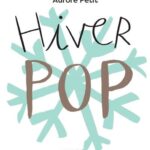Le monde musulman : Des origines au XIe siècle, désormais dans sa cinquième édition, constitue un outil indispensable aussi bien pour les étudiants en histoire que pour les enseignants du secondaire. Philippe Sénac, professeur émérite d’histoire médiévale à l’université Paris-Sorbonne, signe, en effet, une synthèse rigoureuse et accessible, idéale pour ceux qui souhaitent s’initier à l’histoire du monde musulman médiéval tout en bénéficiant d’outils d’analyse solides.
L’auteur offre une approche à la fois chronologique et thématique du sujet, abordant des aspects politiques, culturels, administratifs, commerciaux et militaires. L’ouvrage couvre la période allant de l’Arabie préislamique jusqu’au déclin de la dynastie abbasside au XIe siècle, en passant par les califats rashidun et omeyyades. Il met aussi en lumière les tensions et divisions internes à cet immense empire, qui ne constitue pas un bloc monolithique, notamment les oppositions entre sunnites et chiites ainsi que l’émergence de pouvoirs locaux sous forme de califats et d’émirats.
Un outil pratique et rigoureux
L’un des atouts majeurs du livre réside dans l’insertion d’extraits de sources historiques et de références scientifiques, qui enrichissent l’analyse. Les plans et généalogies proposés offrent également une meilleure compréhension des évolutions et dynamiques de l’époque.
La deuxième partie de l’ouvrage présente des textes de référence accompagnés d’une analyse détaillée ainsi que des propositions de plans de commentaire, facilitant ainsi l’exploitation pédagogique de l’ouvrage. Une bibliographie complémentaire permet d’approfondir certains aspects abordés.
L’ouvrage se clôt sur des annexes contenant un glossaire, une chronologie générale, une bibliographie et un index, facilitant la recherche et l’approfondissement du sujet.
Les grandes périodes du monde musulman médiéval
Le livre s’ouvre sur l’Arabie préislamique, décrite comme un carrefour entre l’Orient et l’Occident. Il évoque ensuite la figure du prophète Muhammad, chef religieux et politique qui parvient à soumettre, en grande partie, les tribus bédouines et les Qurayshites. Vient ensuite l’étude des califes râshidûn (632-661), période marquée par une expansion rapide de l’islam malgré des révoltes internes. L’ouvrage expose les divisions majeures qui émergent alors : les sunnites, partisans de Mu‘awiya, les chiites, qui estiment que le califat doit revenir aux descendants directs de Muhammad, et les kharijites, qui défendent une élection ouverte à tout musulman.
L’étude du califat omeyyade (661-750) met en lumière ses aspects politiques, institutionnels, économiques, sociaux et culturels. La capitale Damas devient un centre névralgique, mais la dynastie ne parvient pas à imposer une transmission héréditaire stable. L’administration s’arabise et se réorganise, tandis que des réformes monétaires et fiscales sont mises en place. Cependant, les tensions entre Arabes, convertis et non-musulmans persistent, engendrant des inégalités sociales. L’ouvrage met en avant l’essor d’une culture urbaine raffinée et influencée par Byzance, notamment dans l’architecture et la littérature.
Le califat abbasside (VIIIe-Xe siècle) est traité à travers son évolution politique et institutionnelle, ainsi que ses dimensions économiques, sociales et culturelles. Des figures comme Al-Mansûr, Haroun al-Rachid ou al-Ma’mûn illustrent cette période, marquée par des relations diplomatiques avec Charlemagne et Louis le Pieux contre Byzance et Cordoue. L’administration se complexifie et s’orientalise, et bien que la centralisation reste un objectif majeur, les gouverneurs provinciaux gagnent en autonomie, comme en Espagne où l’émirat devient indépendant. La période est aussi marquée par l’essor du chiisme et de divers mouvements sociaux. Bagdad devient une capitale prestigieuse, tandis que d’autres cités comme Samarcande et Samarra se développent. L’ouvrage souligne également l’influence sassanide dans l’art et la place essentielle des savants, notamment Ibn Sina, dans le développement des sciences.
L’Afrique du Nord du VIIe à la fin du Xe siècle est abordée à travers l’émergence des émirats idrisside, aghlabide et fatimide. Concernant Al-Andalus, Abd al-Rahman y prend le pouvoir et fonde l’émirat omeyyade de Cordoue après avoir fui la prise de pouvoir des Abbassides. Abd al-Rahman III instaure officiellement le califat en 929, marquant l’apogée du pouvoir omeyyade dans la péninsule ibérique.
Le Xe siècle voit la fragmentation du pouvoir abbasside face à la montée en puissance de pouvoirs locaux. Diverses dynasties émergent : en Iran, les Tahirides, Saffarides et Samanides ; en Syrie, Irak et Asie centrale, les Hamdanides, Ghaznavides et Buyides. Le livre met en avant comment ces entités profitent des troubles internes pour établir des dynasties héréditaires.
En conclusion, l’ouvrage montre qu’au Xe et XIe siècle, le dâr al-Islam entre dans une période de récession marquée par le morcellement territorial et l’affaiblissement de l’autorité califale. Les divisions entre sunnites et chiites, les révoltes sociales et l’essor du pouvoir militaire contribuent à cette mutation. Cependant, malgré son affaiblissement, le califat demeure un modèle et le calife une source de légitimité.