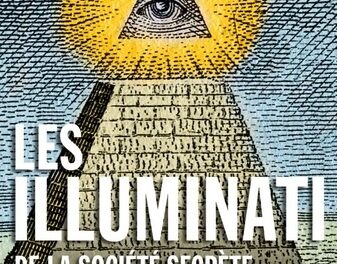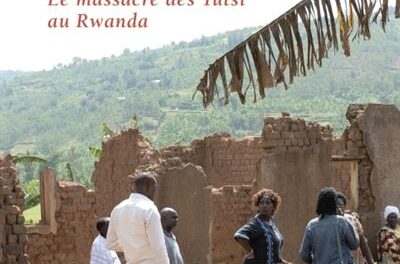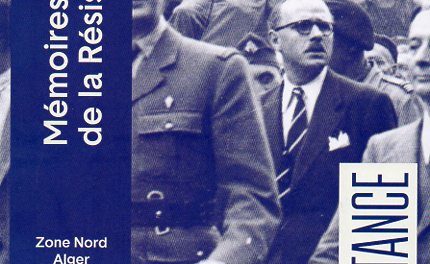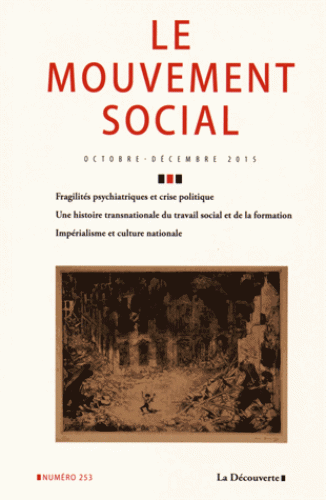
Les cinq articles réunis dans ce numéro du Mouvement social sont répartis en trois thèmes : « Fragilités psychiatriques et crise politique », sujet sur lequel porte aussi l’éditorial, « Une histoire transnationale du travail social et de la formation » et « Impérialisme et culture nationale. » Dans les lignes qui suivent, le choix a été fait de rendre compte principalement des articles pouvant nourrir directement les cours d’histoire des enseignants de collège ou de lycée.
« Fragilités psychiatriques et crise politique »
Dans son éditorial, intitulé « Vers un désenclavement de l’histoire de la psychiatrie », Isabelle von Bueltzingsloewen revient sur l’historiographie de la psychiatrie dont elle veut montrer le dynamisme actuel. En dépit du retentissement de l’œuvre de Michel Foucault dès les années 1960, les historiens ne se sont intéressés que tardivement au sujet en fondant dans un premier temps leurs travaux sur trois types de sources : « l’abondante production scientifique des psychiatres » (p. 4), « les sources parlementaires et réglementaires » (p. 4) et les sources médiatiques. Ces sources « ont cependant montré leurs limites » (p. 5). S’est fait jour la volonté de faire une « histoire de la psychiatrie « par en bas » » (p. 6) pour rendre compte de la vie quotidienne dans les établissements psychiatriques et, surtout, « faire une place, aussi centrale que possible, aux patients » (p. 7). Selon Isabelle von Bueltzingsloewen, les articles de Marie Derrien et Fanny Le Bonhomme, rédigés à partir de recherches menées dans le cadre de leur doctorat, intitulés respectivement « Eliminer ou récupérer ? L’armée française face aux fous du début du XXe siècle à la Grande Guerre » et « « Le Mur lui est monté à la tête ». Construction du mur de Berlin et basculement dans la maladie (Berlin-Est, 1961-1968) », participent pleinement de cette nouvelle orientation des études historiques sur l’histoire de la folie et de la psychiatrie.
Folie, psychiatrie et Grande Guerre
Marie Derrien se penche sur la question de « la position des autorités militaires et des psychiatres vis-à-vis des hommes instables au point de vue mental » (p. 14). Elle montre tout d’abord que la « vérification cérébrale » des conscrits devient un sujet de préoccupation croissant pour les chefs de l’armée française pendant les années qui précèdent la Première Guerre mondiale. D’une part, « les missions d’observation des médecins envoyés par l’armée française sur les théâtres des conflits des années 1900 ont mis en lumière la violence des combats et ses conséquences psychiques sur les combattants » (p. 15) ; d’autre part, avec la généralisation du service militaire, en particulier la suppression du tirage au sort en 1905, les questions de la réforme et de la sélection se posent plus que jamais. Si la loi de 1905 donne la possibilité aux conscrits souffrant d’une maladie ou d’une infirmité de constituer un dossier pour le présenter au conseil de révision et si « l’instruction militaire sur l’aptitude au service militaire définit dans ses articles 50 et 54 les pathologies mentales qui doivent motiver l’exemption et la réforme » (p. 16), il s’avère que les médecins militaires sont mal formés au diagnostic de ce type de maladie et ne sont donc pas pleinement capables d’exercer une sélection satisfaisante, du moins aux yeux des spécialistes : « Convaincus que les dispositions existantes sont insuffisantes, les médecins aliénistes et neurologistes réunis en congrès à Nantes en 1909 formulent une série de vœux visant à éliminer des rangs les individus atteints de troubles mentaux, à promouvoir l’examen mental des militaires traduits en conseil de guerre et à renforcer l’instruction psychiatrique des médecins militaires. » (p. 17) Ils sont en partie entendus puisqu’une instruction ministérielle, dont Marie Derrien analyse l’élaboration, est rédigée en 1912-1913 et publiée au journal officiel le 5 avril 1913. Selon Marie Derrien, sa portée est limitée : « Il n’en reste pas moins qu’au terme d’un parcours long et difficile, l’instruction interministérielle relative aux « dispositions à prendre en vue d’écarter de l’armée les militaires atteints de troubles mentaux » constitue une version très édulcorée du projet initial. Elle témoigne des réticences persistantes de l’armée de terre à prendre en compte la question de l’aliénation mentale chez les militaires et ne précise d’ailleurs pas selon quelles modalités les soldats atteints de troubles passés inaperçus au moment du conseil de révision devront être évacués et traités en cas de conflit. À la veille de la Grande Guerre, l’armée française est donc l’une des dernières en Europe à prendre des dispositions pour se prémunir contre l’incorporation de jeunes hommes instables sur le plan mental. » (p. 20).
L’adoption de cette circulaire ne change rien au manque de formation des médecins militaires et à leur faible capacité à repérer les troubles mentaux. Par conséquent, dès le début de la guerre, les conseils de révision réforment de moins en moins de conscrits pour maladie ou infirmité en général et pour pathologie mentale en particulier : « Le taux d’exemption pour épilepsie, aliénation, crétinisme et convulsion diminue de 30 %. » (p. 21). Mieux, « des opérations de récupération sont lancés dès 1914 pour renforcer les effectifs. » (p. 21). L’objectif assigné par l’armée aux médecins est bien résumé dans un livre publié en 1918 et cité par Marie Derrien : « Chaque fois que l’homme est encore susceptible de rendement, le maintenir à l’armée. Ne réformer que ceux qui sont pratiquement inutilisables »A. Hesnard et A. Porot, L’expertise mentale militaire, Paris, Masson, 1918, p. 69. (p. 21). Dans les faits, les « déséquilibrés » peuvent être affectés dans les troupes auxiliaires mais d’autres se retrouvent sur le front, ce qui peut entraîner des catastrophes : « En 1916, Jean Lautier soutient une thèse sur l’utilisation des imbéciles dans l’armée, rendant compte d’une série d’études de cas réalisées au sein de la section spéciale de l’asile de Villejuif, dirigée par le docteur Henri Colin. Effrayés, incapables d’exécuter correctement un ordre, de se servir d’un fusil, de faire attention à leur équipement, les militaires atteints d’imbécillité ont été évacués à la suite d’un épisode délirant, d’un accident ou d’une infraction. Reprenant les résultats obtenus par son élève, le docteur Colin affirme le 17 juillet 1916 devant la Société médico-psychologique que les imbéciles à l’armée sont des « non-valeurs », « toujours inutiles, souvent dangereux. » » (p. 27).
Dans une dernière partie de son article, Marie Derrien examine le point de vue des psychiatres. Celui-ci s’avère assez divers. Certains psychiatres, par patriotisme, pensent que leurs patients doivent participer à l’effort de guerre. D’autres, mais il s’agit d’un point de vue minoritaire selon Marie Derrien, estiment que leur incorporation peut avoir une portée prophylactique, à l’image de Léon Pruvost qui se demande dans sa thèse, publiée en 1915 et intitulée Les débiles mentaux à la guerre, leur utilisation, « ce qu’il adviendra « de la race si, après qu’une indulgence débonnaire aura mis à l’abri tous les débiles, ils restent en foule, une fois la paix signée, comme géniteurs avec leur hyperorchidie et leur prolificité classique ? » (p. 24). D’autres encore, comme nous l’avons vu, insistent sur les dangers que représentent l’envoi au front de tels malades. Pour une dernière partie des psychiatres français, « le refus d’associer troubles mentaux et réforme résulte de la volonté d’affirmer leur capacité à traiter leurs malades » (p. 25)La lecture de l’article de Marie Derrien peut être utilement complétée par la longue note de lecture rédigée par Sylvain Bertschy dans le même volume du Mouvement social pour rendre compte conjointement des deux livres suivants : Laurence GUIGNARD, Hervé GUILLEMAIN et Stéphane TISON (dir.). – Expériences de la folie. Criminels, soldats, patients en psychiatrie (XIXe-XXe siècles), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, 327 pages et Stéphane TISON et Hervé GUILLEMAIN. – Du Front à l’asile 1914-1918, Paris, Alma éditeur, 2013, 416 pages. Cette note de lecture est disponible en ligne : http://www.cairn.info/revue-le-mouvement-social-2015-4-page-113.htm.
La « maladie du mur »
Fanny Le Bonhomme traite d’un sujet tout aussi passionnant que celui de Marie Derrien : la « maladie du mur », traduction du néologisme Mauerkrankheit, apparue en RDA après la construction du mur de Berlin, maladie « caractérisée par l’apparition de manifestations pathologiques consécutives à la construction du mur de Berlin et relevant notamment de la dépression. » (p. 31). En se fondant sur le dépouillement d’une cinquantaine de dossiers de patients de la clinique psychiatrique de la charité de Berlin-Est, Fanny Le Bonhomme montre dans un premier temps que l’érection du mur a représenté une rupture dans la vie des patients qu’elle étudie, en particulier dans le domaine affectif. Certains se retrouvent séparés d’une partie ou de la totalité de leur réseau relationnel et souffrent par conséquent de la solitude, à l’image de Margaret R., âgée de 73 ans, admise en psychiatrie pour démence sénile en 1964, comme l’explique sa petite-fille dans une pièce de son dossier citée par Fanny Le Bonhomme : « La grand-mère est particulière depuis quelques années déjà, mais depuis le 13 août 1961 son état mental attire l’attention. Elle n’a pas pu se résigner à ne plus pouvoir voir ses sœurs qui vivent à Berlin-Ouest et ne pouvoir se rendre sur la tombe de sa fille (noyée) » (p. 37).
Dans un deuxième temps, Fanny Le Bonhomme expose le cas des patients pour lesquels le mur a engendré des peurs et des angoisses maladives. La construction du mur et surtout le déploiement militaire qui lui est lié font « remonter à la surface les souvenirs angoissants des bombardements » (p. 40) et, plus largement, des combats de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui entraîne l’apparition de pathologies dans au moins un cas longuement présenté par Fanny Le Bonhomme : « L’épisode du 13 août 1961, qui se caractérise par la présence de forces armées dans la ville (policières et militaires, est-allemandes mais également soviétiques), rappelle donc directement les traumatismes de la dernière guerre et provoque chez la patiente une réaction anxiogène, psychosomatique. » (p. 41). Les peurs ressenties par les patients résultent aussi de l’interdiction d’évoquer le mur : « Au sein de la société est-allemande, le Mur devient vite un sujet hautement politique et tabou. Le discours officiel n’évoque pas « la construction du Mur », mais utilise des formulations plus équivoques comme « les mesures de sécurisation du 13 août 1961 ». Pour la propagande, le Mur est avant tout un « rempart antifasciste » qui ne vise qu’à protéger la RDA d’éventuelles attaques de l’Ouest. Le critiquer revient à remettre en question l’édification du socialisme et donc à apparaître comme un opposant politique. » (p. 41). Ainsi, une femme souffre d’une peur maladive d’être fusillée parce qu’elle aurait simplement parlé du mur devant ses supérieurs hiérarchiques, sans que l’on sache si elle a pour autant si peu que ce soit critiqué sa construction.
Dans un dernier temps, Fanny Le Bonhomme s’attache à retracer la généalogie du néologisme Mauerkrankheit et sa circulation, d’abord dans le vocabulaire courant puis médical, des médecins psychiatres passés à l’ouest publiant des articles ou des ouvrages spécialisés sur ce sujet. La « maladie du mur » est évoquée dès 1962 par un dirigeant de la RDA dans un contexte bien particulier : « Dans le discours qu’il prononce en avril 1962 devant une assemblée du parti communiste, Paul Verner, membre du Comité central, évoque l’utilisation de l’expression « maladie du Mur » par les médias ouest-allemands. Elle participe selon lui d’une campagne de « diffamation stupide » menée à l’encontre de la RDA. » (p. 43). Dans les dossiers dépouillés, le néologisme apparaît deux fois, sous forme de citation de patients. Il est vrai que les médecins, à la différence des patients, sont étroitement surveillés par la Stasi : « Les entretiens psycho-thérapeutiques sont, dans la très grande majorité des cas, protégés par le secret médical. Si la police politique dispose bien d’un informateur secret au sein de l’équipe médicale, sa mission consiste en premier lieu à surveiller ses collègues médecins, et non à rapporter les propos des patients. On ne trouve ainsi trace, dans le dossier de l’informateur, d’aucun propos tenu par des patients ayant trait à la fermeture des frontières en août 1961. » (p. 35)
Histoire transnationale
Les trois autres articles publiés dans ce numéro du Mouvement social présentent un point commun : ils sont le fruit d’une approche transnationale de la réalité historique. Samuel Boussion, dans « Un voyage en travail social. Jean Ughetto, éducateur aux Etats-Unis (1950-1951) », aborde un sujet tout à fait nouveau à partir d’un fonds d’archives original : le voyage d’étude du premier éducateur spécialisé français parti aux Etats-Unis pour se former. A partir, en particulier, de la reconstitution de l’activité militante de cinq femmes syndicalistes, trois Françaises, une Belge et une Suédoise, Françoise F. Laot, dans une contribution intitulée « La formation des travailleuses (1950-1968) : une revendication du syndicalisme mondial ? », étudie le rôle des organisations internationales, notamment de l’OIT, et des fédérations syndicales internationales dans l’émergence et l’affirmation d’un discours revendicatif mais aussi de projets portant sur la question de la formation des femmes dans les années 1950 et 1960. Enfin, Philippe Bourdin, dans « Les limites d’un impérialisme culturel : le théâtre français dans l’Europe de Napoléon », donne à voir et à comprendre un aspect de la politique culturelle mise en œuvre par Napoléon et son administration à l’échelle de l’empire.