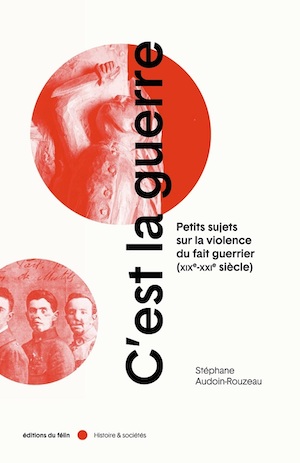Stéphane Audouin Rouzeau est un historien français. Il a participé au renouvellement de l’historiographie de la première guerre mondiale dont il est un spécialiste. Il occupe actuellement les fonctions de directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et de président du Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne. « C’est la guerre. Petits sujets sur la violence du fait guerrier (XIX-XXIe siècle) » son dernier livre est un recueil d’articles et de contributions déjà publiés dans des revues spécialisées peu accessibles ou inédits. Vingt-deux petits sujets, vingt-deux « détails » saisis depuis 1870 jusqu’à 2015 (les attentats du 13 novembre) mais surtout durant la grande guerre étudiée avec rigueur et minutie, contextualisés… par l’auteur. « Un vécu de terreur » lors de la bataille de Saint Quentin en 1870, « la correspondance de guerre de Ferdinand Leger », la canne sculptée en 1917 par le poilu Claude Burloux, ou encore l’expérience oubliée de la première guerre mondiale de Norbert Elias et son influence sur son œuvre par exemple. Le choix de la micro histoire car ainsi que l’auteur se sent le plus à l’aise pour rester au plus proche de ses contemporains, pour comprendre et faire comprendre les violences de guerre, la culture de guerre.
Ce recueil est et ce n’est pas le moindre de ses intérêts une réflexion de l’auteur sur son travail, le retour sur de son cheminement vers une autre approche de la grande guerre, vers l’ouverture de nouveaux champs historiques plus proches des hommes, de leur quotidien et de leur univers mental. Il évoque ce qu’il doit, ce que l’histoire doit aux autres sciences humaines, ses « révélations » . Et aussi, combien la connaissance du passé dépend des sources, des objets et du regard que l’historien pose sur eux, de la façon dont il les saisit.
L’écriture est limpide, le vocabulaire explicité ainsi que la démarche choisie. Les documents étudiés sont joints notamment les images décrites et les gravures de Felix Vallotton pourront éventuellement être utilisées par un enseignant. L’ensemble est parfaitement structuré. Les petits sujets sont rassemblés en trois parties intrinsèquement liées : la violence, l’après coup et les traces.
La violence, thème central de l’ouvrage, pour commencer car elle est inhérente à la guerre, constitutive de la guerre. Elle fait de celle-ci un autre temps autre. Huit des dix sujets étudiés (correspondance, journal intime, images…) concernent la première guerre mondiale. Ils montrent l’intensité de la violence et la pluralité de ses formes ainsi que l’importance et la diversité des victimes, du fait de l’avènement de la guerre moderne, industrielle et totale. En effet, bombardements, marmitages, vision des corps déchiquetés et des paysages dévastés, domiciles violés, souillés, odeurs des cadavres en décomposition ou encore la terreur lors des gardes, des assauts, des corps à corps etc. … Violences qui rendent malades psychologiquement et/ou physiquement. Violences de l’ennemi, instrumentalisées. Ne justifient-elles pas que l’on vainc ce barbare ? L’ennemi d’ailleurs, désormais, c’est la population toute entière. Les civils, les femmes et les enfants par conséquent échappent pas aux violences et l’auteur d’évoquer l’importance des viols numériquement et symboliquement, dans les régions occupées.
Au fils des pages, le lecteur s’enrichit de connaissances générales sur la période, sur le quotidien et le ressenti des contemporains de la grande guerre. Il perçoit combien la culture de guerre, les stéréotypes concernant l‘ennemi, l’héroïsation des combattants… sont intégrés même par ceux qui cherchent à fuir les combats comme F. Léger, ou ceux qui dénoncent le bourrage de crâne et ont maille à partir avec la censure comme le fameux journaliste A Londres. Ils sont pétris des valeurs de l’époque et de la culture de guerre à laquelle ils participent à leur insu peut-être ne serait-ce qu’en tant que témoins. Le lecteur acquiert ainsi aussi des outils pour décrypter, appréhender cette période et éviter les erreurs d’interprétation auxquelles ses propres représentations souvent éloignées de celles de nos ancêtres pourraient le conduire et être préjudiciable.
Cette première partie consacrée aux violences, se termine par l’évocation des émeutes parisiennes de mai -juin 1968 ce qui peut surprendre. En fait, l’auteur nous explique se livrer à une expérience : la lecture de ces faits sous l’angle des violences de guerre, au prisme d’un questionnement guerrier (p 101). Il souligne les références faites par les protagonistes -représentants de l’Etat, des forces de l’ordre et émeutiers- à la guerre notamment dans le verbe, la sémantique . ll y a des assauts, des gaz, l’usage de la force, des morts au moins redoutés voire fantasmés … le mimesis construit par les acteurs eux même mis en exergue par l’auteur est frappant cependant lors de cet épisode, la violence de guerre est redoutée et au final évitée. La bataille est mimée.
La seconde partie de l’ouvrage aborde l’après coup des violences de guerre, les cicatrices induites spécifiquement par la première guerre mondiale. La mort de masse (900 victimes par jour en moyenne) caractérise la première guerre mondiale et de fait, le deuil collectif et/ou individuel, personnel, exhibé ou refoulé, la douleur, la souffrance si difficiles à appréhender pour les historiens par-delà les chiffres, le nombre de morts de veuves ou d’orphelins. En effet, combien de personnes ont souffert ? Combien de temps ? Comment ? L’auteur revient sur ce thème d’ailleurs lorsqu’il évoque combien Jean Rouaud ou François Tavernier l’ont éclairé sur ces lacunes et les réponses qu’ils apportent à ces questions dans leurs œuvres respectives. Ici, c’est le parcours d’une mère pour récupérer le corps de son fils et le récit de sa douleur, ou encore le combat d’une veuve pour réhabiliter son mari fusillé qui permettent de saisir le deuil de masse et la sacralisation des morts pour la patrie dans la France après-guerre. Autres stigmates, autres souffrances mises en évidence par une simple lettre précieusement, pieusement conservée et minutieusement étudiée par l’auteur : la découverte là où les combats ont fait rage des ruines de son village, de sa maison ; ses biens, son patrimoine, anéantis… à tout jamais malgré la reconstruction. L’après coup, c’est aussi les corps mutilés et surtout les gueules cassées mises en scène et instrumentalisées à Versailles le 28 juin 1919. Les horribles blessures sont glorifiées. Elles illustrent la bravoure des soldats français, leurs souffrances, leur sacrifice qui ont conduit à la victoire et l’Allemagne vaincue est responsable en est responsable. Les gueules cassées incarnent l’article 231 (p 184) pour Clémenceau et pour eux. Enfin, étonnement l’après coup, c’est aussi l’oubli de cette expérience pour au moins Norbert Elias. Pourtant d’après Stéphane Audouin Rouzeau cet oubli expliquerait en fait l’essentiel des travaux de l’œuvre de cet écrivain et sociologue allemand. Expérience oubliée ou refoulée pour cet ancien soldat, impossible oubli, impossible retour à la normal ou « démobilisation psychologique » au contraire pour d’autres anciens combattants incarnés par le capitaine Conan de François Tavernier évoquée quelques pages plus loin.
La troisième et dernière partie est consacrée aux traces laissées par la guerre, L’auteur nous emmène d’abord pour les retrouver à l’Historial de Péronne, dans les réserves. Objets, figurés et autres documents y sont inventoriés, entreposés. Dans ce lieu, il est possible de « commencer à apprendre la grande guerre et continuer d’apprendre quand on croit en connaitre quelque chose ». Là de nouveaux champs de connaissances ont déjà été ouverts par A Becker ou par l’auteur lui-même, là de nouveaux champs restent à ouvrir au plus près des contemporains de la grande guerre. Les traces de la guerre, des violences et les morts au combat sont nombreuses dans la littérature ou le cinéma et l’auteur d’expliquer l’importance du livre « les champs d’honneur » de J. Rouaud et des films de François Tavernier « la vie n’est rien d’autre » puis « capitaine Conan ». D’ une part, ces œuvres ont été pour lui des révélations des insuffisances de l’histoire et des lacunes à combler dans la connaissance de cette période dont il est pourtant un des spécialistes sur le ressenti des contemporains, la souffrance. D’ autre part, parce qu’elles révèlent comment et combien la premier guerre mondiale , la souffrance est ancrée dans l’identité nationale française et est constitutive de celle-ci . Enfin, elles ont aussi été le signe et le vecteur du retour en présence de la première Guerre Mondiale. Symptomatique aussi de la place de la première guerre mondiale dans nos représentations collectives, l’apparition au lendemain des attentats de novembre 2015 selon l’auteur d’une culture de guerre éphémère. Enfin, le souvenir de la guerre et des morts au combat est entretenu par l’érection de monuments et les commémorations officielles et la commémoration du centenaire de la Première guerre n’a pas failli à la tradition. Ce désir de commémorer les victimes de guerre, les morts pour la patrie naît au dix-neuvième siècle alors que les nationalismes s’affirment. C’est un acte politique, polysémique et qui peut être polémique comme le montre le débat autour du Yasukuni au Japon sur lequel nous éclaire l’auteur. Ce monument construit en 1869 pour rendre hommage aux Japonais « ayant donné leur vie au nom de l’empereur du Japon ». y figure le nom de plus de deux millions de soldats japonais morts de 1868 à 1951 déifiés dont certains sont des criminels de guerre. Ce monument n’est -il pas une glorification du nationalisme et du colonialisme japonais et au bout du compte une incitation à l’expansionnisme, à la guerre et certains japonais de s’en inquiéter voir de s’en offusquer dont Takahashi Tetsuya.