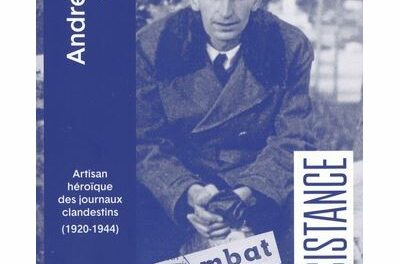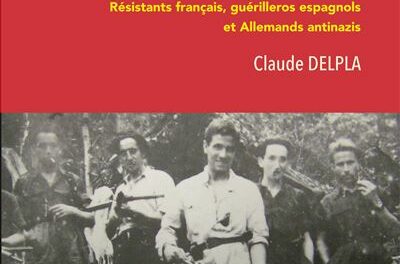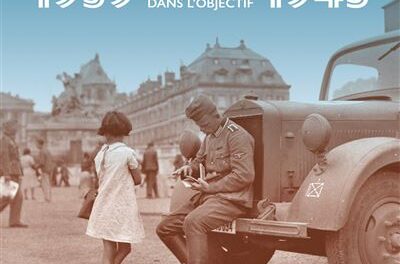Dernier acteur vivant des débuts de la résistance communiste armée, Pierre Daix nous propose dans cet ouvrage une confrontation de ses souvenirs avec les travaux historiques récents dont il montre tout l’intérêt pour connaître la politique du PCF au début de l’Occupation et pour comprendre ses entreprises de falsification de sa propre histoire. Cet ouvrage succède à plusieurs autres qui traitaient au moins partiellement du même thème : J’ai cru au matin, Robert Laffont/Opera Mundi, 1976 ; Les Hérétiques du PCF, Robert Laffont, 1980 ; Dénis de mémoire, Coll. « Témoins », Gallimard, 2008. Il insiste sur le fait qu’il a longtemps ignoré ce qui s’était réellement passé de 1940 à 1942 au sein du Parti communiste « jusqu’à la découverte du livre décisif de Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Le sang des communistes, soit jusqu’en 2004. Soixante-deux ans plus tard. J’en ai eu froid dans le dos ». J’ai souligné l’importance de l’étude de Berlière et Liaigre dans le récent compte rendu du livre consacré par Emmanuel Lemieux à un camarade de Pierre Daix, Tony Blondeau (http://www.clio-cr.clionautes.org/tony-1942-un-proces-oublie-sous-l-occupation.html#.UwCDvs68HTo).
Pierre Daix
Pierre Daix a adhéré au Parti communiste français, à 17 ans, en 1939, au lendemain de son interdiction consécutive à son approbation du pacte germano-soviétique. Ce n’est pas banal ! Mais on peut le comprendre car ce parti, le seul parti antimunichois, lui semblait le mieux correspondre à son antifascisme foncier. Il entreprend d’ailleurs dès l’été et l’automne 1940, avec quelques camarades de l’Union des étudiants communistes clandestine, des actions de résistance à l’occupant, à une époque où les dirigeants du parti négocient avec cet occupant la reparution légale de L’Humanité, journal qui appelle à la fraternisation avec les soldats allemands. Il participe ensuite à la lutte armée, au sein de l’Organisation Spéciale (OS) du PCF, à ce que l’on appelle aujourd’hui Les Bataillons de la jeunesse, et assiste à l’arrestation, à l’exécution et à la déportation de presque tous ses camarades. Il est lui-même arrêté mais, ni Vichy, ni l’occupant, ne découvrent l’importance de ses responsabilités. Il passe de Fresnes à Clairvaux, puis au camp de concentration de Mauthausen. À Mauthausen, connaissant l’allemand, il travaille avec l’organisation de résistance internationale clandestine et aide à sauver des résistants français sans distinction d’origine politique. À la Libération, il est nommé chef de cabinet du ministre communiste Charles Tillon au ministère de l’Air, de l’Armement et de la Reconstruction. En 1950, Pierre Daix devient directeur du journal communiste Ce soir, puis rédacteur en chef de la revue culturelle du PCF, Les Lettres françaises. Il y est le collaborateur de Louis Aragon de 1948 à 1972. Il se démarque à plusieurs reprises de la ligne soviétique du Parti avec lequel il rompt en 1974 à l’occasion de la publication de L’Archipel du Goulag. Il est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire de l’art, en particulier sur Picasso, dont il fut l’ami et le biographe.
Un engagement résistant précoce
Pierre Daix et ses camarades de l’Union des étudiants communistes sont immédiatement et totalement décidés à lutter contre l’occupant. Ils organisent un rassemblement, devant le collège de France, le 8 novembre 1940, pour protester contre l’arrestation du physicien Paul Langevin, connu pour son engagement antifasciste. Le 11 novembre 1940, avec les gaullistes, ils organisent la première manifestation d’envergure contre les nazis, place de l’Étoile. L’organisation parisienne des étudiants communistes est vite démantelée par la police de Vichy ; Pierre Daix est emprisonné à la Santé jusqu’au 1er mars 1941, puis rendu à ses parents après avoir était chassé de la Sorbonne. Il rencontre alors Christian Rizo avec lequel il va participer secrètement, dès le mois de mai 1941, à l’élaboration de ce qui allait devenir l’Organisation spéciale.
« Au printemps 1941, l’impatience les jeunes communistes parisiens de se battre contre l’occupant s’est affirmée. Des « groupes de chocs », comme on les appelait, réunissaient ceux qui, dans les organisations clandestines, ne supportaient plus l’inaction. » La police de Vichy opéra alors une rafle de plusieurs dizaines de militants qui furent enfermés au dépôt de la préfecture de police de Paris, en vue de les transférer dans les camps d’internement. Cette rafle ayant frappé Pierre Hervé, leur dirigeant d’avant-guerre, une opération fut montée pour le libérer, hors de toute instruction de la direction du PCF. Réalisée dans la nuit du 7 au 8 juillet 1941, cette opération permit de libérer 21 communistes et « prouve le laisser-aller, encore à cette date de l’appareil répressif ». Et Pierre Daix d’ajouter : « Le fait le plus significatif est qu’il y eut autant et sans doute bien plus d’emprisonnés de la grande salle qui refusèrent de s’évader par la brèche ouverte, parce qu’ils n’avaient pas reçu l’ordre du parti de le faire. Ce qui révèle combien les responsables locaux ou régionaux étaient encore inconscients de l’ampleur de la répression nazie qui ne pouvait pas manquer de se déchaîner contre eux après le déclenchement de la guerre à l’Est. »
Un engagement désapprouvé mais utilisé par la direction du Parti
Au sein de la direction de l’Organisation spéciale qui se constitue alors, Pierre Daix représente les étudiants communistes qui gardent leur autonomie sauf pour les actions coordonnées. Il peut désormais organiser une résistance visible, y compris des rassemblements en des lieux emblématiques, « tout cela sans trop savoir cependant si la direction du PC nous approuvait réellement ou pas ». Les étudiants communistes organisent des rassemblements le 14 juillet 1941 au Quartier latin et sur les grands boulevards, avec des gaullistes. La publication en 2003 des télégrammes échangés entre la direction clandestine du Parti communiste et les dirigeants du Komintern à Moscou montrent que Jacques Duclos s’est félicité de ces manifestations, exagérant d’ailleurs très largement le nombre des participants. D’autres manifestations suivent et Pierre Daix constate avec inquiétude et sans pouvoir le comprendre que les dirigeants du parti souhaitent que des affrontements et des arrestations aient lieu : « on recherchait bel et bien des affrontements à haut risque », l’Internationale presse le parti d’agir. Pierre Daix est tout à fait favorable au passage à la lutte armée mais il ne peut pas admettre qu’elle se fasse dans l’impréparation, qui ne peut conduire qu’à une terrible répression.
La manifestation du 13 août 1941 est une réussite, mais deux jeunes communistes sont capturés, condamné à mort et fusillés : « notre manifestation bricolée allait entrer dans l’histoire du fait de cette répression implacable et de nos deux premiers morts ». Pierre Daix se cache dans une famille juive du 11e arrondissement et perçoit les préparatifs de la rafle massive effectuée contre les juifs du quartier le 20 août, en représailles de la manifestation, rafle qui fut occultée par les journaux et radios de la collaboration ainsi que par la presse clandestine de la résistance et du Parti communiste. Les jeunes membres de l’Organisation spéciale (Pierre Daix insiste sur cette appellation et critique les historiens qui ont utilisé celle de Bataillons de la Jeunesse) effectuent quelques sabotages, dans des conditions très précaires de préparation et d’équipement. Si le Parti s’en félicite dans les télégrammes qu’il envoie à Moscou, il ne les assume pas dans sa presse clandestine et laisse les responsables du Front National les condamner comme des actes provocateurs.
Des résistants sacrifiés
« Le choix des cibles et des sabotages avait été laissé, ainsi que Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre l’ont impitoyablement démontré aux intuitions et aux connaissances de hasard de ce petit groupe de jeunes communistes. J’ai pu vérifier, en 1945, qu’il n’y avait pas eu le moindre encadrement au niveau du parti (…) Il s’agissait donc bel et bien d’une organisation spéciale, improvisée, sans stratégie, pressée d’obtenir des résultats spectaculaires pour donner des gages rassurants à Moscou, avec des recrues à remplacer très vite en cas de casse. » La direction du parti n’a jamais cherché à organiser leur sécurité, ne serait-ce que par un réseau de planques comme elle savait fort bien le faire pour ses clandestins. Force est de constater que ces militants ont été délibérément sacrifiés : « c’est donc la direction du Parti et elle seule qui nous a considérés, et sans nous en avertir, comme devant être sacrifiés pour la bonne cause. »
Les attentats contre les officiers allemands, ordonnés mais reniés par la direction du Parti
Le 21 août 1941, Pierre Georges (le futur colonel-Fabien) abat un officier allemand à la station de métro Barbès-Rochechouart. Les Allemands attribuent immédiatement cet acte aux communistes et exigent du gouvernement de Vichy l’exécution de six communistes déjà sous les verrous, parmi eux Jean Catelas, un proche de Jacques Duclos qui avait pris part aux négociations avec les Allemands, avant de s’en démarquer, et qui avait été mal protégé et arrêté. « Je n’eus connaissance alors d’aucune prise de position du parti concernant la tragédie de nos premiers guillotinés. »
L’OS ne fut organisé militairement par le parti communiste, en tant que section autonome, qu’au début de l’automne 1941. Elle n’est encore dotée d’aucune stratégie et ne comprend que peu de militants, autour de Pierre Tourette, de Gilbert Brustlein et de Pierre Georges. C’est à eux que la direction du Parti communiste fait appel quand elle décide de porter la lutte armée ailleurs que dans la région parisienne. Gilbert Brustlein et Spartaco Guisco partent pour Nantes où le premier abat le chef de la Kommandantur le 20 septembre 1941. La direction du Parti n’avait pas prévu « un succès aussi spectaculaire et dramatique », accru encore par le fait qu’un autre officier est exécuté à Bordeaux le 21 octobre. Les Allemands appliquent la politique des otages et le Parti, étonné de l’ampleur des représailles, « se trouve désemparé par l’ampleur du rejet que cette terreur provoque dans l’opinion publique et plus encore par le massacre inattendu par elle de ses propres cadres emprisonnés ». Le Parti ne réagit ni par tracts, ni dans L’Humanité clandestine. Alors qu’il est emprisonné à la centrale de Clairvaux, Pierre Daix côtoie des militants communistes qui avaient été arrêtés à l’automne 1939, pour avoir demandé, en raison du pacte germano-soviétique, qu’on fit la paix avec l’Allemagne. Il constate rapidement qu’ils sont en total désaccord avec les attentats commis contre des officiers allemands et qu’ils ignorent que ces attentats ont été faits sur l’ordre de la direction du parti. Pierre Daix est contraint de ne rien dire de son véritable rôle.
Les otages exécutés à Chateaubriant en représailles de l’attentat de Nantes sont des responsables syndicalistes ou politiques, arrêtés chez eux entre le 5 et le 11 octobre 1940, au cours des rafles anticommunistes menées par les policiers de Vichy après la rupture des négociations Duclos-Abetz. « De sorte, répétons-le, que les principales victimes du massacre de Chateaubriant seront de ces militants mêmes que Duclos avait fait sortir de la clandestinité à l’été 1940 pour les envoyer à la reconquête de leurs organisations syndicales ou de leurs mairies. ». Pour mieux dégager sa responsabilité dans les actions terroristes qui s’étaient soldées par une répression accrue, la direction du PCF choisit de célébrer le sacrifice de ces otages en niant du même coup l’engagement des combattants de la première heure.
La direction du Parti organise l’oubli des premiers résistants
Les fusillades d’otages provoquent une émotion énorme dans l’opinion publique. La direction du Parti communiste n’ose pas revendiquer les attentats qu’elle a ordonnés et décide même de désigner ses auteurs comme des provocateurs. Gilbert Brustlein est identifié, et recherché par toutes les polices. Non seulement la direction du Parti se refuse à le protéger, mais elle charge Pierre Georges de l’exécuter ; ce dernier ne peut s’y résoudre et lui demande de commettre un attentat suicide contre un restaurant de soldats de la Wehrmacht. Ce qui aurait permis de maquiller l’attentat de Nantes en acte individuel d’un jeune exalté. Brustlein refuse, réussit à quitter la région parisienne et à franchir la ligne de démarcation, gagne l’Espagne par les Pyrénées, et enfin Londres. Jusqu’à son retour en France en septembre 1944, on considérait qu’il avait disparu. Le Parti organisa le vide autour de lui et chercha à le détruire par une campagne de diffamation qui frappa aussi son ami Spartaco Guisco : celui-ci fut accusé d’avoir trahi ses camarades au moment de son arrestation et d’être allé se réfugier dans l’Espagne franquiste. La direction du Parti poussa même l’ignominie jusqu’à faire exhumer son corps du quartier des fusillés du cimetière d’Ivry : « le pire des outrages ». Il ne fallait toujours pas que l’on sache que c’était bien le Parti communiste qui était directement responsable de l’attentat de Nantes. En 1991 encore Gilbert Brustlein fut expulsé par la sécurité du Parti lors de la commémoration de la fusillade des otages de Chateaubriant : « Jacques Duclos était mort depuis 16 ans, mais ces dénis de mémoire lui survivaient ».
Un déni de mémoire élargi pour masquer les erreurs et les fautes de 1940
La dernière partie du livre traite de la déportation d’un millier de communistes, le convoi des « triangles rouges », parti de Compiègne le 6 juillet 1942 vers le camp d’Auschwitz où ils furent presque tous exterminés. Cette répression de masse ordonnée par les autorités nazies fut très longtemps ignorée jusqu’à ce que l’historienne Claudine Cardon-Hamet y consacre sa thèse, Les 45 000. Mille otages pour Auschwitz. Le convoi du 6 juillet 1942, Paris, éditions. Graphein, 1997 ; nouvelle publication aux éditions Autrement en 2005 sous le titre Triangles rouges à Auschwitz. Le convoi politique du 6 juillet 1942. Mais à la Libération, et pendant les décennies qui suivirent le Parti communiste organisa sur cet événement le même déni de mémoire, alors qu’il « possédait des informations solides sur un certain nombre de ces déportés ». Pierre Daix raconte comment il a découvert la responsabilité de Duclos dans ces opérations d’effacement de la mémoire destinées à cacher les errements politiques et stratégiques de la direction du parti en 1940.
« J’ai voulu montrer dans ce livre comment des pans entiers de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ont été, en France comme dans le reste de l’Europe continentale, délibérément remodelés après 1945 par les objectifs politiques du communisme stalinien (…) Les historiens (…) ont eu affaire ici à des remodelages destinés à les tromper durablement, diffusés qui plus est par des organisations puissantes, ayant les moyens d’exclure ou de déconsidérer les gêneurs. ». Mais au soir de sa vie Pierre Daix a la satisfaction de constater que les travaux des historiens ont rétabli la vérité.